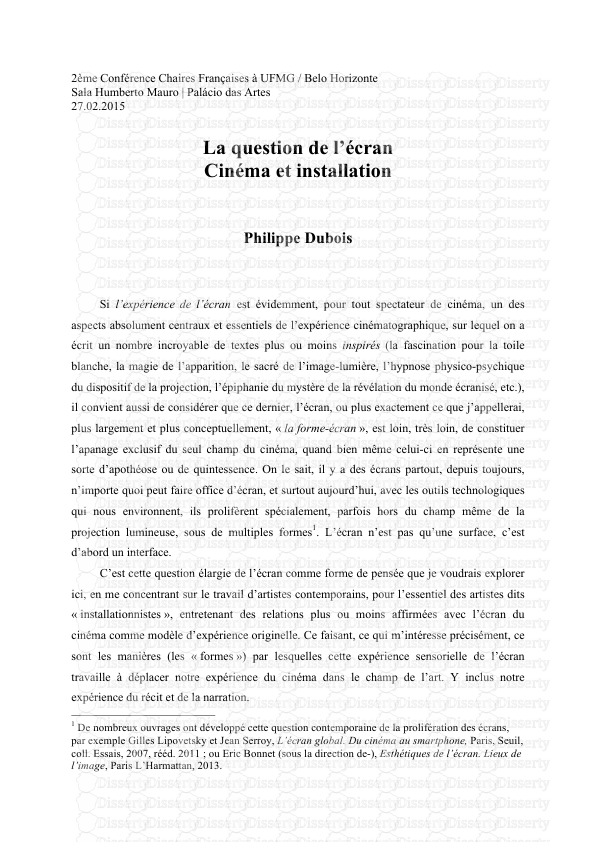2ème Conférence Chaires Françaises à UFMG / Belo Horizonte Sala Humberto Mauro
2ème Conférence Chaires Françaises à UFMG / Belo Horizonte Sala Humberto Mauro | Palácio das Artes 27.02.2015 La question de l’écran Cinéma et installation Philippe Dubois Si l’expérience de l’écran est évidemment, pour tout spectateur de cinéma, un des aspects absolument centraux et essentiels de l’expérience cinématographique, sur lequel on a écrit un nombre incroyable de textes plus ou moins inspirés (la fascination pour la toile blanche, la magie de l’apparition, le sacré de l’image-lumière, l’hypnose physico-psychique du dispositif de la projection, l’épiphanie du mystère de la révélation du monde écranisé, etc.), il convient aussi de considérer que ce dernier, l’écran, ou plus exactement ce que j’appellerai, plus largement et plus conceptuellement, « la forme-écran », est loin, très loin, de constituer l’apanage exclusif du seul champ du cinéma, quand bien même celui-ci en représente une sorte d’apothéose ou de quintessence. On le sait, il y a des écrans partout, depuis toujours, n’importe quoi peut faire office d’écran, et surtout aujourd’hui, avec les outils technologiques qui nous environnent, ils prolifèrent spécialement, parfois hors du champ même de la projection lumineuse, sous de multiples formes1. L’écran n’est pas qu’une surface, c’est d’abord un interface. C’est cette question élargie de l’écran comme forme de pensée que je voudrais explorer ici, en me concentrant sur le travail d’artistes contemporains, pour l’essentiel des artistes dits « installationnistes », entretenant des relations plus ou moins affirmées avec l’écran du cinéma comme modèle d’expérience originelle. Ce faisant, ce qui m’intéresse précisément, ce sont les manières (les « formes ») par lesquelles cette expérience sensorielle de l’écran travaille à déplacer notre expérience du cinéma dans le champ de l’art. Y inclus notre expérience du récit et de la narration. 1 De nombreux ouvrages ont développé cette question contemporaine de la prolifération des écrans, par exemple Gilles Lipovetsky et Jean Serroy, L’écran global. Du cinéma au smartphone, Paris, Seuil, coll. Essais, 2007, rééd. 2011 ; ou Eric Bonnet (sous la direction de-), Esthétiques de l’écran. Lieux de l’image, Paris L’Harmattan, 2013. La sensation d’écran : un espace de lumière Pour commencer, et un peu par provocation, par goût du geste radical, puisqu’il s’agit d’une expérience sensible qui est plutôt une expérience du non-écran, ou de la forme-écran comme négativité, je ferai état d’abord du formidable travail du plasticien américain James Turrell, connu pour ses « skyspaces »2. Le travail de Turrell, surtout ses installations des années 2001-2006 (Gap, Spread, Wide Out, End Around, la série Tiny Town, etc.)3, se présente, pour qui le découvre, comme une expérience plutôt contemplative autour de la question de la couleur (monochrome) comme espace. Le spectateur-visiteur se retrouve devant (et dans) des espaces de lumière-couleur très intenses, dont il fait une expérience perceptive plutôt physique. Devant lui, dans les pièces toujours isolées, dépouillées, épurées, où il pénètre, il n’y a rien d’autre à « voir » que de la lumière, très subtilement organisée, et spécialement un rectangle coloré, une sorte « d’écran de lumière » sur le mur de la salle où il est invité à se tenir. Le mot « voir » ne convient pas vraiment pour rendre la sensation très forte que procure ce ressenti de lumière couleur. Il y a une dimension haptique dans le rapport du sujet à la matière colorée qui se découpe dans l’espace qu’il « habite » (au sens d’Heidegger). D’ailleurs très souvent le spectateur est tenté de s’approcher, attiré par la lumière qui émane de l’écran, comme un papillon de nuit par une lanterne, s’approcher parce qu’il est intrigué, parce qu’il cherche à comprendre de quelle nature est ce rectangle lumineux qui irradie sur le mur, ce bleu plus bleu que celui de la pièce dans son ensemble, ce rouge plus intense qui semble venir de l’écran pour illuminer l’espace, il veut s’approcher parce que, dans ce monde dont il ne sait s’il est de lumière ou de couleur, il est pris d’un doute, et donc il veut toucher cet écran, le toucher comme saint Thomas, pour savoir autant que pour y croire. Et la surprise alors vient le saisir : il n’y a pas d’écran devant lui, pas de surface matérielle qui brille sur le mur. Rien à toucher. Il n’y a rien qu’un vide, un trou dans le mur, comme une fenêtre ouverte. Cet écran, qu’il percevait comme si « physique », n’est rien qu’un rectangle sans matière fait uniquement d’une luminosité intense qui vient d’une deuxième pièce, située de l’autre côté du mur et qu’il n’avait pas perçue comme une seconde salle. Pas de mur, pas 2 L’origine des Skyspaces de Turrell tient dans sa fameuse expérience du Roden Crater en Arizona : voir, « de l’intérieur du cratère », le ciel comme un espace de couleur, matière lumineuse cadrée par une découpe circulaire et s’installant devant nos yeux et notre esprit comme une sensation visuelle pure de lumière-couleur. Beaucoup d’autres œuvres seront ensuite construites sur des découpes (naturelles mais aussi architecturales, en tous cas toujours géométriques : cercle, ovale, carré, rectangle), donnant sur l’espace du ciel – lieu d’émission et de réflexion d’intensités lumineuses infiniment variées – traité comme matière colorée. 3 Voir, entre autres, le livre de Georges DIDI-HUBERMAN, L’Homme qui marchait dans la couleur, Paris, Minuit, 2001. d’écran, rien de palpable, rien qu’un « vide de lumière » rayonnante, qui a trompé l’œil du sujet. Et pourtant la sensation de matière lumineuse est totale, plus forte que la connaissance que l’on a du « vide ». La perception est bien physique et le spectateur ne peut pas ne pas s’y abandonner. D’ailleurs, sitôt réalisée « l’expérience du trou » (passer sa main), le sujet revient se mettre au centre de la pièce, à la « bonne » distance, celle où il jouit de la sensation de lumière couleur, celle où l’effet d’écran le fascine. Les expériences psycho-perceptives et phénoménologico-métaphysiques de Turrell n’évoquent jamais explicitement le dispositif cinématographique (pas de visée analytique ou critique dans son travail). Mais il me semble qu’elles sont profondément travaillées par un tel « effet cinéma » (et pas seulement au titre d’une métaphore). Il me semble qu’on peut dire que pour comprendre toute la « puissance de sensation » des pièces de Turrell, la référence à l’écran de cinéma est presque nécessaire. Quelle autre « pure surface » en effet exerce par elle-même (sans recours à une image figurative) une telle force d’attraction sur notre perception ? On trouvera, cette fois beaucoup plus explicitement, un autre cas de mise en scène de la fascination pure qu’exerce l’écran de cinéma dans le beau travail, photographique cette fois, du japonais Hiroshi Sugimoto, connu sous le titre générique de Theaters. On y voit, dans de magnifiques tirages, très soignés, de grands écrans de cinéma (des écrans en intérieur, dans de somptueuses salles américaines des années 30-50, souvent monumentales dans leurs décors sophistiqués, et des écrans en extérieur, dans des drive in en plein air, sur fond de ciel et de palmiers). Tous ces écrans (cette fois ce sont de vrais écrans, de cinéma, pas des métaphores conceptuelles) sont entièrement blancs, mais blancs non par manque d’image (parce qu’on n’y aurait rien projeté) mais au contraire blancs par excès d’images : ils ne sont pas simplement de couleur blanche, ils sont « en lumière blanche », d’un blanc intense, irradiant, trop blanc. Ils sont blancs parce qu’ils ont été pour ainsi dire blanchis, brûlés par la lumière du film qui y a été projeté in extenso, et qui a donc abouti à une surexposition de cette partie dans la photo. L’exposition des photos de Sugimoto a en effet duré tout le temps de la projection du film sur l’écran. Temps de pose photographique et temps de projection cinématographique sont délibérément associés, identifiés, fusionnés, dans un geste de pensée qui met en équivalence symbolique exposition et projection. Autrement dit, ces écrans blancs « contiennent » virtuellement toutes les images du film, additionnées, superposées jusqu’à l’effacement, englouties dans la blancheur incandescente d’un temps de pose étiré à la durée d’un film entier. Toutes les images accumulées du film reviennent ainsi à une absence d’images visibles dans la photo. Et ces images invisibles par excès de lumière, ces écrans éblouissants et vides, deviennent en retour des sources de lumière, par réverbération, éclairant la salle, les rangées de sièges, les décors ou illuminant les ciels nocturnes des drive in (l’écran noir de nos nuits blanches). Ces photos, qui se donnent un temps ouvert, qui effacent la figuration filmique dans une saturation de blanc, qui font de leur exposition photosensible un équivalent littéral de la projection sur écran, qui transforment les écrans de réception d’image en source de lumière pour l’éclairage des lieux, ces photos sont bien de pures figures d’écrans comme matière lumière. Dans le prolongement du travail d’Anthony McCall sur la projection comme « lumière solide », les œuvres de Turrell et de Sugimoto développent bien la même idée formelle : le dispositif de l’écran comme espace phénoménal de la lumière, à la fois irradiant et absorbant, qui efface autant qu’il uploads/s3/ la-question-de-l-x27-ecran-conf-bh.pdf
Documents similaires










-
45
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 08, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2254MB