HENRIETTE WALTER Le français d’ici, de là, de là-bas JC LATTÈS À mon « Parisien
HENRIETTE WALTER Le français d’ici, de là, de là-bas JC LATTÈS À mon « Parisien de province » préféré © 1998, éditions Jean-Claude Lattès. PRÉFACE par André Martinet Une langue est, tout ensemble, le support de la pensée – une façon d’ordonner sa représentation du monde – et un instrument de communication qui permet aux gens de s’entendre. Selon son éducation, selon ses goûts, chacun mettra l’accent sur la priorité de l’une ou l’autre de ces fonctions. Peu importe, en fait. L’enfant qui crée son premier mot, c’est-à-dire identifie une certaine production vocale et un objet ou une circonstance, réalise tout ensemble une opération intellectuelle et un acte social. Il restera, par la répétition, à rapprocher cette identification de celle que réalise l’entourage de l’enfant et, finalement, la communauté linguistique tout entière. Mais jusqu’où s’étend cette communauté ? D’abord, le mot peut rester, pour l’enfant, teinté par les circonstances particulières de son acquisition, ce qu’on a pu désigner comme ses connotations. Mais l’intégration à la communauté n’en sera guère affectée. Plus sérieuses sont, en la matière, les divergences entre les membres de la nation, d’une région, d’une province à une autre. Même s’ils s’entendent parfaitement, les Français ne s’accordent pas, par exemple, sur la façon de désigner l’opération qui consiste à mêler la salade : les uns la touillent, d’autres la brassent ou la fatiguent. Dans ce cas, les circonstances sont telles qu’une fois présents le saladier, la verdure en cause et les instruments, une invitation à agir suffit, quelle qu’en soit la forme. Mais ne va-t-on pas, dans bien des situations, se heurter à des divergences d’un bout à l’autre du domaine de la langue ? Dans le cas du français, on pense aux incompréhensions possibles lorsqu’on passe de l’Hexagone aux pays voisins, aux autres continents ou aux îles lointaines. Le recours aux formes parisiennes pourrait sembler s’imposer. Chacun sait que c’est à partir de Paris que s’est diffusé le français. Mais c’est là que nous allons trouver des résistances. C’est là qu’il convient, dans les termes d’Henriette Walter, de distinguer entre Paris-terroir et Paris-creuset. Toute langue change à tout instant, et non seulement parce qu’il s’y crée sans cesse des formes nouvelles pour des objets nouveaux ou des notions fraîchement dégagées, mais aussi parce que la langue elle-même est un réseau de structures qui se conditionnent les unes les autres. Pendant longtemps, par exemple, le terroir parisien a maintenu la différence entre le a d’avant de Montmartre, et le â d’arrière de câline, tantôt en repoussant le premier vers l’avant, tantôt en accentuant la profondeur du second. Mais, finalement, dans Paris-creuset, la masse des nouveaux venus ne s’y retrouvait plus, soit parce que, Méridionaux, ils ne connaissaient pas la différence, ou que, fidèles à une tradition, ils opposaient la brève de patte à la longue de pâte, plutôt que deux timbres nettement distincts. La solution se trouve dans la progressive désaffection pour une des formes en conflit : face à tache, tâche a reculé, cédant sa place à l’argotique boulot, ailleurs que dans les emplois littéraires ou les expressions figées comme (un travail payé) à la tâche. Tout ceci devait inciter les linguistes à chercher à localiser les divergences, à déterminer, en France et hors de France, les zones où se maintiennent les formes particulières sur les deux plans des sons et du sens. Doit-on distinguer entre des provinces, ou, plutôt, entre ce que l’on désigne comme des pays ? La tâche est longue et ardue, et Henriette Walter l’avait amorcée dans un ouvrage antérieur. Elle rappelle ici l’existence de ces zones du terroir, comme la Bresse et le Bugey, dont les limites ne se laissent pas cerner comme celles des départements, mais qui peuvent guider le linguiste dans sa recherche des variétés de la langue. C’est surtout dans son développement à travers les siècles et dans sa diffusion dans ce que nous appelons l’Hexagone et au-delà, qu’il convient de suivre le français comme se singularisant parmi les parlers issus du latin et s’imposant graduellement comme la langue à tous usages, aussi bien quotidiens que littéraires ou administratifs. Le français apparaît pour la première fois dans les Serments de Strasbourg, en 842, distinct du latin qu’utilise Nithard pour nous le présenter. Il s’étend lentement à la fiction, mais il faut plus de deux siècles pour qu’il s’impose dans l’œuvre majeure qu’est la Chanson de Roland. D’autres siècles s’écouleront avant qu’on s’enhardisse à l’employer dans des actes administratifs. Si, dans la présentation de sa diffusion géographique, Henriette Walter part de la Savoie, c’est que c’est là que le comte Amédée VI décide d’adopter le français comme langue officielle, près de deux siècles avant que François Ier en fasse autant, en France, par l’ordonnance de Villers-Cotterêts, en 1539. Il va sans dire que le bon peuple continuera jusqu’à nos jours à utiliser des parlers locaux. Ces parlers, dans la mesure où ils sont d’origine romane, sont, aujourd’hui, en voie de disparition et remplacés par la langue nationale sous des formes qui ont été influencées par les habitudes locales. Leurs caractéristiques retiennent l’attention de l’auteur. On ne peut, en effet, exclure qu’ils finissent par influencer, dans une certaine mesure, la norme de la langue, comme on l’a signalé ci-dessus à propos du sort de a. Ce panorama de l’expansion du français comporte naturellement celle qui va atteindre, avec la colonisation, d’autres régions du globe. Elle commence avec Jacques Cartier à une date qui coïncide à peu près avec celle de l’ordonnance de Villers-Cotterêts. Elle s’étend hors de France, en Belgique, en Suisse et, plus difficilement, dans le Val d’Aoste, c’est-à-dire dans les domaines de la langue d’oïl et du francoprovençal. Au-delà de la frontière, on relève des entorses à la norme parisienne, dans la numération notamment, et, plus récemment, dans l’extension des formes féminines de profession. Mais la mondialisation qui se manifeste aujourd’hui freinerait sans doute les tendances centrifuges, et les innovations que l’on relève hors de France n’ont guère de chances de s’y implanter. Le creuset parisien ne peut finalement imposer que des formes qui ont l’appui de l’ensemble de l’Hexagone : un Savoyard, votre serviteur, a éliminé ses septante et nonante à la minute où il a pénétré dans la classe de mathématiques au lycée qui porte aujourd’hui le nom de Vaugelas. PRÉAMBULE 265 fromages et autant de façons de parler La boutade du général de Gaulle selon laquelle il est impossible de « rassembler un pays qui compte 265 spécialités de fromages » pourrait aussi s’appliquer à ce qu’on nomme communément la langue française, car la langue française présente aussi des « spécialités ». La conception du français la plus largement répandue est aussi la plus floue : c’est celle d’une langue plus imaginaire que réelle, que l’on identifie vaguement avec la langue qu’on enseigne, la langue française telle qu’on la rêve. Elle se veut consensuelle et uniforme, et elle n’existe peut-être que dans les manuels. On la confond souvent avec la langue écrite, qui devient de ce fait un modèle et tout un programme. Mais parle-t-on et écrit-on comme dans un livre ? En face de cette langue idéalisée et presque mythique, la langue quotidienne telle qu’on la manie sans trop y penser est loin de connaître l’uniformité. Elle change avec les individus et les circonstances de la vie et, surtout, elle varie insensiblement d’un point à l’autre du territoire : la diversité du français ne peut se comprendre que si on la replace d’abord dans son cadre géographique. Paris et « la Province » Cela revient à apporter une attention toute particulière aux usages régionaux du français, qui ont longtemps souffert d’être confondus un peu vite avec les usages populaires, familiers ou argotiques, tandis que les usages parisiens s’identifiaient au « bon usage ». Or il faudrait rappeler que si Paris a effectivement joué un rôle primordial dans l’histoire de la langue française, qui y a pris son essor et y a puisé son dynamisme, ce n’est pas pour des raisons de supériorité linguistique, mais essentiellement par volonté politique. Devenue la langue du roi, elle s’est répandue avec succès hors de ses limites d’origine à mesure que le royaume s’agrandissait, en faisant de l’ombre aux autres langues qui s’étaient développées sur le territoire. Ne pas confondre « Paris-terroir » et « Paris-creuset » Les observateurs ont toujours souligné le rôle de locomotive des usages linguistiques de Paris, vers lesquels se sont dirigés et se dirigent depuis des siècles ceux des autres régions, parfois de bonne grâce mais le plus souvent à leur corps défendant, et c’est effectivement une réalité dont l’importance ne saurait être négligée. Il ne faudrait pourtant pas croire qu’il existe deux blocs face à face : d’un côté la façon de parler de Paris et de l’autre celle de toute la France. Car Paris est essentiellement peuplé de Provinciaux, tandis que les Parisiens de souche, largement minoritaires, même à Paris, constituent en fait les rares représentants de la « région » Paris au sens étroit du terme, tout comme les habitants de Toulouse uploads/s3/ le-francais-d-x27-ici-de-la-de-la-bas-walter-henriette-pdf.pdf
Documents similaires




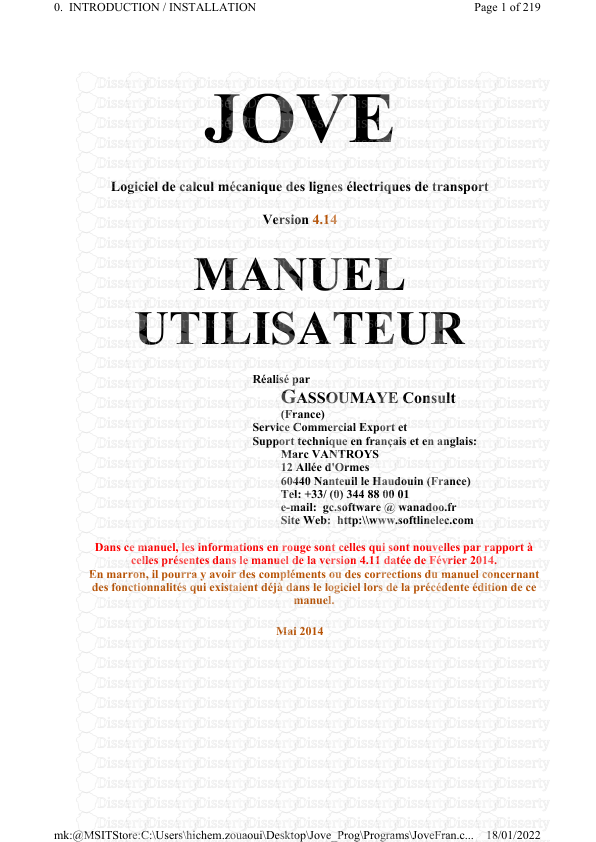





-
82
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 31, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 6.2520MB


