Je dédie ce modeste travail à ma chère mère qui m’a Je dédie ce modeste travail
Je dédie ce modeste travail à ma chère mère qui m’a Je dédie ce modeste travail à ma chère mère qui m’a Je dédie ce modeste travail à ma chère mère qui m’a Je dédie ce modeste travail à ma chère mère qui m’a toujours soutenue et grâce à qui j’ai pu réaliser mon rêve, à toujours soutenue et grâce à qui j’ai pu réaliser mon rêve, à toujours soutenue et grâce à qui j’ai pu réaliser mon rêve, à toujours soutenue et grâce à qui j’ai pu réaliser mon rêve, à mes chères sœurs et leurs familles et à tous mes collègues de mes chères sœurs et leurs familles et à tous mes collègues de mes chères sœurs et leurs familles et à tous mes collègues de mes chères sœurs et leurs familles et à tous mes collègues de L’Ecole Normale Supérieure. L’Ecole Normale Supérieure. L’Ecole Normale Supérieure. L’Ecole Normale Supérieure. Je vous offre, en guise de reconnaissance Je vous offre, en guise de reconnaissance Je vous offre, en guise de reconnaissance Je vous offre, en guise de reconnaissance, ce modeste , ce modeste , ce modeste , ce modeste travail en vous souhaitant santé, bonheur et longue vie. travail en vous souhaitant santé, bonheur et longue vie. travail en vous souhaitant santé, bonheur et longue vie. travail en vous souhaitant santé, bonheur et longue vie. RAJAE Je dédie ce modeste travail à toute m Je dédie ce modeste travail à toute m Je dédie ce modeste travail à toute m Je dédie ce modeste travail à toute ma famille et à tous a famille et à tous a famille et à tous a famille et à tous mes collègues mes collègues mes collègues mes collègues de de de de l’Ecole N l’Ecole N l’Ecole N l’Ecole Normale ormale ormale ormale S S S Supérieur upérieur upérieur upérieure. e. e. e. LAILA Nous tenons à exprimer notre vive reconnaissance à M.RACHID MORROUN qui, par son soutien et ses encouragements, a permis à ce mémoire d’exister. Qu’il trouve ici l’expression de notre profonde gratitude. Que tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont contribué à la mise au point de ce modeste travail soient ici profondément remerciés 1 Introduction ................................................................................................ 2 Première partie : étude théorique. Premier Chapitre : Aperçu sur la littérature maghrébine d’expression Française A- Définition. ................................................................................. 5 B- La Boîte à merveilles : sa genèse et sa réception. ........................ 6 Deuxième Chapitre : l’autobiographie. A- Définition ………………………………………………………...8 B- L’autobiographie dans la littérature maghrébine d’expression française ..................................................... 8 C- L’écriture autobiographique……………………………………...9 Troisième Chapitre: Présentation du roman la Boîte à merveilles. A- Les aspects de la tradition orale dans la Boîte à merveilles .......................................................... 10 B- Les personnages ........................................................................ 11 C- Structure de l’œuvre, schéma narratif, temps et espaces ....................................................... 13 Deuxième partie : Etude pratique Premier Chapitre : Présentation de la première séquence. Séance 1 : Lecture méthodique ....................................................... 18 Séance 2 : Production écrite .............................................................. 21 Séance 3 : Langue ............................................................................. 23 Séance 4 : Lecture sélective .............................................................. 26 Séance 5 : Lecture linéaire ................................................................ 28 Séance 6 : Langue.............................................................................. 30 Séance 7 : Etude de texte-groupement de texte ................................. 33 Séance 8 : Activité orale .................................................................... 35 Deuxième Chapitre : Présentation de la deuxième séquence : Séance 1 : Lecture méthodique ...................................................... 37 Séance 2 : Activité orale ................................................................ 41 Séance 3 : Langue .......................................................................... 43 Séance 4 : Production écrite (résumé) ............................................ 46 Séance 5 : Lecture méthodique ...................................................... 50 Séance 6 : Langue .......................................................................... 54 2 Séance 7 : Production écrite (dissertation ....................................... 57 Séance 8 : évaluation ..................................................................... 59 Conclusion ............................................................................................... 63 Résumé .................................................................................................... 64 Les mots clés du mémoire ........................................................................ 65 Bibliographie ........................................................................................... 66 Annexe ..................................................................................................... 68 3 Introduction Le ministère de l’Education Nationale a instauré un nouveau système éducatif du français au Maroc. Cette réforme vise le développement de l’enseignement de qualité qui prépare les élèves d’une manière efficace à des études supérieures réussies. En effet, l’enseignement/apprentissage du français au cycle secondaire qualifiant repose sur le concept de la compétence. L’apprenant est appelé alors à ce stade à s’exprimer avec une langue correcte à l’oral comme à l’écrit. De ce fait, le cycle secondaire qualifiant est une étape où l’élève consolide des acquis et perfectionne en vue d’une appropriation progressive des connaissances actuelles et linguistiques de la langue. Ainsi, pour réaliser les finalités de cette réforme, il est nécessaire de travailler sur des œuvres littéraires intégrales. L’élaboration pédagogique de ces textes s’effectue à partir d’un projet que l’enseignant propose en clarifiant les compétences et les capacités à atteindre à travers des activités variées qu’il prépare. Pour le choix des œuvre exploitées dans le cycles secondaire, le ministère de l’Education Nationale propose entre autre les romans maghrébins d’expression française c’est pour cette raison que nous choisissons de travailler sur une œuvre d’Ahmed Séfrioui La Boîte à merveilles qui fait partie du programme de la première année du baccalauréat. Ahmed Séfrioui, dans cette œuvre, décrit les traditions de la société marocaine dont il est témoin. Nous sommes inspirées de ce principe pour nous arrêter sur le sujet ; Opposition tradition/modernité dans la Boîte à merveilles. Notre travail se divisera en deux parties : la première est théorique où nous essayerons de présenter l’œuvre en mettant l’accent sur son para texte .La deuxième partie est pratique. Elle sera consacrée à l’exploitation pédagogique de la Boîte à merveilles. Dans cette deuxième partie, nous allons élaborer deux séquences didactiques qui comprendront diverses activités afin de rendre la compréhension de l’œuvre accessible au public ciblé c'est-à-dire les 4 élèves de la première année du baccalauréat. L’intérêt pour nous sera alors la transmission d’un savoir académique à des lycéens qui ont des connaissances limitées en littéraire. 5 Première partie Première partie Première partie Première partie : : : : étude théorique étude théorique étude théorique étude théorique 6 Premier chapitre : Aperçu sur la littérature maghrébine d’expression française : A. Définition La littérature maghrébine d’expression française est née principalement vers les années 1945-1950 dans les trois pays du Maghreb : La Tunisie, l’Algérie et le Maroc, et produite par des auteurs originaires de ces trois pays. La colonisation du Maghreb à partir de 1830 a produit un phénomène d’acculturation qui a introduit des données nouvelles dans la société locale .Les trois littératures modernes : tunisienne, algérienne et marocaine sont nées sous la colonisation ; cela a posé une grande question pour les écrivains : est-il possible d’écrire dans la langue du colonisateur sans être aliéné ? Cette question ne cessera pas de hanter la littérature maghrébine de langue française. En imposant aux trois contrées le joug de l’occupation, le système colonial gérait aussi la formation de la culture : il diffusait sa langue par le biais de l’école, de l’administration, de la justice et de la presse. D’ailleurs, la colonisation du Maghreb a favorisé l’émergence d’une littérature écrite par des "indigènes" dans la langue du colon, mais dont le système de pensée est fortement dépendant du milieu socioculturel auquel appartenaient ces écrivains. En effet, la politique coloniale de domination pratiquée par les français s’est accompagnée d’une mise à l’écart des cultures et des langues locales. Le colonisateur, en imposant son système d’éducation aux populations autochtones, sous le couvert de missions "civilisatrices", ne visait en fait que leur « assimilation » pure et simple. C’était peut-être sans compter sur l’enracinement des langues arabes et berbères de la culture musulmane. Dés lors, quand des maghrébins ont écrit, ils se sont exprimés en français et ils ont composés des textes d’une dimension littéraire et identitaire complexe. Les auteurs maghrébins ont produit des livres appartenant à différents genres littéraires. L’essai est le 7 premier genre adopté : il offrait à l’auteur une tribune d’où il pouvait revendiquer une place dans l’espace colonial. Lorsque l’écrivain éprouvait le besoin d’apporter sa contribution à un débat d’ordre culturel ou politique, il recourait à l’essai. Mais, les formes narratives seront les plus fréquentées par la suite. La nouvelle et le roman comportent souvent les traces du conte ou d’autres genres traditionnels. Les narrations1 sont multiples : elles prennent pour sujet une vie exemplaire, la vie même du narrateur (autobiographie posant le problème de l’identité et de l’assimilation). Les faits quotidiens de la société reflètent une autre image du Maghreb différente à celle « colportée »par le colonisateur. Avec Mohamed Dib, Driss Chraïbi, Mouloud Mammeri, Mouloud Feraoun…etc. C’est Ahmed Séfrioui qui, le premier, en 1949, a inauguré la littérature marocaine d’expression française avec son roman fondateur "Le chapelet d’ambre". Grâce à la publication de "La Boîte à merveilles" en 1945, il ouvre la voie à d’autres écrivains qui ont choisi, eux aussi, la langue française comme outil d’expression. Dés 1954, Driss Chraïbi s’impose avec éclat en publiant son récit Le passé simple, puis en 1955 son roman Les boucs. Quant à Abdellatif Lâabi, il fonde en 1966 la revue Souffles et publie en 1969 L’œil et la nuit. Mohamed Khair-Eddine s’introduit en 1967 dans le champ littéraire avec son roman Agadi". De son côté, Khatibi publie uploads/s3/ memoire-la-boite-a-merveilles.pdf
Documents similaires





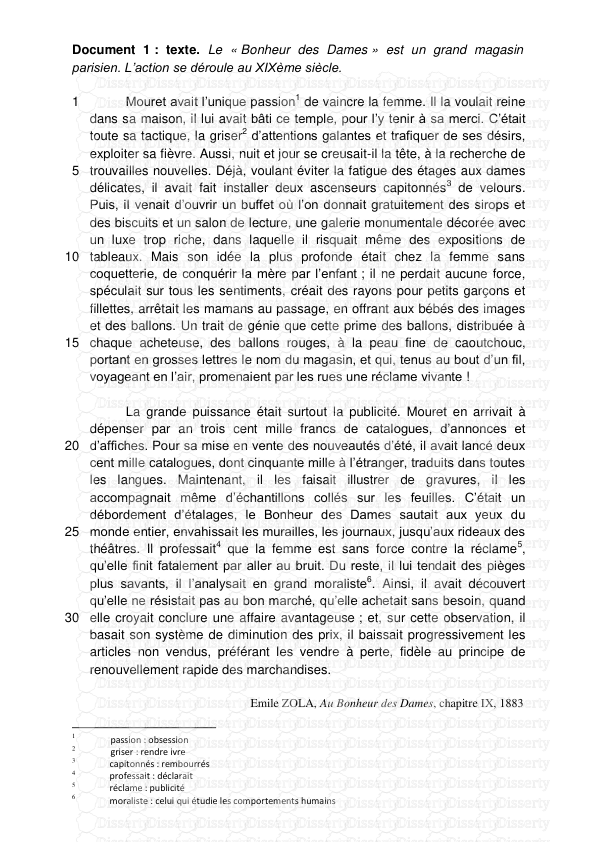




-
69
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 28, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4081MB


