LES LYS ET LE CHARDON : LES ECOSSAIS DE LA MAISON DU ROI par André Pagès ACADEM
LES LYS ET LE CHARDON : LES ECOSSAIS DE LA MAISON DU ROI par André Pagès ACADEMIE DES SCIENCES ET LETTRES DE MONTPELLIER Séance du 22/05/2006 Conf. n°3942, Bull. 37, pp. 109-120 (2007) Pour évoquer valablement l’institution, depuis longtemps disparue, à laquelle se réfère le titre de cet exposé, il importe non seulement de la replacer dans le cadre qui fut le sien, mais aussi de redonner à certains termes le sens qu’ils ont perdu de nos jours. C’est pourquoi quelques précisions aussi bien historiques que sémantiques tiendront lieu d’avant propos à cette communication. Qu’entendait-on par Maison du roi ? Cette expression, apparue en 1671, a été interprétée par les contemporains de façon différente. Pour la plupart, elle désignait 6 unités de cavalerie : Gardes du Corps, Gendarmes et Chevaux légers de la Garde, Mousquetaires gris et noirs, Grenadiers à cheval entourant la personne du souverain. Au XVIIIè siècle le Père Daniel, historien de l’armée, admet qu’on puisse y inclure les 100 Suisses et les régiments des Gardes française et suisse, mais il en exclut absolument les Gardes de la porte et ceux de la prévôté de l’Hôtel1, car, écrit-il, « ils ne sont pas destinés aux services militaires ». Depuis lors, toutes ces formations sont considérées comme constituant la Maison, se regroupant pour former la « Garde du dedans » et la « Garde du dehors » veillant à la sécurité du roi dans son palais et à l’extérieur de celui-ci. Qu’entendait-on par gendarme ? Avant la Révolution, qui a récupéré le mot pour lui donner un sens nouveau, il ne s’agissait en aucune manière d’un membre de la maréchaussée. Il désignait, au Moyen-âge, un cavalier en armure complète répondant à l’appel du suzerain pour la durée d’un transitoire service d’ost. Les inconvénients de ce système avaient fait envisager, dès 1439, la création de troupes régulières et soldées à la disposition permanente du roi. Mais ce n’est qu’en 1445 que Charles VII la réalisa sous forme de 15 compagnies d’ordonnance de 100 lances chacune. On appelait lance un groupe de combat composés d’un homme armé de toute pièce, auquel resta attaché le nom de gendarme, de 3 archers, 1 coutilier et un page, tous montés, de sorte qu’une compagnie d’ordonnance avait un effectif de 600 combattants. La gendarmerie resta longtemps la force essentielle des armées. Les compagnies 1 Les gardes de la porte, antérieurs à Saint Louis, sont 50 au XVIIè avec 1 capitaine et 4 lieutenants. Ils servent par quartier, en faction à l’entrée du palais qu’ils défendent à tout individu ayant d’autre arme que l’épée. Supprimés le 30 septembre1787. Les gardes de la prévôté de l’hôtel datent de 1271. Sous la Régence, ils sont 88 avec un capitaine (le grand prévôt de France) 4 lieutenants, 12 exempts, 1 maréchal des logis, 1 trompette servent par quartier pour assurer la police à l’intérieur du palais. Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, André Pagès, 2006 2 s’en multiplièrent au cours des guerres de religion, à l’initiative de grands seigneurs ou d’aventuriers, en s’adaptant toutefois aux progrès de l’arme à feu qui dévalorisa l’armure et transforma la tactique. Recrutées par les Ligueurs comme par les Huguenots, elles échappaient à l’autorité royale. C’est ainsi qu’en 1563 on en comptait 103 totalisant 4 210 lances. Aussi, Henri IV les cassa-t-il presque toutes en 1598. Pourtant, à la naissance du Dauphin, il lui affecta une compagnie que Louis XIII, lorsqu’il accéda au trône, intégra dans sa Maison : ce sont les gendarmes de la Garde déjà cités. On ne les confondra pas avec ceux de la Gendarmerie de France créée en 1690 par Louis XIV, dans des circonstances qui seront détaillées par la suite. La vieille alliance et ses suites Il parait difficile que Saint Louis, lors de sa croisade au Levant, ait été escorté, comme on l’a supposé, par 24 Ecossais. Les relations entre la France et l’Ecosse n’en sont pas moins fort anciennes. Très vraisemblablement, un traité, dit la Vieille alliance, fut conclu, l’an 1295, entre Philippe le Bel et John Balliol, roi des Hautes Terres. Mais c’est au XVè siècle qu’elle se concrétisera. Dans la tragique situation où il se trouve, le roi de Bourges fait appel aux Ecossais, en 1420, et plusieurs milliers d’entre eux y répondent sous John Stewart of Buchan. Ce personnage reste quelque peu mystérieux, selon les sources il est donné tantôt comme le fils du régent d’Ecosse, tantôt comme le connétable de ce pays. Pour certains, il fut tué à la bataille de Verneuil en 1422, pour d’autres à celle dite « des harengs », sous Orléans, en 1429. Quoiqu’il en soit, c’est parmi ces Ecossais que Charles VII sélectionne 100 hommes d’armes pour en faire sa garde personnelle auxquels il adjoint, quelques années plus tard, 100 archers de la même origine. La date exacte du recrutement successif de ces 2 troupes reste floue, entre 1421 au plus tôt et 1444 au plus tard d’après les auteurs, elles furent placées sous le commandement de John Stewart, peut-être le fils du précédent, peut-être un homonyme, Stewart étant un nom très répandu outre Manche. Telle est l’origine des Ecossais de la Maison du roi, objet de cette communication. Les Gardes de la manche, protection rapprochée Parmi ses 100 archers écossais, peut être même en plus de ceux-ci, 24 furent choisis par Charles VII comme escorte permanente sous le nom d’archers du corps. Il leur donna un chef qui reçut le titre honorifique de 1er homme d’armes de France. Ce sont ces 25 qu’on appellera successivement, par la suite, Appointés de la compagnie écossaise, puis Gardes de la manche, dénomination sous laquelle ils sont généralement connus. Nous pouvons nous en faire une idée à leurs débuts grâce à Jean Fouquet, peintre talentueux, qui a enluminé, en 1464, le livre d’heures d’Etienne Chevalier, trésorier de France. Il y a, en effet, représenté l’adoration des mages en prenant pour modèle Charles VII entouré de ses fidèles Ecossais. Très introduit à la Cour, portraitiste du roi et d’Agnès Sorel, il connaissait bien les archers et sa réputation d’artiste très précis nous garantit le réalisme de son œuvre. A-t-il immortalisé les 25 ou quelques-uns des 100 archers de la garde ? La 1ère hypothèse parait la plus probable et nous les voyons portant l’armure dont les pièces sont Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, André Pagès, 2006 3 visibles sur les membres, le reste étant masqué par un hoqueton 2 où alternent les couleurs vert, blanc et rose avec des petits clous argentés dessinant des lys avec leurs tiges. A l’encolure apparaît le haut d’un haubergeon de mailles. Ils sont coiffés du casque dit salade, assujetti par une jugulaire et sommé d’un gros panache, lui aussi vert, blanc et rose. Tous portent l’épée, excepté leur chef, au 1er plan, armé d’une dague à rouelle et dont le casque s’orne d’un insigne métallique. La plupart de ses hommes ont en main un vouge, quelques uns sont munis de l’arc long. Un sur deux a, suspendu au cou par sa guiche, un bouclier ovale, sur lequel sont peints des lys au naturel et que centre un volumineux umbo de fer. Les autres ont accroché à leur ceinture une boce, rouelle d’acier très prisée des gens de pied à cette époque, qui devait rappeler à ces Ecossais leur petite targe nationale. Louis XI en 1475, puis en 1479, créa 2 nouvelles compagnies pour sa garde mais à recrutement français et il semble avoir inventé le nom de Gardes du Corps. François 1er est à l’origine de la 3è compagnie française, mais l’écossaise restera toujours la 1ère des gardes du corps jusqu’en 1791. Les archers du corps sont dotés à une date imprécise d’un hoqueton brodé d’or. Commynes fait état de hoquetons « orfaucrisés » et le père de Clément Marot, poète lui-même à la cour d’Anne de Bretagne, célébrant l’entrée de Louis XII à Milan, en 1509, écrit : « Après marchaient sur gros chevaux montés/Archiers de garde en fière contenance/Portant chacun hauquetons argentés/qu’il fait beau voir marcher en ordonnance ». Mais s’agissait-il seulement des 24 ? Nous devons les premières précisions au maréchal de Fleuranges dans son « Histoire des choses mémorables » rédigée sous le règne de François 1er. On y lit : « Nous avons les plus proches du Roi 25 archers écossais qui s’appellent les Archers du corps et ont un sayon blanc à une couronne au milieu de la pièce devant l’estomac et sont les dits sayons tout chargés d’orfèvrerie depuis le haut jusqu’en bas ». Ce que vient confirmer, Houston, ex officier de la compagnie écossaise dans son livre « L’Ecosse française, paru en 1607, par cette phrase : « Il y en a 25 d’iceux appointez, portant des hoquetons blancs couverts de papillotes d’argent, desquels en servent 6… les plus près de la personne du Roi ». Si nous sommes ainsi assurés que, au moins depuis le règne de François 1er, les Gardes de la manche sont distingués par un hoqueton particulier, sa description reste des uploads/s3/ pages-2006.pdf
Documents similaires









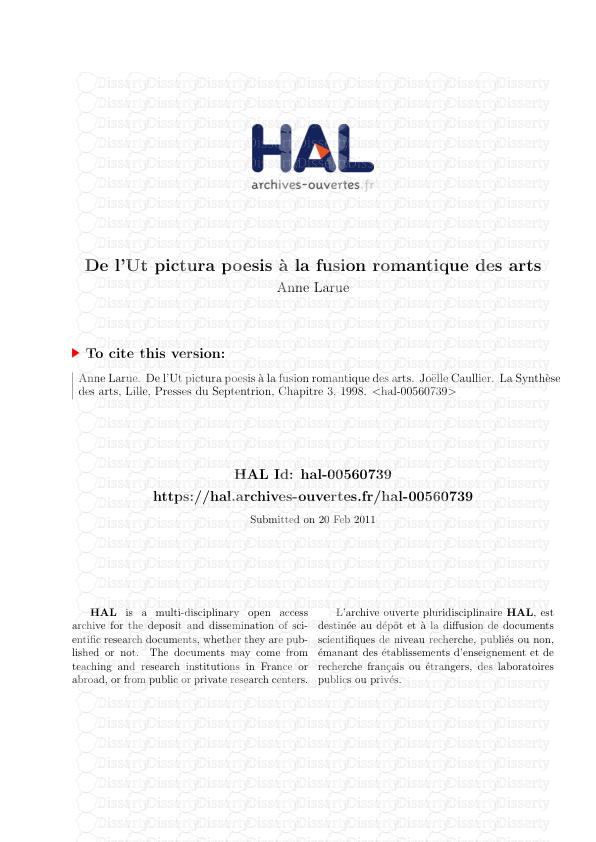
-
110
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 11, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3533MB


