Tous droits réservés © 24/30 I/S, 2008 This document is protected by copyright
Tous droits réservés © 24/30 I/S, 2008 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ Document generated on 06/09/2019 12:31 a.m. 24 images Pourquoi expose-t-on le cinéma? Dominique Païni Comédie Number 140, December 2008, January 2009 URI: https://id.erudit.org/iderudit/25248ac See table of contents Publisher(s) 24/30 I/S ISSN 0707-9389 (print) 1923-5097 (digital) Explore this journal Cite this article Païni, D. (2008). Pourquoi expose-t-on le cinéma? 24 images, (140), 48–51. Exposition Prenez soin de vous de Sophie Calle, présentée à Montréal en 2008 à la galerie DHC/ART Fondation pour l'art contemporain Pourquoi expose-t-on le cinéma ? par Dominique Païni Dominique Païni est théoricien du cinéma, critique, conservateur, program- mateur, commissaire d'exposition. Il a dirigé la Cinémathèque française de 1991 à 2000, puis a occupé le poste de directeur des projets multidisciplinaires du Centre Georges Pompidou à Paris, où il a été commissaire de plusieurs gran- des expositions: Hitchcock et l'art, coïn- cidences fatales; Jean Cocteau sur le fil du siècle; Voyage(s) en utopie, Jean- Luc Godard 1946-2006. Cette fonction l'a amené à engager une réflexion sur les diverses transformations que subissent aujourd'hui les images en mouvement, dont le déplacement du cinéma vers les salles d'exposition, exploré dans le texte inédit (rédigé en 2004) que nous publions ici, est une des manifestations. E n premier lieu, élargir induit que des monumental de l'écran. Effet paradoxal car écrans sont multipliés, combinés et la taille de l'écran dans ces cubes obscurcis synchronisés. En second lieu, l'élar- des expositions d'art contemporain est par- gissement découle de la proximité de l'écran fois moindre que le plus petit écran de la plus ges en mouvement aux cimaises d'un musée, du visiteur-spectateur. Cette proximité jusqu'à petite salle d'art et d'essai du Quartier latin. pour dire vite désormais : à la faveur du cinéma la tangibilité - inconcevable dans une salle Enfin, un élargissement d'une autre nature exposé. C'est Y élargissement de la position du traditionnelle de cinéma - engendre un effet se réalise à la faveur de la projection d'ima- visiteur à celle de spectateur. Positions qui Pourquoi expose-t-on le cinéma alors que des salles sont faites pour ça ? Pas d'exposition d'art contemporain respectable sans ces projections d'images lumineuses en mouvement... Au point que cela agace et lasse certains. Cela relève-t-il d'un effet de mode éphémère ou d'une tendance fondée par de vrais enjeux à l'égard d'un matériau nouveau et de questions esthétiques plus générales? Je crois qu'on a tout dit, presque tout dit aujourd'hui, à propos de l'exposition des images en mouvement. Mais sans doute n'a-t-on pas suffisamment insisté sur le fait que l'introduction du cinéma dans le musée revient à Vélargir en un triple sens et de manière paradoxale. 4 8 N ° 1 4 0 2 4 I M A G E S s'ajoutent et se conjuguent. Il y a quelques années, j'avais repris le terme de flâneur pour dire quelque chose de spécifique à propos de ce visiteur-spectateur, inédit Janus. Devant une projection installée dans un musée, le visiteur n'a pas l'obligation d'une vision bloquée telle que celle du spectateur ordinaire de cinéma. Il bouge et se prome- nant il élargit sa vision de l'image à la mesure de sa plus ou moins grande proximité de l'écran. De véritables travellings avant ou arrière sont opérés par le visiteur-spectateur lui-même et se conjuguent avec les mouve- ments internes de l'image projetée. Si le cinéma a commencé son histoire de cette manière - des projections qui n'assi- gnaient pas de place immobile au spectateur dans les expositions universelles du début de siècle par exemple - il contraignit en revanche durant près de 80 ans à un dispo- sitif théâtral. Les premières salles de cinéma apparues vers 1907-1908 après la période foraine, période qui offrait encore une rela- tive instabilité au spectateur, se nommaient des théâtres cinématographiques. C'est ce qui fait retour depuis une ving- taine d'années environ et de manière insis- tante dans les musées et les expositions d'art contemporain : un spectateur primitif revient, ayant survécu au dispositif contraignant du spectacle cinématographique; un spectateur mobile doté d'une vision variable de la gran- deur de l'écran et enclin non pas à se confondre avec l'existence fictionnelle de personnages ou à se fondre illusoirement dans l'espace d'un décor, mais à entrer dans l'image. Sans doute, cette liberté physique reconquise n'est-elle qu'un leurre tant elle correspond, d'une certaine manière, à une époque de reflux des utopies collectives et de valorisation de l'in- dividu consommateur de publicité et d'art. Le cinéma est l'art d'un siècle de dictatures et de collectivismes, machine à représenter la foule pour un public constitué en foule. Le cinéma muet fut une sorte d'énigme pour le spectateur tenu en respect devant l'image. Puis le cinéma classique sonore laissa supposer que des secrets se tenaient derrière les images. Le cinéma moderne de l'après- guerre s'acharna à convaincre que les images n'étaient que des images. Enfin, le cinéma post-moderne, publicitaire ou exposé, met en œuvre des procédures - vitesse et saccade de montage, illusions de profondeurs réinventées grâce à l'infographie, manipulations du réel enregistré -, procédures qui invitent à entrer dans les images. Bien que marqué tous les deux par l'aspi- ration dans les images, le cinéma exposé en dehors de sa finalité non mercantile, se distin- gue totalement du cinéma publicitaire, par sa particularité d'échapper au site de la salle ou aujourd'hui de l'écran de la télévision domes- tique. Il rivalise avec la plasticité picturale grâce à la possibilité désormais interminable de la projection par boucles répétitives permise par le disque numérique. Et il n'est pas sans saveur, que d'une certaine manière, le cinéma exposé contribue à conserver statistiquement dans l'art contemporain la dominante de la verticalité plastique face à un nombre croissant d'œuvres horizontales, au sol, étirées sur des praticables ou sous des vitrines, etc. Plutôt qu'exposé, on pourrait qualifier ce cinéma, en détournant Jean-François Lyotard, de figurai. C'est-à-dire un cinéma qui, pour reprendre les mots de Lyotard, est non interprétable mais seulement traversa- ble. En effet, la caractéristique du plus grand nombre de séquences d'images en mouvement projetées aujourd'hui au sein d'un parcours muséal, véritables films courts qui pour- raient être aussi bien projetés dans des salles de cinéma traditionnelles, relève fréquem- ment d'un enchaînement dramaturgique singulier, d'une logique représentationnelle dérangée- mini-récits inachevés, fictions sans clôture narrative - qui diffèrent, qui suspen- dent l'interprétation et l'identification. Alors que, paradoxalement, une telle installation de ces images favorise plutôt l'intégration, l'ab- sorption, l'aspiration environnementale du spectateur. Quelque chose affronte et invite à la fois à traverser les images, y compris des œuvres conçues en référence au cinéma et à ses conventions, par des artistes dont on sait la fascination pour l'univers cinémato- graphique et sa puissance hypnotique et iden- tificatrice. Alors qu'est-ce qui invite à traverser les représentations de Salla Tykkà, de Pipilotti Rist ou de Stan Douglas? Roland Barthes, qui ne connut pas notre contemporain cinéma exposé en musée, dans un texte bien intitulé « En sortant du cinéma», décrivit un utopique spectateur doté de deux corps en un, spectateur qu'il rêvait d'être et chez lequel j'entends un écho de mon visiteur-spectateur: «un corps nar- cissique qui regarde, perdu dans le miroir proche, et un corps pervers prêt à fétichiser non 1 image, mais précisément ce qui I ex- cède : le grain du son, la salle, le noir, la masse obscure des autres corps, les rais de la lumière, l'entrée, la sortie; bref pour dis- tancer, décoller, je complique une relation par une situation. » N'est-ce pas ce que réalisent ou ce que permettent les cinéastes qui exposent ou les artistes plasticiens qui filment? Ils compli- quent une relation (l'interprétation) par une situation (la traversée), dont l'enjeu serait en définitive d'échapper à la fiction tout en la percevant comme présente, objectivée, en quelque sorte exposée justement. Il ne s'agirait plus alors d'un régime de représentation pour ce cinéma (car il s'agit bien de cinéma même si la relation hypnotique est en effet compliquée comme dit Barthes par une situation critique du spectateur. Il s'agirait d'un régime de présentation, de mise à distance, l'affirmation de la séquence comme tableau, mais un tableau fait de durée qui s'écoule, fait avec du temps. Mais qu'est-ce qui accentue dans l'instal- lation de ces images mouvantes exposées, cet effet de présentation plutôt que de repré- sentation? Exposition Prenez soin de vous de Sophie Calle (2008) à la Bibliothèque nationale de France à Paris N ° 1 4 0 24 I M A G E S 4 9 En premier lieu, je l'ai déjà dit, la proximité de l'écran et celle d'images en mouvement, qui s'exposent à être traversées parce que tellement proches. L'envie du visiteur- spectateur de traverser les images s'accroît, s'élargit. C'est uploads/s3/ paini-dominique-pourquoi-expose-t-on-le-cinema.pdf
Documents similaires








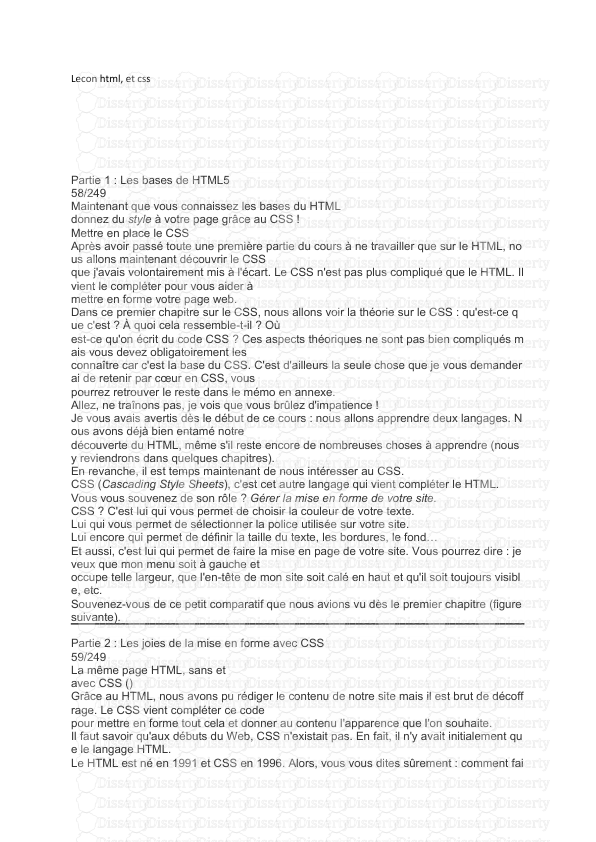

-
79
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 17, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.8706MB


