O R G A N E D U G R O U P E I N T E R N A T I O N A L « C E R C L E E T C AL R
O R G A N E D U G R O U P E I N T E R N A T I O N A L « C E R C L E E T C AL R R É » R É D A C T I O N ET A D M I N I S T R A T I O N : 5 R U E K L É B E R — V A N V E S - S E I N E ( F R A N C E ) NUMERO 3 — 30 JUIN 1930 P A R A I T SI X F O I S L ’AN PRIX DE CE NUMERO : 3 FRS A B O N N E M E N T : FRANCE ET COL. : 20 FRS ETRANGER: 30 FRANCS P O E T I Q U E N O U V E L L E I-a littérature est une chose et la poésie est une autre chose. Il y a entre la littérature et la poésie un écart aussi grand qu’entre l’architecture et la sculpture, écart qui consiste en ceci : que la littérature tout comme l'archi tecture est en fonction d’un but pratique, est dépendante de circonstances particulières (politiques, sociales, économiques, atmosphériques, même psy chologiques), est déterminée par des données imprévisibles accidentelles. . et, ensuite seulement, établie esthétiquement suivant les lois immuables de la logique et de l’ordre, — tandis que la poésie, comme la sculpture, ne dépend d’aucune donnée pratique ou préconçue et ne fait que répondre aux exigences de ces lois immuables aux moyens desquelles on peut atteindre à ce qui est l’objet de toute oeuvre artistique : l’équilibre, l’unité. Loin de moi cependant de vouloir élever délibérément la poésie au-dessus des autres genres littéraires. Car il est clair, qu’on peut atteindre à l’art et à la perfection esthétique par n’importe quels moyens ....pourvu qu’on mette l’étoffe ! La poésie — du fait de ne dépendre que des seules valeurs esthé tiques — n’est qu’une chose beaucoup plus simple, beaucoup plus modeste et beaucoup plus directe, disons «facile» si vous voulez, que les autres genres littéraires (tel que le journalisme par exemple qui est fort complexe, mais qui, à travers sa complexité, se développe magnifiquement pour de venir «la» littérature de l’avenir). La poésie n’emploie que les éléments primaires du langage humain : le son, le rythme, le mot., dépouillé bien entendu de l’ornement des phrases et de l’atmosphère dont essaient de l’entourer le sujet et l’idée particulière. Mais pourquoi cette simplifi cation extrême, cette totale mise à nu ? Parce que sans ce retour aux sources et à la simplicité premières il est imposible — surtout après les inextricables complications de l’art des 40 dernières années — d’atteindre une plus-value définitive de l’art baroque issu de la Renaissance, une plus- value qui, par sa volonté d’ordre et de simplicité, surclasse nettement les innombrables aspects du déformisme surréaliste et de l’art snob internatio nal, réalise clairement et pour la première fois, l’unité, l’équilibre en soi tels que notre sensibilité et notre intelligence d’hommes du vingtième siècle nous permettent de le concevoir et de le désirer. Et voilà bien ce qui distingue notre époque de celles qui l’ont précédée : mécanisation, esprit de synthèse. On mesure la force, la vitesse. On conserve la lumière, la chaleur, le froid et la force motrice, on les distribue, on les dose. Tout est systématiquement réduit à sa plus simple et plus forte expression, à son entité première, pure de parasites et de fanfreluches inutiles, gênantes. Ce qui avant peu n’était encore que moyen, force mystérieuse, est devenu pour nous une valeur claire, subtile, saisissable, une existence effective réalisée en soi. Je m’explique : la vitesse par exemple, qu’on ne pouvait concevoir que cachée sous les symboles du cheval ou du vent, qui s’ex primait aussi par le mouvement précipité, épuisant, des membres du corps hufnain, est devenue pour nous une entité toute nouvelle, qui, grâce au moteur, possède une existence pour soi, entièrement isolée de la nature animale. On ne se rend pas encore compte, spirituellement du moins, de l’importance de ces choses. Et c’est ainsi que l’on peut dire que l’auto et l’avion ont, à cause de leur naissance brusque et de leur rapide développement, un siècle d’avance sur la plupart de nos contemporains. Mais je ne parle pas ici de ceux qui font l’ histoire d’une époque, de ceux qui contribuent à lui former une attitude spirituelle. En art, une même brusque conscience de la valeur de l’abstraction : ce qui dans toute l’histoire de l’art n’avait été qu’un moyen habituel, employé de façon plus ou moins visible, pour rehausser l’expression, la force du sujet : le rythme, l’équilibre, la recherche d’une unité, la sub- struction géométrique... est de venu^ pour nous l’art même et tout l’objet de l’œuvre. Car nous savons, et on le découvre quoti diennement autour de nous, que tout ce qui forme la valeur art ou esthétique dans l’œuvre dite d’art de tous les temps, n’est précisément que l’intuition (au jourd’hui la conscience) de ces facteurs universels du beau : le rythme, l’unité, l’équlibre. Et 100 fois par jour nous avons l’occasion de voir dans la vie citadine — et même dans la vie champêtre — les multiples ma nifestations de cette conscien ce, qui se précise, se clarifie et prend un large essor en se basant sur les données honnêtes et sans capri ces de la science, la connaissance vérifiée. Cela ne veut pas encore dire que la connaissance des mathématiques implique la capacité d’écrire des poèmes ou de peindre un tableau. Mais de toute façon la «Tour Eiffel», dans sa simplicité, vaut mieux et plus que les vers de Monsieur François Coppée qui, avec tant d’intellectuels et artistes, en son temps célèbres, avait jeté l’anathème sur la Tour en raison de son « in qualifiable laideur » . Et de nos jours encore un pont de Fraissinet, ou ses hangars d’Orly, contiennent plus d’art vrai que les écrits de vrais poètes dans la revue « Sagesse » , « Le Divan » , « Les Marges » ou « Montparnasse » . Ce n’est pas sans raison qu’il devient ridicule aujourd’hui de parler de poésie, qu’il faut quelque courage pour oser la défendre . N’y a-t-il pas Maurice Rostand sur la place avec toute la lignée des poètes délicats et des fils à papa ! Il n’est cependant pas impossible d’écrire des poèmes qui apportent quelque chose de vivant et de frais à l’esprit de l’époque et qui nous permettent de jouir des éternelles beautés du rythme verbal et de la sonorité d’une langue, mais à condition, d’être aussi simple et aussi direct que l’ingénieur qui ne fait usage que de matériaux solides pour arriver par le chemin le plus court à l’unité la plus stable : sinnge sannge sinnge sannge sinnge sannge sinnge sannge— sinnge— sannge— sinnge—sannge—song song váillance vaillance vaillance sinng vaillance Tout dans le poème est synthèse : efforts vers l’intensité du rythme par l’opposition aussi totale que possible des mots-sons ; volonté d’unité de l’ensemble par l’organisation des données et leur développement lo gique dans le temps, sinon leur répétition simple, cadencée : paralélioma— endicité oh — oh paralélioma— endicite oh — oh paralélioma— endicité oh — oh oh — oh Le poème étant ‘une tranche harmonisée du rythme universel où le concept maintient l’unité indivisible, le poème n’étant donc que syn thèse, il ne pourra pas être jugé par comparaison, car il n’est évident que par lui-même. Il échappe ainsi à toute critique littéraire, à toute analyse étrangère à son auteur. En effet, le poème n’a-t-il pas passé par toutes les phases de l'analyse, du calcul mental abstrait, du sens cri tique propre à l’auteur lui-même, qui, à son tour, n est que le résultat du développement constant de son éducation rythmique, de son évo lution graduelle jusqu’à l’instant de la production du poème ? fanny voilà l’eau voilà l’eau à ma gauche voilà l’eau à ma gauche octavie voilà l’eau l’eau à ma gauche et à ma droite et à ma gauche droite une octave oh phénoménie oh vache oh ficelle f aux-phili-photogène hermanee adolphe lucrèce oh proserpine oh prose oh finistère ou fanny franche fleur Un poème, une œuvre d’art, constitue une approximation infini tésimale de l’unité indivisible, de l’harmonie absolue. Seul l’auteur, s’il est conscient — c’est-à-dire s’il domine son oeuvre et ne se laisse pas aller aux pires désordres de l’instinctif — connaît toutes les données du concept, les chiffres de la pensée, si je puis dire, qu’il a organisées, transformées, clarifiées dans l’élaboration de l’œuvre. Le critique pro fessionnel, le docte homme de lettres, partant à la recherche d’intentions inexistantes, de secrets impénétrables, de sensations troublantes et va gues, fera toujours fausse route... en poésie comme en tout art. Le rôle du critique en de telles choses devrait se limiter à « recevoir » sage ment l’oeuvre uploads/s3/ cercle-et-carre-n03.pdf
Documents similaires


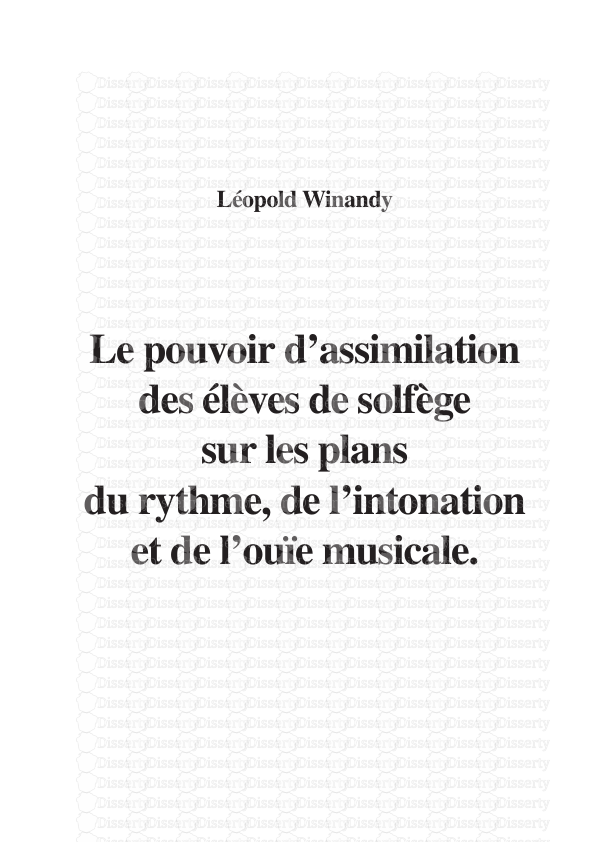
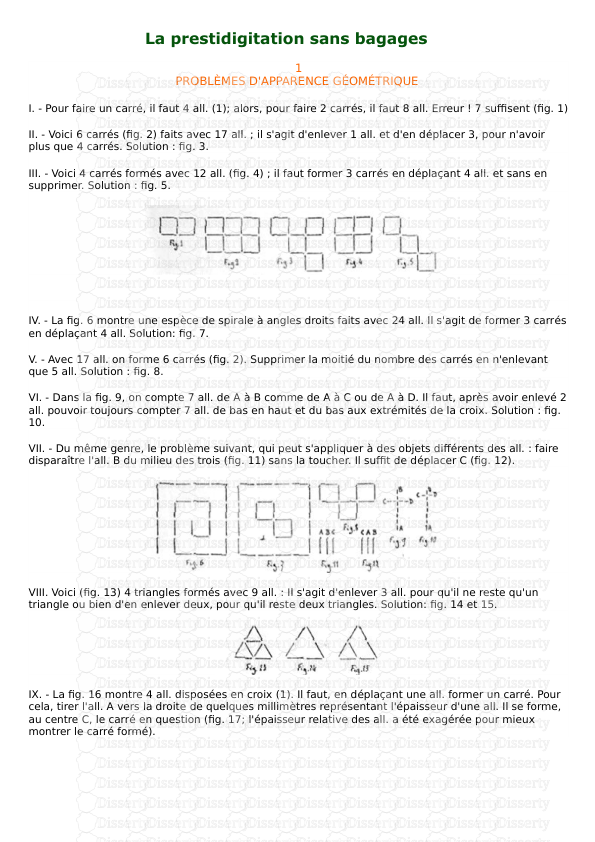






-
79
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 11, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 3.6682MB


