UNIVERSITE PARIS-NORD - VILLETANEUSE Centre d'Etudes Littéraires Francophones e
UNIVERSITE PARIS-NORD - VILLETANEUSE Centre d'Etudes Littéraires Francophones et Comparées LE RETOUR DU RECIT DANS LES ANNEES 1980 Oralité, jeu hypertextuel et expression de l'identité chez T. Ben Jelloun, R. Mimouni, F. Mellah, V. Khoury-Ghata et A. Cossery Thèse de doctorat nouveau régime présentée par Sarra CHERIF épouse GAILLARD sous la direction de Monsieur le Professeur Charles BONN Membres du jury : Mmes Camille LACOSTE-DUJARDIN (présidente) et Beïda CHIKHI MM. Charles BONN, Dominique COMBE et Abdallah MDARHRI ALAOUI OCTOBRE 1993 à la mémoire de Lilia et Sahbi à Olivier à mes parents LE RETOUR DU RECIT DANS LES ANNEES 1980 Oralité, jeu hypertextuel et expression de l'identité chez T. Ben Jelloun, R. Mimouni, F. Mellah, V. Khoury-Ghata et A. Cossery Je remercie M. Charles BONN de m'avoir fait confiance tout au long de ce travail; Mme Beïda CHIKHI pour ses conseils amicaux et avisés, ainsi que pour sa sollicitude qui m'a été précieuse dans les moments de doute; M. Dominique COMBE, M. Marc GONTARD, M. Jean-Jacques LUTHI d'avoir accepté de me lire et de me critiquer et M. Jean DEJEUX pour tous les documents qu'il a bien voulu me confier. Je remercie Mme Camille LACOSTE-DUJARDIN et M. Abdallah MDARHRI ALAOUI d'avoir bien voulu faire partie de mon jury. Je remercie tous ceux qui ont bien voulu m'accorder des entretiens, en particulier M. Jamel Eddine BENCHEIKH, M. Bernard LECHERBONNIER, M. Yves GONZALEZ-QUIJANO, le poète Tahar BEKRI, M. Abdallah BOUNFOUR, M. Robert JOUANNY, M. Jean-Louis JOUBERT, M. Othman BEN TALEB et M. Sobhi HABCHI. Je remercie également pour leur aide Mme COEZ, Virginie, Ghazi, Samir, Amel et Jalel. Enfin, je n'oublie pas tout ce que je dois à mon mari pour la réalisation de ce travail. INTRODUCTION GENERALE 8 A ) Retour au récit, oui mais à quel récit ? Parler de retour au récit suppose qu'il y a déjà eu abandon ou rupture avec ce même récit. Où et quand ? Dans quel espace et dans quel temps ? C'est ce qu'il faut sans doute préciser avant de présenter l'étude à la fois narratologique et comparative qu'on propose de faire ici de cinq textes du Maghreb et du Machrek : - Maroc : La nuit sacrée1 de Tahar Ben Jelloun - 1987. - Algérie : L'honneur de la tribu2 de Rachid Mimouni - 1989. - Tunisie : Le conclave des pleureuses3 de Fawzi Mellah - 1987. - Liban : Bayarmine4 de Vénus Khoury-Ghata - 1988. - Egypte : Une ambition dans le désert5 d'Albert Cossery - 1984. Le divorce avec le récit classique ou "prémoderniste"6 (XIXe siècle) - avec tout ce qu'il suppose : "la linéarité, la rationalité, la conscience, la causalité, l'illusionnisme naïf, le langage transparent, l'anecdote innocente et les conventions morales des classes moyennes"7 - remonte en effet aux grands modernistes du début du XXe siècle, autrement dit à Eliot, Joyce, Kafka pour ne citer que ceux-ci; mais aussi en France à Proust d'abord, Robbe-Grillet, Butor et Sarraute plus tard. Dans ce qu'on appelle sans conteste aujourd'hui la littérature maghrébine de langue française, les premiers signes de ce refus de la représentation et de la linéarité classiques remontent à 1956, puisqu'ils sont déjà perceptibles dans un "texte fondateur"8 de cette littérature, à savoir Nedjma9 de Kateb Yacine. Lequel - pour reprendre les termes de Charles Bonn - se 1 Paris, Seuil, 1987. 2 Paris, Robert Laffont, 1989. 3 Paris, Seuil, 1987. 4 Paris, Flammarion, 1988. 5 Paris, Gallimard, 1984. 6 John Barth appelle prémodernisme, le réalisme bourgeois traditionnel. Cf., "La littérature du renouvellement", Poétique, Paris, Seuil, n° 48, novembre 1981, page 401. 7 Cf., John Barth, idem, page 402. 8 Cf., Charles Bonn, "Le jeu sur l'intertextualité dans L'Insolation de Rachid Boudjedra", Littératures du Maghreb, Itinéraires et contacts de cultures, volume 4 - 5, Paris, L'Harmattan, 1984. 9 Paris, Seuil, 1956. 9 situe "d'emblée dans l'avant-garde du roman international"10. Ici, "la perception du temps, qui n'est plus le temps linéaire de roman réaliste, conditionne la construction d'ensemble du roman"11. Mais Kateb, certes précurseur de ce point de vue, n'est pas le seul à avoir disloqué le temps et brouillé la représentation. D'autres romanciers l'ont fait après lui, non pas par simple mimétisme mais parce que dans les années 1960 le roman réaliste faisait déjà figure en France de "vulgaire recette"12, de "formule morte", bref "de forme poncive"13. Parmi ces écrivains, citons pour illustration Mohammed Dib, Mohammed Khaïr-Eddine, mais aussi plus tard Abdelwahab Meddeb dont le roman Talismano14 est devenu depuis synonyme de discontinuité et de fragmentation. Depuis les années 1980, on assiste pourtant à une résurgence du récit en roman malgré la persistance de quelques éléments de recherche dans les textes narratifs. Les écrivains "se font [alors] moins "narratologues" et plus volontiers "narrateurs" "15. Tahar Ben Jelloun, Rachid Mimouni, Fawzi Mellah, Vénus Khoury-Ghata font partie du deuxième groupe. Leurs textes qu'on étudie ici s'inscrivent dans ce qu'on propose d'appeler la tendance "néo-narrative", c'est-à-dire une mouvance nettement marquée par la réconciliation avec la narration et un retour en force du récit dans les textes, non plus classique (balzacien) mais traditionnel tel qu'en témoignent les traditions orale et écrite arabo-berbères. La présence dialectale en leurs romans, la convocation des maîtres de l'art de conter, la citation même de ces maîtres de la parole dans leurs textes, bref leur imitation (sérieuse) par ces écrivains les érigent du coup en modèles d'écriture. Ces modèles on propose de les regrouper sous le terme générique de "modèle ancestral". Il recouvre à la fois les genres narratifs oraux tels le conte, la fable et la légende, et des textes sacrés ou profanes tels Le Coran et Les Mille et Une Nuits. A l'exception d'Albert Cossery parodiant dans Une ambition dans le désert un modèle exogène cette fois - le roman policier, T. Ben Jelloun, R. Mimouni, F. Mellah, V. Khoury-Ghata pastichent (en régime sérieux) Le Coran, Les Nuits, les ruwats (conteurs populaires) ou encore les chroniqueurs. Que signifie cela ? S'agit-il d'une simple coïncidence ou bien d'une nouvelle tendance dans le roman arabe de langue française ? Pourquoi le pastiche respectueux16 du modèle ancestral ? 10 Cf., Charles Bonn, Kateb Yacine. Nedjma, Paris, PUF, 1990, coll. "Etudes littéraires", page 23. 11 Cf., Charles Bonn, idem, page 24. 12 Cf., Alain Robbe-Grillet cité par Beïda Chikhi, Problématique de l'écriture dans l'oeuvre romanesque de Mohammed Dib, Alger, Office des publications universitaires, janvier 1989, page 23. 13 Cf., Beïda Chikhi, idem, page 23. 14 Paris, Christian Bourgois, 1979. 15 Cf., Claude Roy cité par M'hamed Alaoui Abdallaoui, "Entraves et Libération. Le roman maghrébin des années 80", Dix ans de littératures, 1980 - 1990 : 1. Maghreb - Afrique noire, Notre librairie, n° 103, octobre - décembre 1990, page 18. 16 Cela risque de paraître paradoxal si l'on s'appuie sur la définition génettienne du pastiche (Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Seuil, Paris, 1982, coll. "Poétique") mais on le justifiera dans l'introduction à la troisième partie en s'appuyant précisément sur les textes ici étudiés. 10 Pourquoi le pastiche au dépens de la parodie précisément, dans le cas des quatre écrivains cités plus haut ? Cela a-t-il un rapport avec la problématique de l'identité ? En d'autres termes, peut-on voir à travers la réécriture plus ou moins fidèle de ces modèles endogènes d'autrefois, les traces d'une quête ontologique ? Là réside une grande problématique à laquelle on essaiera de répondre à la fin de ce travail. Pourquoi maintenant ces cinq textes et ces cinq écrivains précisément et non pas d'autres ? 11 B ) Justification d'un choix 1 ) Choix du corpus Si le choix a porté sur ces cinq romans, c'est parce qu'ils ont plus d'un point commun, outre la langue française élue ici comme langue d'expression et d'écriture : a ) D'abord ils font partie de la tranche chronologique sur laquelle - dès le début de la recherche - on a choisi de se pencher, à savoir les années 1980. On dira en ce sens que ce travail se veut une approche synchronique de la littérature arabe de langue française. b ) Le deuxième point commun est le genre narratif dans lequel ces textes s'inscrivent : roman ou récit; mais aussi cette tendance "néo-narrative" qu'ils partagent, à l'exception d'Une ambition dans le désert dont l'auteur n'a jamais rompu avec la narration traditionnelle. Rappelons qu'avant d'écrire des romans17 A. Cossery a écrit des recueils de contes dont le plus connu est Les hommes oubliés de Dieu18. c ) La présence d'une écriture mimétique dont la portée s'avère avoir un lien avec la problématique de l'identité, est le troisième point commun à ce corpus de textes. d ) Enfin, les cinq romans font partie des deux aires culturelles sur lesquelles on a également choisi de s'intéresser dès le début de ce parcours; à savoir le Maghreb et le Machrek qui ont bien des points communs aussi. - Une pluralité de langues : l'arabe classique et dialectal, le français, l'hébreu, etc. - Une pluralité de cultures : berbère (Maghreb), phénicienne, arabe, juive, turque, française, etc. - Une pluralité de religions uploads/s3/ cherif-ep-gaillard.pdf
Documents similaires




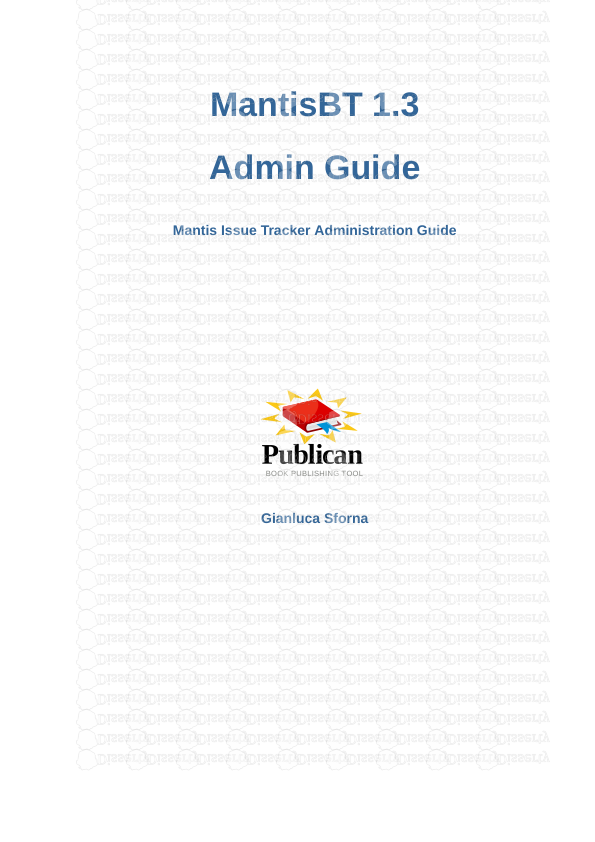





-
75
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 08, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.9836MB


