L'APPRENTISSAGE TRAGIQUE DE ZARATHOUSTRA Roberto Machado Éditions Léo Scheer |
L'APPRENTISSAGE TRAGIQUE DE ZARATHOUSTRA Roberto Machado Éditions Léo Scheer | « Lignes » 2002/1 n° 7 | pages 284 à 297 ISSN 0988-5226 ISBN 2914172346 DOI 10.3917/lignes1.007.0283 Article disponible en ligne à l'adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.cairn.info/revue-lignes1-2002-1-page-284.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour Éditions Léo Scheer. © Éditions Léo Scheer. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) © Éditions Léo Scheer | Téléchargé le 01/03/2022 sur www.cairn.info (IP: 81.26.204.249) © Éditions Léo Scheer | Téléchargé le 01/03/2022 sur www.cairn.info (IP: 81.26.204.249) ROBERTO MACHADO L’APPRENTISSAGE TRAGIQUE DE ZARATHOUSTRA S’il est une bonne façon de comprendre le projet inscrit dans Ainsi parlait Zarathoustra, c’est sans doute de le situer par rapport à La Naissance de la tragédie, le premier ouvrage de Nietzsche. On décèle deux objectifs principaux dans La Naissance de la tragé- die: la critique de la rationalité conceptuelle instaurée par Socrate et Platon, et la présentation de l’art de la tragédie, expression des pulsions artistiques dionysiaque et apollinienne, comme alternatives à la rationalité. Antinomie entre art tragique et métaphysique ration- nelle qui signifie deux choses: l’une suivant laquelle le « socratisme esthétique » a subordonné le poète au théoricien, au penseur ration- nel, et a considéré la tragédie comme irrationnelle, comme un compromis de causes sans effet et d’effets sans cause; l’autre suivant laquelle l’art tragique, avec sa musique et son mythe propres, peut ouvrir la voie à des questions fondamentales de l'existence et peut, en la transfigurant, aller jusqu’à justifier le « pire des mondes ». Mais cette analyse de la naissance et de la mort de la tragédie est effectuée tout entière en fonction de l’actualité. En ce sens, La Nais- sance de la tragédie a un troisième objectif, sans lequel ce livre ne peut être pleinement compris: celui de dénoncer le monde moderne en tant que civilisation socratique et de mettre au jour la conception tragique du monde présente dans certaines manifestations culturelles de la modernité. 284 © Éditions Léo Scheer | Téléchargé le 01/03/2022 sur www.cairn.info (IP: 81.26.204.249) © Éditions Léo Scheer | Téléchargé le 01/03/2022 sur www.cairn.info (IP: 81.26.204.249) Où Nietzsche trouve-t-il des présages du « réveil progressif de l’esprit dionysiaque »? Dans la musique et dans la philosophie. D’une part, dans la musique de Bach, Beethoven et Wagner – surtout celle de Wagner, le grand inspirateur de ses analyses. D’autre part, dans les écrits de Kant et de Schopenhauer – qui auraient jailli des mêmes sources dionysiaques que la musique et qui auraient anéanti le socra- tisme en mettant le doigt sur ses limites. Quinze ans plus tard, en août 1886, Nietzsche écrit un important « Essai d’autocritique » en préface à La Naissance de la tragédie. Par cette autocritique, il entend relever l’importance et la nouveauté du problème central abordé dans l'ouvrage: pour la première fois, une analyse réalisée dans l’optique de l’art tragique tient la rationalité scientifico-philosophique pour suspecte. Cependant il considère La Naissance de la tragédie comme « étrange », « difficile », « problé- matique » et même « impossible ». Pourquoi ? Pour deux raisons complémentaires. L’une porte sur le contenu; l’autre, sur le style, la forme d’expression. La critique faite au contenu porte principalement sur les deux grands inspirateurs de la première philosophie de Nietzsche: Wagner et Schopenhauer. Ainsi Nietzsche se plaint-il d’avoir compromis l’analyse du problème grec en le liant au moins grec de tous les mouvements artistiques, celui de Wagner, musicien maintenant réputé comme romantique, c’est-à-dire comme l’opposé d’un diony- siaque. Et dénonce-t-il, de la même façon, les formules kantiennes et schopenhaueriennes utilisées dans cette analyse pour exprimer la nouvelle interprétation qu'il proposait. La critique faite au style a trait à l’incompatibilité existante entre le contenu de la dénonciation – la mort de la tragédie par le savoir rationnel – et l’expression de la dénonciation – le langage dans lequel celle-ci est formulée. C’est que « cette âme nouvelle », qui était déjà la sienne à ce moment-là, n’aurait pas dû se servir d’un langage systé- matique et conceptuel pour faire, au détriment de la rationalité, l’apo- logie de l’art tragique: « elle aurait dû chanter ». « Quel dommage 285 © Éditions Léo Scheer | Téléchargé le 01/03/2022 sur www.cairn.info (IP: 81.26.204.249) © Éditions Léo Scheer | Téléchargé le 01/03/2022 sur www.cairn.info (IP: 81.26.204.249) que je n’aie pas osé dire en poète ce que j’avais alors à dire: j’en aurais peut-être été capable! » Si la tragédie naît du chœur tragique et meurt parce qu’elle perd l’esprit de la musique dès qu’elle est subordonnée au concept, un livre comme La Naissance de la tragédie, qui compte faire la démonstration de ces deux thèses de façon conceptuelle, ne serait-il pas, du point de vue de la forme de l’expression, plus proche du rationalisme socratique que de la poésie tragique, même s’il a l’in- tention de se ranger aux côtés de cette dernière? En se posant cette question dans sa préface de 1886, Nietzsche – alors dans la dernière période de sa création philosophique – relève une fois de plus l’antagonisme entre discours rationnel et art tragique. Mais en même temps et surtout, il met le doigt sur une diffi- culté à laquelle se heurte toute philosophie qui, comme la sienne, revendique une perspective tragique, et a donc besoin de s’exprimer dans un langage approprié à une telle vision du monde: un langage artistique et non pas scientifique, figuré et non pas conceptuel. Mais, si cette difficulté ne lui semble plus insurmontable, cela doit principalement à Ainsi parlait Zarathoustra, achevé un an auparavant et dont il parle, au début du chapitre « Par-delà Bien et Mal » du Ecce Homo, comme de l'aspect de sa philosophie qui dit oui. N’est-il pas symptomatique que l'« Essai d’autocritique » se termine sur un extrait de ce premier livre parlant de la joie tragique, juste après que Zara- thoustra s’est fait traité de « démon dionysiaque »? Je pars de l’hy- pothèse que Ainsi parlait Zarathoustra est le chant que, en 1886, Nietzsche regrettait de n’avoir pas chanté dès son premier ouvrage, et qu’y transperce sa tentative la plus radicale d’éviter que la lutte contre la raison se fasse par le truchement d’une forme de pensée soumise à la raison. Quant au contenu, Zarathoustra occupe une position singulière dans l’œuvre de Nietzsche, au sens où c’est là qu’apparaissent les thèmes les plus originaux de sa philosophie : « nihilisme », « surhomme », « volonté de puissance », « éternel retour »… Mais la position singulière du Zarathoustra réside surtout dans la volonté de 286 © Éditions Léo Scheer | Téléchargé le 01/03/2022 sur www.cairn.info (IP: 81.26.204.249) © Éditions Léo Scheer | Téléchargé le 01/03/2022 sur www.cairn.info (IP: 81.26.204.249) réaliser l’adéquation entre contenu et expression, volonté qui fait de ce livre à la fois un livre de philosophie et une œuvre de l’art, en quoi il est permis de le considérer comme le point culminant de la philo- sophie tragique de Nietzsche. Cette singularité stylistique du Zarathoustra se manifeste surtout de deux façons: 1. par le glissement d’un langage conceptuel vers un langage poétique; 2. par le déplacement d’un langage systématique vers un langage construit sous une forme narrative et dramatique. Ainsi parlait Zarathoustra est l’œuvre d’un philosophe, et même la plus importante de ses œuvres. Mais une œuvre dont la dichotomie art-philosophie, que l’on trouve dénoncée dans La Naissance de la tragédie – avec la critique du socratisme –, ainsi que dans l'« Essai d’au- tocritique » – avec la critique du style conceptuel auquel obéit encore La Naissance de la tragédie – est neutralisée par le projet de faire de la poésie le moyen de présentation d’une pensée philosophique non conceptuelle et non démonstrative. Ainsi parlait Zarathoustra est à celui et pour celui qui, là où il peut deviner, déteste déduire; à celui et pour celui qui n’accorde que peu de valeur à ce qui doit être prouvé. Considérer Zarathoustra comme un chant revient à dire qu’en lui le mot chante de par sa musicalité propre. Si Zarathoustra est musique, c'est que ce livre marque la renaissance de l’art d’écouter, l’éloquence redevenue musique par le retour du langage à la nature de l’image. Ne serait-ce pas cela qu’indique Ecce Homo? Et cette idée ne serait-elle pas en continuité avec les affirmations contenues dans Crépuscule des idoles et Le Gai savoir, où il est dit qu’écrire, c’est danser avec la plume, que le plus grand souhait d’un philosophe est d’être un bon danseur? La structure de l’œuvre est uploads/s3/ lignes1-007-0283.pdf
Documents similaires







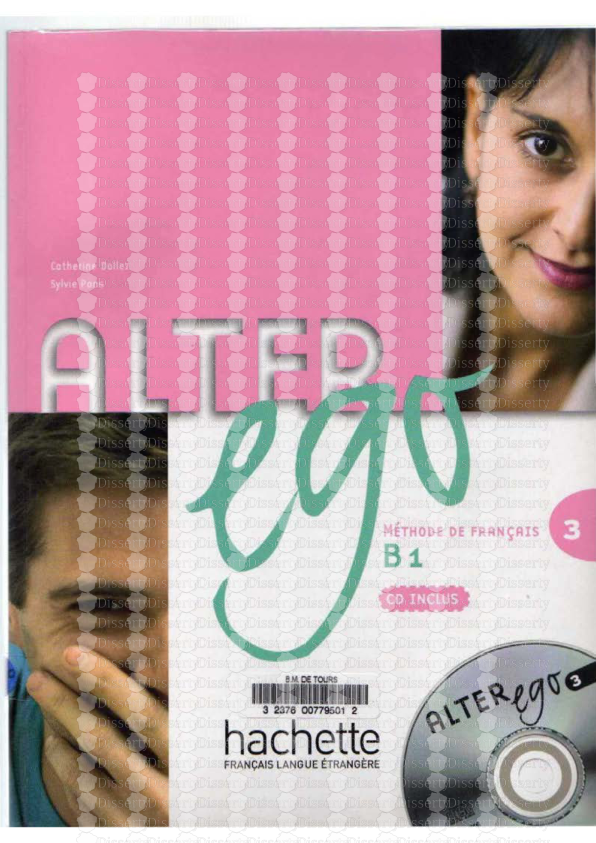


-
66
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 06, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3672MB


