TRAITÉ NUMISMATIQUE DU MOYEN AGE TRAITÉ DE NUMISMATIQUE DU MOYEN AGE PAR Arthur
TRAITÉ NUMISMATIQUE DU MOYEN AGE TRAITÉ DE NUMISMATIQUE DU MOYEN AGE PAR Arthur ENGEL ANCIEN MEMBRE DES ÉCOLES FRANÇAISES DE ROME ET D'ATHÈNES ET Raymond SERRURE TOME TROISIÈME DEPUIS l'apparition DU GROS d'aRCENT JUSQU'a LA CRÉATION DU THALER J14 illustrations dans le texte ARNALDO FORNI EDITORE BOLOGNA (ITALY) A^^« LI3RARY ocrs -û3 Propriété letteraria e artistica riservata Monsieur Guillaume FRŒHNER Hommage de respectueux dévouement QUATRIÈME PARTIE CHAPITRE PREMIER LE ROYAUME DE FRANCE DEPUIS L'APPARITION DU GROS D'ARGENT ET DE LA MONNAIE D'OR SOUS LOUIS IX JUSQU'A CELLE DES TESTONS SOUS LOUIS XII Sources: Les ouvrages cités dans notre troisième partie, p. 555. — A. de Bar- thélémy, Les monnaies de France sous saint Louis, étude insérée dans Saint Louis par H. Wallon. Paris, 1878, pp. 495-525. —M. de Marchéville, Le denier d'or àl'agnel, dans la Revue numismatique àc 1889. — M. de Marchéville, Le rapport entre l'or et l'argent au temps de saint Louis, dans VAnnuaire de la Société française de numismatique, 1890. — M. de Marchéville, Le denier d'or à la reine, dans la Revue numismatique de 1889. — L. Blancard, Du rapport deVor à l'argent sous saint Louis et ses succès- / ^,Z f seurs, dans VAnnuaire de la Société française de numismatique, 1890. — L. Blancard, La réforme monétaire de saint Louis, dans les Mémoires de l'Académie de Marseille, 3 -^7 1888-92. — Vuitry, Les monnaies et le régime monétaire de la monarchie féodale, de Hugues Capet à Philippe le Bel. Paris, 1876, in-8. — Vuitry, Les monnaies sous Philippe le Bel et ses trois fils. Paris, 1879, in-8. —Vuitry, Les monnaies sons les trois premiers Valois. Paris, 1881, in-8. — E. Boutaric, La France sous Philippe le Bel. Élude sur les institutions politiques et administratives du Moyen dgc. Paris, 1861, in-8. 1-. de Saulcy, Recueil de documents relatifs îi l'histoire des monnaies frappées par les rois de France depuis Philippe II jusqu'il François I. Paris et M.icon, 4 vol. in-4, 1879-0.7. — Y'.àQ?>i\i\cy,Eli'ments de l'histoire des ateliers monétaires du royaume de Franse depuis Philippe-Auguste jusqu'à François I. Paris, 1877, in-4. — F. de Saulcy, H^s.^vie monétaire de Jean le Bon, roi de France. Paris, 1880, in-4. — E. de Saulcy, JIiy\-:i;- numismatique de Henri V et Henri VI, rois d'Angleterre, pendant qu'ils ont régné en France. Paris, 1878, in-4. — N. de Wailly, Mémoire sur les variations de la livre m. 60 CJ 946 QUATRIÈME PARTIE tournois, dans les Mémoires de VAcadémie des Inscriptions et Belhs-Lettres, t. XXI. Communications de M. de Marchéville et de M. le comte H. de Castellane. § I. — Louis IX (1226-1270). Les échanges se réglaient, au royaume de France, depuis les premiers efforts d'unification monétaire faits par Philippe-Auguste, suivant deux systèmes de compte: en monnaie parisis et en monnaie tournois. Ces deux systèmes avaient, l'un et l'autre, pour base le denier dont 1 2 for- maient un sou, et dont 240 (ou 20 sous) formaient une livre; mais le denier de chaque système et ses divisions : demi-denier, jnailleon obole, existaient seuls comme monnaie réelle ; la livre et le sou n'étaient que des monnaies abstraites. Au commencement du xiii« siècle, 68 deniers parisis formaient l'équivalent de 100 deniers tournois. Sous Louis IX, ce rapport tomba jusqu'à 80 : 100, c'est-à-dire à 4 : 5, probablement par suite de l'usure progressive des deniers parisis mis en circulation '. Deniers de billon, tournois ou parisis, étaient de bien faibles instru- ments pour satisfaire aux exigences croissantes du commerce. Louis IX résolut de compléter la série des monnaies réelles par l'adjonction d'espèces d'argent et d'or. Son règne marque, à ce point de vue, une date capitale dans l'histoire du monnayage, non seulement en France, mais dans l'Europe entière où son système fut adopté ^. M. de Barthélémy a exposé les mesures successives prises par Louis IX dans la réorganisation du monnayage après son retour de sa première croisade (12^4). En 1262, le roi rendit à Chartres l'ordonnance interdisant l'imitation des types royaux par les feudataires. A partir de 1263 on ne devait plus se servir dans ses terres ni dans les fiefs dont les seigneurs n'avaient pas le droit de battre monnaie, que de tournois, de parisis et de deniers de Laon ou lovesiens. Cependant, eu égard à la disette du numéraire, Louis IX permettait de se servir de deniers bretons et angevins courant sur le pied de 5 pour 4 tournois, de deniers mançois courant sur le pied de i pour 2 angevins, enfin, d'esterlins, monnaie 1. P. 308, ligne 20, une faute d'impression nous a fait dire que 4 deniers tournois valaient s deniers parisis, alors qu'il fnut lire le contraire; au surplus, il y a lieu de rectifier ce que nous avons écrit dans cet alinéa, conformément à ce que nous disons ici. 2. Cf. sur les imitations dont le gros tournois fut l'objet: J. Chautard, Imitations des monnaies au type du gros tournois, dans la Revue belge de numismatique, 1872, p. 31»} et suiv. — Menadier, Deutsche Mûn^en, t. IV, 11 etsuiv. LE ROYAUME DE FRANCE 947 d'importation anglaise, valant 4 tournois, la plus forte espèce d'argent de cette époque. Dans le système de compte en usage, et suivant lequel 12 deniers formaient un sou, l'esterlin représentait exactement le tiers du sou tournois de compte. C'est au Parlement de la Toussaint 1265 que nous voyons supprimer le cours de l'esterlin; il devait finir à la mi-aoùt suivante: « et veut le Roy et commande que estellins ne querrent à nul pris en son royaume dès la mi-août en avant, fors à pois et à valeur de l'argent. » Cette même année, Louis IX rachète, au prix de 40 livres parisis, aux héritiers d'Henri Plartrard, le privilège, concédé en 1225, de graver les coins de la monnaie parisis dans tous les ateliers du royaume situés en deçà de la Loire. La suppression du cours de l'esterlin, le rachat du droit de graver les coins de la monnaie parisis, font pressentir une réforme importante : la création d'un sol tournois effectif, le gros tournois, et la frappe d'une monnaie d'or. M. de Barthélémy, auquel nous empruntons une partie de ce para- graphe, a cru pouvoir fixer l'apparition du gros tournois au 1 5 août 1 266, époque indiquée pour la cessation du cours des esterlins. Elle doit avoir eu lieu plus tôt, si nous nous en rapportons au texte suivant cité par M. de Saulcy, d'après les archives de la Monnaie, et daté du 24 juillet 1266 : « D'ung marc de Roy, d'autel argent et d'autele finance comme est la nouvelle touche ou neuf exemplaire que le Roy a fait et establi, ne serontfaits que 58 deniers du marc desusdit, et chascun des deniers desusdit^ seront pesés en tele tnaniere que le plus fort et le plus feble ne s'eslongera du droit pois que chascun doit peser plus de deux grains..., et serontJlaonne^ et 7nonnoie^ en tele manière que nul malicieus ne les puisse tondre ne limer apris mis hors... » Ce texte est pour nous la véritable ordonnance créatrice du gros tournois taillé à 58 au marc. La modification de la taille des ^en^'ers tournois consista en la substi- tution de la taille de 220 pièces au marc à celle de 217 pièces au marc, ' que des textes positifs de 1251 et 1255 permettent d'attribuer à ces espèces antérieurement à la réforme. Le gros tournois de Louis IX était à 1 1 de- niers 12 grains d'aloi, c'est-à-dire à ^ d'argent fin. Les deniers tournois étaient de 5 deniers 18 grains. On soupçonnait depuis longtemps que l'idée de la réforme devait être venue à Louis IX à la vue des monnaies arabes pendant son séjour en Egypte et en Terre-Sainte. Un savant, auquel la numismatique du moyen âge est redevable de nombreuses observations importantes, M. Louis Blancard, a montré que le gros tournois n'est, sous le rapport du type, qu'une imitation du dinar d'or (ou sarra^inas) frappé, de 1251 948 QUATRIÈME PARTIE à 1257, par les Chrétiens à Saint-Jean-d'Acre '. Le module des deux monnaies est le même ; sur l'une comme sur l'autre, on voit au revers deux légendes concentriques, la première marginale, empruntée à un texte sacré, l'autre intérieure, aux nom et titre du roi, et commençant toutes deux par une croisette. Le gros tournois a pour type principal un chàtel tournois entouré des mots traditionnels TVRONVS CIVIS et d'une bordure de douze fleurs de lis placées dans autant d'oves. Le revers, directement inspiré par la pièce d'or arabe, porte, autour d'une croix, la légende : BNDICTV: SIT:NOMF:DNIiNRIIDEIMHV:XPI. tracée en caractères superbes (fig, 1456). Son poids moyen est de 4e^,o^. Comme le gros d'argent, le denier d'or de Louis IX, créé vraisembla- blement à la même date (1266), se distingue par la perfection de la gra- vure, l'élégance extrême des lettres taillées en biseau et à arêtes vives, par la beauté du style qui laisse en arrière toutes les autres monnaies du moyen âge. Il n'est pas mentionné dans les textes contemporains, mais son attribution uploads/s3/ traite-de-numismatique-du-moyen-age-t-iii-depuis-l-x27-apparation-du-gros-d-x27-argent-jusqu-x27-a-la-creation-de-thaler-par-arthur-engel-et-raymond-serrure.pdf
Documents similaires


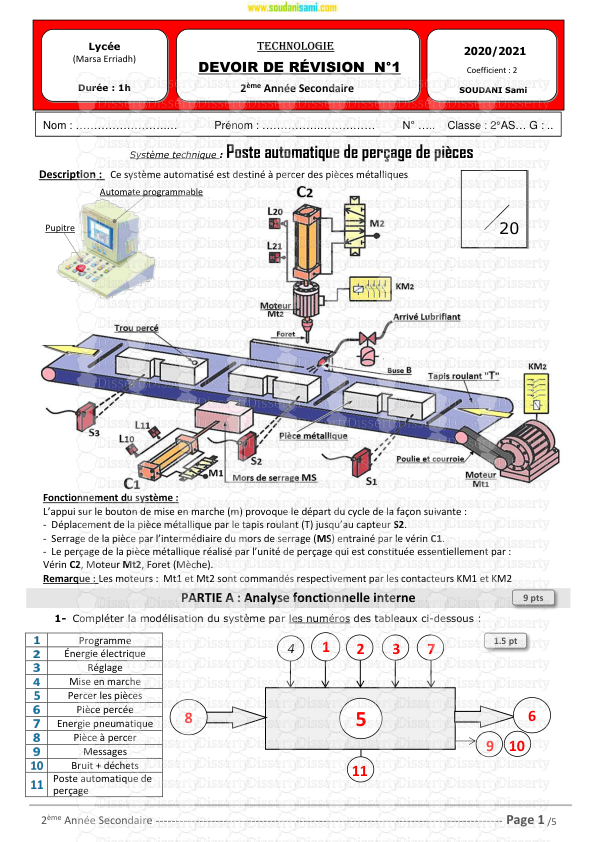



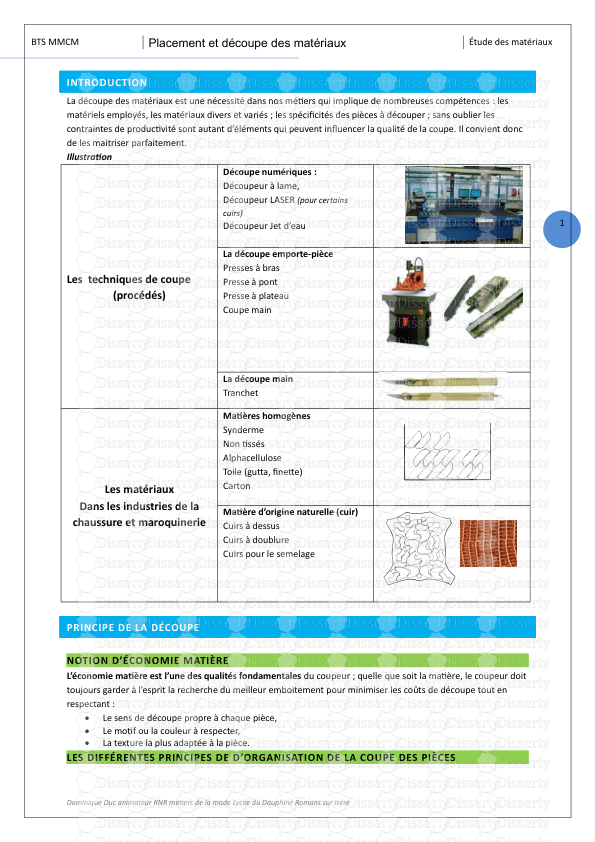



-
31
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 04, 2023
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 29.3059MB


