Aurélien Cantou DNSEP 2012 QUAND LE DESSIN EST EN MARGES QUAND LE DESSIN EST EN
Aurélien Cantou DNSEP 2012 QUAND LE DESSIN EST EN MARGES QUAND LE DESSIN EST EN MARGES Aurélien Cantou QUAND LE DESSIN EST EN MARGES Le developpement de l’imagination aux limites de la page Mémoire de DNSEP option illustration Réalisé sous la direction de Olivier Deloignon, chargé de cours en histoire et culture du graphisme, du livre et de l’image. DNSEP 2012 7 Je remercie mes professeurs, Olivier Deloignon, Guillaume Dégé, Marianne Roth et Gaëtan Dorémus. Ce mémoire est dédié à mon camarade de marges Renaud, aux cours de français et de solfège, ainsi qu’à mes parents pour leur soutien sans faille. © Aurélien Cantou / H.E.A.R. 2012 La couverture est constituée de dessins de George Pérec, Marc Bell, André Masson, Raymond Queneau, Benoît Jacques, Jochen Gerner, Saul Steinberg, Louis Soutter, et Aurélien Cantou. 3.1 UNE MARGE ÉTENDUE 3.2 D’UNE PRATIQUE MARGINALE VERS UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE 3. DU MYTHE A LA RÉALITÉ LES MARGES CHEZ LES DESSINATEURS ICONOGRAPHIE BIBLIOGRAPHIE TABLE DES ILLUSTRATIONS CONCLUSION Table des matières QUAND LE DESSIN EST EN MARGE INTRODUCTION 1.1 LA MARGE SCOLAIRE 1.2 LES IMAGES DANS LES MARGES DU MOYEN ÂGE 1. LA MARGE, UN POSITIONNEMENT SPÉCIFIQUE 2.1 DE LA PRATIQUE DE L’ÉCRITURE À LA FORME DESSINÉE 2.2 LES ÉCRIVAINS ET LES PENSEURS 2. PARTIE INTÉGRANTE D’UN CHEMINEMENT DE PENSÉE 17 21 31 35 45 50 57 11 61 94 96 QUAND LE DESSIN EST EN MARGES 11 « Le style du jeune Napoléon est déclamatoire…La vue de ces travaux précoces me rappelle mes fatras juvéniles…mais je ne faisais pas aux marges de petites maisons, des dessins d’enfant, des barbouillages d’écolier comme on voit aux marges des brouillons de Bonaparte. » François-René de Chateaubriand1 INTRODUCTION « Dès son plus jeune âge, il dessinait dans les marges de ses cahiers ». Combien de fois a-t-on lu cette phrase en introduction de la biographie d’un dessinateur ? Le mythe des marges semble être intégré à une vision globale de l’artiste, sous la forme d’un enfant ou d’un jeune qui affiche sa différence, plus indiscipliné que bon élève ou bien plus rêveur que travailleur. Ayant moi-même commencé par dessiner dans les marges, je me suis aperçu que je rentrais dans ce type de clichés. J’en suis alors venu à me demander quelle était la part de vérité dans ces idées reçues, et pourquoi cette action-là était consi dérée comme révélatrice de quelque chose, d’un talent ou d’un positionnement spécifique. En me penchant sur ces questions, je me suis vite rendu compte que la marge de l’écolier était seulement une partie de ce à quoi l’idée de marge renvoie. Il était nécessaire de défi nir et retracer le parcours de la marge dans un sens plus global pour faire apparaître une continuité, en dégager les fondements et les concepts transmis au fil des âges. Montrer que l’acte de dessiner au sein de cet espace précis s’inscrivait dans une longue tradition de l’histoire du manuscrit, du livre et de l’art. Le dictionnaire2 définit la marge dans son sens premier comme un « espace blanc laissé autour ou simplement d’un seul côté d’un texte manuscrit ou imprimé ». C’est en premier lieu de cette marge-là dont il sera question au cours de ce texte, en extrapolant éventuellement dans le domaine des Beaux-Arts. En effet, l’« espace de papier libre, en principe non travaillé, autour d’un dessin, d’une gravure » est aussi une marge. L’exis tence de la marge est intimement liée à celle de l’écriture et de son support. Mais sa réelle origine, et en particulier la faculté d’y loger des dessins ou des illustrations, remonte en fait à l’invention du codex3. Antérieurement, les rouleaux contenaient des colonnes 1 Mémoires d’Outre Tombe, tome 1, p. 684, «La Pléiade», Paris, Gallimard, 2011. 2 Dictionnaire Larousse, Paris, 2011. 3 Hélène Toubert, «L’illustration marginale» in Mise en page et mise en texte du livre manuscrit, sous la direction de Henri-Jean Martin et Jean Vezin, Paris, Éditions du Cercle de la Librairie-Promodis, 1990, p. 399. QUAND LE DESSIN EST EN MARGES 12 13 INTRODUCTION d’écritures qui en se succédant, laissaient un espace très réduit entre elles, empêchant d’y rajouter quoi que ce soit sans en altérer la lisibilité. Les codices, de par une justification du texte plus établie, laissèrent un espace latéral assez large pour permettre à des com mentaires — scholies — de compléter le manuscrit souvent après sa rédaction. La glose du XIe et du XIIe siècle reste cependant principalement interlinéaire, et c’est véritable ment au XIIIe siècle qu’apparaissent les marges de dimensions idéales pour commencer leur exploitation. La marge interne est souvent condamnée à subir un rétrécissement dû à la reliure, mais la marge externe devient le terrain propice à l’annotation et surtout à l’imaginaire, car correspondant à la définition susmentionnée d’un espace blanc syno nyme de liberté. On peut distinguer ainsi avec la naissance de ce type de manuscrits, trois caracté ristiques significatives de la présence de marges, pour le lecteur, l’éditeur et le fabricant. La première, nous l’avons évoqué, est cet avantage pratique et ergonomique qu’offrent les marges au texte, cette faculté de pouvoir le lire tout en y inscrivant des remarques, gloses ou commentaires. L’annotation est une pratique courante de lecture, utile à la progression de la pensée et à la compréhension des écrits antérieurs. Elle permet ainsi d’instaurer un dialogue entre le lecteur et un penseur des temps anciens et d’avoir deux points de vue. L’un central, et l’autre avec un recul occasionné par son positionne ment dans le temps et dans l’espace. Le second rôle important joué par la marge, c’est la lisibilité qu’elle offre au texte. Plus le blanc tournant est conséquent, plus le texte prend de l’importance et se trouve mis en valeur. C’est d’ailleurs à partir de cette considération esthétique que plus tard, les éditions de luxe agrandiront leurs marges, la composition et l’art de la mise en page devenant alors des éléments clés de la reconnaissance de la beauté d’un livre. Pour bien comprendre cette pratique, cette manière de concevoir le livre est à mettre en parallèle avec la peinture. La marge apparaît en effet comme le cadre d’un texte lui-même devenu tableau4. C’est cette notion de sublimation du texte qui aura sans doute séduit les moines enlumineurs, qui disposaient justement de textes sacrés à mettre en valeur et à honorer de leur mieux. C’est ainsi que dès l’époque médiévale, ils ont l’intuition de compléter leur art de l’enluminure jusqu’ici limité aux lettrines, par l’art de l’ornementation marginale, 4 François Marotin, introduction de La Marge, Actes de colloque (1986), publications de la Faculté de Lettres et Sciences humaines de Clermont- Ferrand, 1988, pp. VI-VII. Le fait de considérer le cadre du tableau comme la marge de la peinture (c’est- à-dire le raisonnement inverse) est une question abordé dans le chapitre « Marges », in Victor Stoichita, L’Ins- tauration du tableau, Genève, Droz, « Titre Courant », 1999, pp.53-99. afin de placer le message divin au centre de toutes les préoccupations. Une troisième fonction de la marge justifie sa présence dans un livre, d’ordre beau coup plus technique : son absolue nécessité dans la fabrication du livre, puisque la reliure, plus ou moins gourmande, a besoin de manger une partie de la marge originelle de la page. L’existence de la marge et son développement à travers les âges traduisent la réu nion de préoccupations à la fois intellectuelles, esthétiques et techniques. Le fait de dessiner dans cette marge, telle que nous venons de la définir, n’est pas dénué de sens, et n’est pas non plus reservé aux seuls mauvais élèves. L’objectif principal de ce texte sera de mettre en lumière ce que j’appelle le «dessin dans les marges». Je procederai en dressant une liste de catégories de dessins de natures et d’époques très différentes, dont je tenterai de dégager un certain nombre de points communs au-delà de leur position limitrophe, afin d’esquisser une définition personnelle de cette pratique. Pour la première fois, le dessin dans les marges sera abordé comme une thématique à part entière, sans se focaliser sur un type de dessin marginal particu lier, et sans tomber trop rapidement dans l’extrapolation vers la marge dans son sens le plus large, surtout quand on s’aperçoit que tout est forcément en marge de quelque chose d’autre. En essayant de lier les différents éléments iconographiques de ce corpus et en étu diant les mécanismes dont ils sont la cause, nous en arriveront au questionnement central de ce mémoire, qui est de se demander si les dessins dans les marges ne sont pas finale ment une manière originale et spécifique de penser et de créer. Enfin, pour un mémoire d’option illustration, je trouvais intéressant de parler d’un sujet qui à la fois nous concerne tous, nous parle tous, et qui en même temps relève certai nement d’un intérêt mineur par rapport à l’illustration telle qu’elle est perçue aujourd’hui, et telle que je l’exercerai je l’espère, après cette période d’étude. 1. LA MARGE, UN POSITIONNEMENT SPÉCIFIQUE QUAND LE DESSIN EST EN MARGES 17 « Mon pauvre Guy Degrennes, uploads/s3/ cantou-aurelien-pdf.pdf
Documents similaires







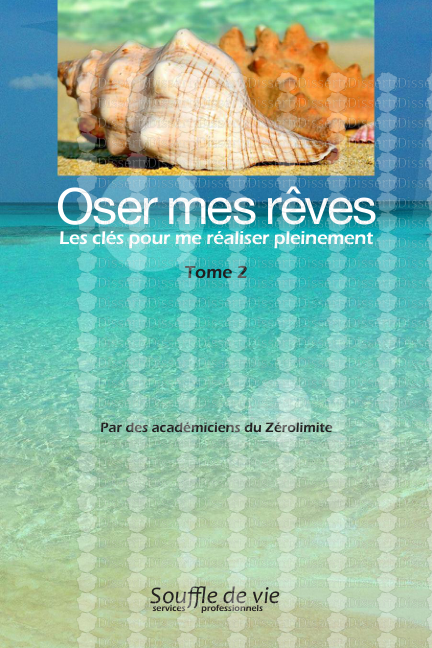


-
34
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 04, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 24.7691MB


