Anne-Laure Ecole normale supérieure de Lyon MARANDIN 2011-2012 Du texte à l’ima
Anne-Laure Ecole normale supérieure de Lyon MARANDIN 2011-2012 Du texte à l’image : illustration, adaptation et interprétation de Gargantua et Pantagruel par des dessinateurs du XXe siècle. Mémoire de master 2 Littérature comparée Sous la direction de Michel Jourde Et Henri Garric 2 Remerciements : Je tiens à remercier mes deux directeurs, M. Henri Garric et M. Michel Jourde, pour leurs précieux conseils. Je remercie également vivement mes professeurs de classe préparatoire, M. Olivier Gosset, M. Jean-Louis Ravistre et M. Pierre Giuliani, pour leurs belles et avisées lectures de Rabelais. 3 Introduction L’histoire éditoriale1 des œuvres de Rabelais2, le nombre des réécritures de l’œuvre et le fait qu’elle ait constitué une source d’inspiration pour de nombreux artistes nous signale combien elle fut, est, et continuera sans doute d’être perçue comme une gageure interprétative, son aspect polymorphe fécondant la recherche aussi bien que les pratiques artistiques. De fait, à travers les siècles, l’œuvre de Rabelais a été invoquée, souvent à tort semble-il, pour accréditer de nombreuses pratiques, de même qu’elle a été reprise, corrigée, illustrée, pastichée, adaptée pour certains publics, etc. Ainsi l’œuvre engendre-t-elle un discours au questionnement toujours renouvelé, qu’il soit celui des chercheurs ou celui des artistes : au fil du temps, le corpus rabelaisien s’éclaire de différentes manières et continue d’être fréquemment ne serait-ce qu’évoqué par des artistes qui s’en réclament, dans des œuvres parfois sans aucun rapport apparent avec le texte même3. C’est peut-être que l’œuvre pose problème, comme nous le signale le seul titre de l’ouvrage de Michel Jeanneret consacré à la question de l’interprétation de l’œuvre de Rabelais : Le Défi des signes : Rabelais et la crise de l’interprétation à la 1 A ce sujet, et à celui, plus généralement, de la réception de Rabelais à travers les âges, nous nous référerons essentiellement aux ouvrages de Marcel de Grève : La Réception de Rabelais en Europe du XVIe au XVIIIe siècle, Etudes réunies par Claude de Grève et Jean Céard, Paris, Champion, 2009, et de Marie-Ange Fougère : Le Rire de Rabelais au XIXe siècle, histoire d’un malentendu, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 2009. Nous renvoyons également à l’ouvrage collectif placé sous la direction de Paul J. Smith : Editer et traduire Rabelais à travers les âges, Amsterdam – Atlanta, Editions Rodopi, 1997. 2 Nous travaillerons essentiellement sur les textes de Gargantua et Pantagruel, même si des allusions pourront être faites aux autres livres à l’occasion de l’étude de la bande dessinée de Dino Battaglia, qui adapte, en un seul volume, l’ensemble des cinq livres. Nous utilisons quant à nous l’édition Pléiade : François Rabelais, Œuvres complètes, Mireille Huchon (éd.), Paris, Gallimard, 1994. Pour pouvoir facilement identifier cette édition par rapport aux éditions illustrées sur lesquelles nous travaillons, nous ferons figurer (Pléiade) à côté du titre de l’ouvrage désigné. 3 Les Songes drolatiques de Pantagruel, dont nous parlerons par la suite, sont un bon exemple, au cœur même du XVIe siècle, de la réutilisation du nom de Rabelais à travers l’évocation d’un de ses personnages. Il s’agit d’un petit recueil de cent vingt gravures attribuées à Rabelais avant d’être attribuées à Desprez, et qui figurent, au fil des pages, de petits personnages ressortissant à l’esthétique grotesque. Nous utiliserons pour référer à cet ouvrage d’une part l’édition de Michel Jeanneret : Les Songes drolatiques de Pantagruel, éd. Michel Jeanneret, Genève, Droz, 2004, et d’autre part une édition plus ancienne qui assortit les gravures de notes explicatives qui renvoient au texte de Rabelais : Les Songes drolatiques de Pantagruel, où sont contenues cent vingt figures de l’invention de maître François Rabelais, copiées en fac-similé par Jules Morel sur l’édition de 1565, pour la récréation des bons esprits, avec un texte explicatif et des notes par le Grand Jacques, Paris, éd. Eric Losfeld – Le Terrain Vague, Paris, 1869. 4 Renaissance4. On se place ici au-delà de l’idée d’œuvre ouverte5, qui peut recouvrir, dans une acception large, un ensemble d’œuvres très diverses, dont l’œuvre de Rabelais. Il semble en effet que cette dernière présente une spécificité qui amène à relancer sans cesse l’interprétation, qu’il s’agisse d’un refus de conclure, de se positionner définitivement par rapport à une esthétique ou à une doctrine, ou d’un code à décrypter selon des règles celées au lecteur. Les avis sont partagés sur cette question du type d’interprétation commandée par l’œuvre de Rabelais, qu’il nous faudra éclaircir6. Adaptation en bande dessinée et illustration font partie de ces créations qui se greffent sur le texte originel. Si ces deux pratiques sont très différentes par leurs démarches, elles partagent cependant une volonté de représentation picturale de ce qui fascine : dans notre cas, l’univers gigantal propre à l’œuvre de Rabelais, et plus généralement l’univers rabelaisien, qu’il soit véritablement celui des textes ou celui forgé au cours des siècles par l’imaginaire collectif. En effet, il apparaît, comme plaquée sur l’œuvre, de manière presque entendue, l’idée d’un Rabelais en moine paillard narrant d’un ton leste des aventures plus ou moins grivoises. Pour mettre en images cette œuvre problématique du point de vue de l’interprétation, les œuvres de notre corpus procèdent de différentes manières, avec différentes intentions. Certaines font hommage à l’œuvre source, d’autres épousent l’irrévérence rabelaisienne jusqu’à faire preuve d’irrévérence envers l’œuvre rabelaisienne même, certaines semblent supposer que l’image conjuguée à un texte revu et écourté permet de favoriser la réception de Rabelais par un public enfantin, d’autres peut être ne cherchent qu’à jouer avec l’œuvre rabelaisienne, à la déployer dans l’image de manière ludique ; les démarches sont donc variées et nombreuses, celles que nous énonçons n’étant qu’une partie de ce que l’on peut observer. Cette diversité nous amène à nous interroger sur les pratiques des artistes au regard de leur rapport à l’œuvre de Rabelais. 4 Michel Jeanneret, Le Défi des signes, Rabelais et la crise de l’interprétation à la Renaissance, Orléans, Paradigme, 1994. 5 Voir Umberto Eco, l’Œuvre ouverte, 1962, Paris, Seuil, 1965. 6 Voir François Rigolot, Les Langages de Rabelais, 1972, Genève, Droz, 1996, p. *1 : « Si l’interprétation de l’œuvre de Rabelais a suscité de tout temps des querelles parmi les doctes, c’est sans doute le sens du Prologue de Gargantua qui fait l’objet, depuis vingt-cinq ans, des plus apres controverses. Non seulement la fameuse invitation à « rompre l’os » et à « sugcer la sustantificque mouelle » a été remise en cause mais le geste interprétatif de l’auteur lui-même s’est trouvé soumis à une exégèse qui a eu pour effet d’en problématiser singulièrement la lecture ». De manière générale, c’est l’ensemble de l’œuvre de Rabelais, semble-t-il, qui confronte le lecteur à une entreprise interprétative dont les règles lui sont dissimulées. 5 Les œuvres que nous avons choisies7 sont en effet les suivantes, présentées chronologiquement : tout d’abord le premier volume de l’édition illustrée par Dubout8, qui comprend les textes de Gargantua et de Pantagruel, ensuite le deuxième volume de celle d’André Collot9, dans lequel figure uniquement Pantagruel, Gargantua et Pantagruel illustrés en deux albums distincts par Samivel10, celui qu’illustre André Derain11, la bande dessinée de Dino Battaglia12, qui comprend les cinq livres, et l’édition de Gargantua récemment illustrée par Ludovic Debeurme13. D’emblée, l’hétérogénéité du corpus apparaît, d’abord du fait du choix de l’une ou des deux œuvres, qui est le fait de l’artiste. Ainsi, Dubout, Collot14 et Battaglia se sont intéressés aux cinq livres, tandis que Samivel a choisi de n’illustrer en apparence que Gargantua et Pantagruel, alors que le volume intitulé Pantagruel inclut en fait également des passages extraits des trois autres livres. Debeurme n’a illustré, quant à lui, que Gargantua et Derain uniquement Pantagruel. Ces choix peuvent révéler quelque chose de la manière qu’a l’artiste d’appréhender le corpus rabelaisien. De même, la façon de présenter le titre et l’auteur de l’œuvre est différente selon les ouvrages, et recèle peut-être quelque intérêt lorsqu’on la met en rapport avec la pratique des dessinateurs. On observe en effet que certains de ces derniers 7 Afin de pouvoir facilement identifier ces différentes œuvres, nous les citerons toujours, au cours de notre développement, en faisant mention du nom de l’artiste qui les a mises en images. 8 Rabelais et Dubout, Gargantua et Pantagruel, tome I, 1931, Paris, Editions Michèle Trinckvel, réédition 1993. 9 François Rabelais, Gargantua et Pantagruel, illustrés de soixante-cinq eaux fortes en couleurs par André Collot, tome deuxième, Paris, Le Vasseur et Cie, 1933. 10 Gargantua d’après Rabelais, adaptation de Mad H. Giraud, Illustrations en noir et trichromie de Samivel, 1934, Paris, Delagrave, réédition 1975. Pantagruel d’après Rabelais, adaptation de Mad H. Giraud, Illustrations en noir et trichromie de Samivel, 1934, Paris, Delagrave, réédition 1975. 11 François Rabelais, Pantagruel, orné de bois en couleurs dessinés et gravés par André Derain, 1943, Genève, Skira, fac similé, vers 1970. 12 Battaglia & Rabelais, Gargantua et Pantagruel, 1980, St Egrève, Mosquito, 2001. Nous avons également utilisée l’édition italienne de 1993 : Battaglia & Rabelais, Gargantua & Pantagruel, Milano, Milano Libri, 1993. Malheureusement, l’édition originale de 1980, intitulée simplement Gargantua, et qui ne doit pas comprendre les cinq livres, n’a pas pu être uploads/s3/ memoire-m2-anne-laure-marandin.pdf
Documents similaires




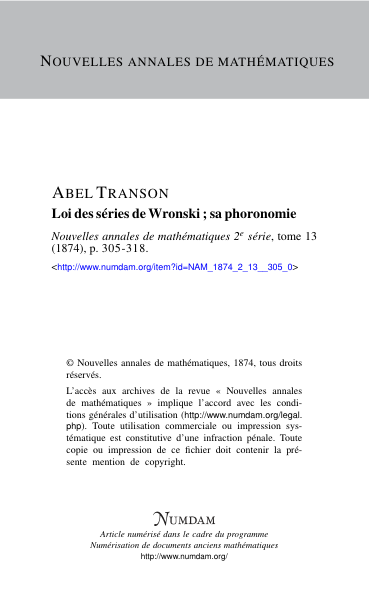





-
117
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 14, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 36.9944MB


