Lilian Bourgeat, G7, 1996 - œuvre de la collection du Frac des Pays de la Loire
Lilian Bourgeat, G7, 1996 - œuvre de la collection du Frac des Pays de la Loire Dans le cadre de sa mission de sensibilisation des publics à la création contemporaine et de formation des publics enseignants, le Frac des Pays de la Loire propose une approche d’œuvres - pour la plupart issues de sa collection - autour de la thématique : espace, mouvement et son dans la sculpture de la 2nde moitié du XXe siècle Liste non-exhaustive, cette sélection prend appui sur des œuvres historiques et ouvrent sur le travail de plus jeunes artistes. Traversant des problématiques diverses, les œuvres présentées dans ce document abordent la question de l’objet et du mouvement (de l’utilisation des nouvelles technologies au retour à un mécanisme précaire), de l’immatériel (le son et la lumière devenant des matériaux à sculpter), de la place du spectateur jusqu’à des notions transversales : le rapport à la musique Rock ou l’ouverture vers la notion de vitesse. Les œuvres mentionnées sont signalées lorsqu’elles appartiennent à la collection du Frac. Elles peuvent être le point de départ à un projet de formation, d’action de jumelage ou de visite avec le Frac. Une bilbiographie accompagne ce document, les ouvrages mentionnés étant, pour la plupart, disponibles à la documentation du Frac des Pays de la Loire. Frac des Pays de Loire La Fleuriaye, 44470 Carquefou www.fracdespaysdelaloire.com Espace, mouvement et son dans la sculpture de la seconde moitié du XXe siècle huuyggkjhkjhkhuhiuhiuhihiuhkhuiioo Les premières œuvres présentées ci-dessous permettent un ancrage historique. László Moholy-Nagy Le Modulateur-espace- lumière, 1930 La sculpture le Modulateur- espace-lumière de Moholy-Nagy symbolise l’aboutissement de ses diverses expérimentations artistiques des années 1920. Cette œuvre, formée de pièces de métal, de plastique et de bois, est constituée d’une variété de surfaces mates et lustrées. Un plan circulaire est divisé en trois sections égales, détenant chacune différents mécanismes, servant à élever des disques, faire tourner une spirale en verre et déplacer des drapeaux de métal. Tout l’ensemble effectue une rotation à toutes les quarante secondes et un ensemble de 116 lampes colorées de couleurs primaires et de rouge, bleu, vert et blanc est projeté sur la surface. Cette sculpture donne forme et mouvement à la lumière projetée sur les différentes surfaces. Moholy-Nagy fait la conception de cette première œuvre cinétique en 1922, mais ne la produit qu’en 1930, avec l’aide de l’ingénieur Stefan Sebök. Le Modulateur- espace-lumière devient le sujet abstrait d’un de ses films Jeu de lumière: noir- blanc-gris en 1930. L’artiste désignait sa sculpture comme la description de la transparence en action. Marcel Duchamp La Roue de bicyclette, 1913/1964 La Roue de bicyclette est souvent considérée comme le premier ready-made de Marcel Duchamp. Mais cette œuvre n’est pas encore un vrai ready-made puisque l’artiste y est intervenu en fixant la roue de vélo sur le tabouret. De plus, lui-même la définit plutôt comme une sculpture sur un socle, à la manière des œuvres de son ami Constantin Brancusi. Cette œuvre procède très vraisemblablement de l’humour bien connu de l’artiste, mais appartient aussi à une série de travaux sur le mouvement, récurrents dans son œuvre, depuis le Nu descendant l’escalier, 1912, jusqu’à son film Anemic cinema, 1925, ou les Rotoreliefs, 1935. Ainsi la Roue de bicyclette semble répondre à un réel intérêt pour le mouvement et sa capacité hypnotique. Alexandre Calder Cirque Calder, 1926-1931 Premier chef-d’œuvre de Calder, le Cirque est également une expérience centrale dans son œuvre : il s’inscrit dans la continuité de ses dessins réalisés à New York à partir de l’observation du mouvement des animaux et annonce, avec sa mise en mouvement d’objets à trois dimensions, les futurs mobiles. Les exercices d’équilibrisme et d’acrobatie de ses personnages sont des défis aux lois de la pesanteur et témoignent d’une pensée plastique fondée sur la tension entre équilibre et déséquilibre. Les personnages du Cirque sont réalisés à partir des matériaux les plus hétéroclites et les plus pauvres. Les têtes, les bras, les pattes sont en fil de fer. Les corps en capsules de bouteilles, bouchons de liège, bobines, boîtes de conserve, pinces à linge, étoffes de toutes sortes. Le goût de Calder pour le recyclage ne s’est d’ailleurs pas limité au Cirque. -------------------------- Nicolas Schöffer Tour de Liège, 1961 La Tour est une sculpture abstraite de 52 mètres de haut. Elle est composée d’une ossature portant des bras parallèles et de 64 plaques- miroir de formes et de dimensions différentes qui sont fixées sur 33 axes tournants. Chaque axe est entraîné par un moteur dont les vitesses sont variables. L’ensemble du dispositif est relié à un système électronique d’information et de mise en action constante. Des appareils tels que des microphones pour les bruits, des cellules photo- électriques pour la lumière, des prises thermiques et hygrométriques, des anémomètres envoyaient des informations à un cerveau électronique. Ce dernier déclenchait, en réaction, des combinaisons variées de mouvements, sons et lumières. L’enregistrement sur cinq bandes de différentes séquences musicales (percussions et bruits urbains retravaillés électroniquement) permettait la sonorisation de la Tour. Certaines parties de ces cinq séquences étaient superposées et provoquaient ainsi un déroulement sonore imprévu. La nuit, 120 spots multicolores, commandés également par le cerveau, éclairaient les pales miroirs qui renvoyaient la lumière. Les œuvres suivantes marquent l’abandon des idéologies progressistes et des croyances en la science et la technologie. L’utilisation du mouvement dans la sculpture est alors un retour sur l’homme, les artistes utilisant des matériaux de récupération, bricolés, petites mécaniques du réel. -------------------------- Christian Boltanski Le Théâtre d’ombres, 1986 Le Frac possède une autre œuvre de Christian Boltanski : Composition féerique, 1979 Inspiré du dispositif traditionnel des ombres chinoises, le Théâtre d’ombres apparaît dans l’œuvre de Christian Boltanski dès 1984, succédant aux grandes formes découpées des Compositions théâtrales (1980). L’ombre et sa projection associées au thème des marionnettes suggèrent de nombreuses évocations issues de toutes les cultures et mythologies - le Golem, la Kabbale, la caverne platonicienne, le récit des origines de la peinture chez les Grecs par le tracé des contours d’une ombre, la danse des morts des Mystères du Moyen Âge, l’impression photographique. Cette ouverture du sens, propre aux œuvres de Christian Boltanski, n’entame toutefois pas la dimension onirique et ludique de ce théâtre de marionnettes qui, en fonction des lieux dans lesquels il est dressé, s’anime selon une configuration à chaque fois renouvelée. Mona Hatoum Light Sentence, 1992 Le Frac possède une autre œuvre de Mona Hatoum : A Couple (of Swings), 1993 L’œuvre n’est plus conçue comme une forme statique, mais comme un champ traversé par un flux d’énergie. À l’objet clairement délimité dans l’espace se substitue un continuum en développement qui envahit l’espace environnant et se déploie dans le temps. C’est à ce mode de représentation que Light Sentence, 1992, de Mona Hatoum en appelle : dans un espace vide, au milieu d’une construction de casiers métalliques ajourés, une ampoule nue, actionnée par un moteur, monte et descend, projetant l’ombre mouvante des casiers sur les murs. Toutes les composantes du cinéma sont réunies, mais agencées différemment ; et comme dans l’expérience du cinéma, le visiteur perçoit le mouvement comme un principe de séparation entre l’ombre et la clarté. Richard Baquier Passion oubliée, 1984 œuvre de la collection du Frac des Pays de la Loire Grave et facétieuse à la fois, l’ensemble de l’œuvre de Richard Baquié joue avec les lieux communs et les poncifs, récupère, mêle, détourne les matériaux, les objets et les mots, leurs formes, leur propriété et leur sens. Utilisant à plein l’association, l’assemblage, le collage, il renouvelle ici le corps de la passion, qui pulse au rythme de l’eau parcourant ses veines de plastique. Courant fluide, circulation en boucle, l’installation s’obsède de cette répétition vitale, dans le ressassement circulaire du temps : une sorte de marmite bricolée et animée d’un moteur gère les flux, et comme un cœur, émet des sons. Le caractère organique et vivant de l’œuvre confirme sa puissance poétique : quoi de plus viscéral que la passion, quoi de plus humain aussi ? Patrice Carré 3,14116 variable, 1988 œuvre de la collection du Frac des Pays de la Loire “Dans mon travail, il y a constamment cette idée de décalage, de rupture d’échelle : l’énorme structure qui vient comme chapeauter quelque chose de tout petit, le train miniature qui ballade le son, la combinaison du mouvement giratoire va provoquer une réaction physique du son qui va s’échapper en enflant et en diminuant. (...) Le dôme en bois et le parquet renvoient bien sûr à l’architecture, une architecture sonore.” Rebecca Horn La petite veuve, 1988 œuvre de la collection du Frac des Pays de la Loire Dans La petite veuve, le mouvement des ailes noires est contrôlé par un moteur qui permet à l’éventail de plumes de se plier et se déplier avec une lenteur qui ressemble à un baillement. Sans faire appel aux effets spectaculaires de certaines de ses œuvres mécaniques, l’artiste suggère ici la violence latente de la veuve noire dont le personnage se dérobe au rôle que le cinéma et la littérature lui ont assigné : la uploads/s3/ frac-sculpture-et-mouvement.pdf
Documents similaires

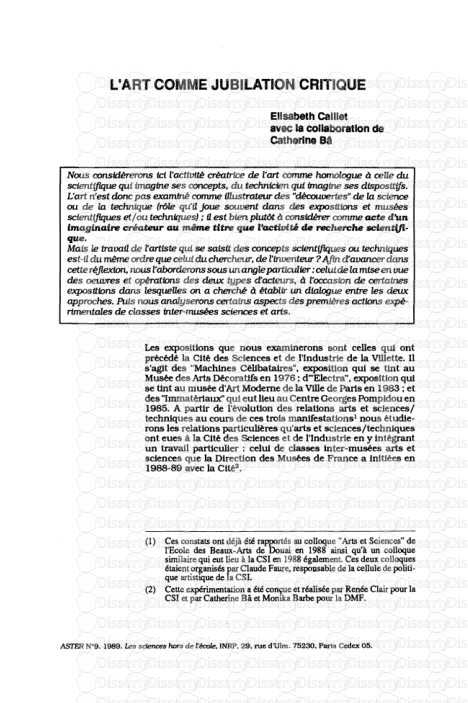








-
93
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 31, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3111MB


