R. Camus. 2010 1/14 « Work in progress. » Version brouillon d’un article comman
R. Camus. 2010 1/14 « Work in progress. » Version brouillon d’un article commandé par la revue Faits de langue. Il s’agit d’un des polycopiés distribués aux participant de l’atelier « Catégories linguistiques » que j’anime en année de Master (INALCO). Une synthèse de ces travaux et des matériaux diffusés de manière pour l’instant confidentielle sera proposée dans un colloque à suivre en septembre 2011 - sauf erreur ou catastrophe naturelle. Pour lire l’article « La phrase nominale » (E. Benveniste) Rémi CAMUS (INALCO / CNRS) Les problèmes soulevés dans ce texte ont trait aux notions de catégorie et de fonction dans l’étude des langues ; la question dont il hérite se formule comme un paradoxe : une présence – celle du verbe « être » – serait, dit-on, manifestée par son absence. C’est le paradoxe de la phrase nominale, que cet article souhaite résoudre. À la difficulté de cette question paradoxale s’ajoute un détail de présentation, en réalité un empêchement insupportable pour de nombreux lecteurs : la majorité des exemples grecs et latins sont livrés sans traduction. Et lorsqu’ils sont traduits, l’absence de translittération et de mot à mot rend souvent malaisée l’identification des séquences pertinentes (c’est aussi le cas de plus brèves séquences en d’autres langues). Dans les lignes qui suivent, ces éléments manquants ont été systématiquement rétablis, dans leur ordre d’apparition dans le texte. Le présent vade mecum, auxiliaire à la lecture de l’article de Benveniste, veut aussi montrer comment les illustrations tissent au sein du texte la matière d’un autre texte qui n’est pas entièrement l’ombre du premier. Ne serait-ce que parce que le lecteur est appelé à « réformer les habitudes de traduction imposées par la structure (…) des langues modernes ». Quelques brefs commentaires sur la méthode mise en œuvre et sur certains de ses enjeux s’imposaient. I. « L’eau [est] ce qu’il y a de meilleur » : terminologie, méthode Pour être correctement posé du point de vue de la linguistique générale, le problème doit être auparavant resitué dans la variété des types de phrase nominale attestée ; en particulier « Il arrive (…) que la phrase nominale comporte elle-même deux variétés avec une distinction de forme, mais non de sens, liée à la séquence des éléments » Voici l’exemple grec qui permettra de fixer la terminologie : PREDICAT + SUJET ἄριστον µὲν ὕδωρ (attesté1) aristonPREDICAT men hudorSUJET meilleur-neutre vraiment l’eau Lit. « Le meilleur [est] l’eau » « Ce qu’il y a de meilleur, c’est l’eau » SUJET + PREDICAT ὕδωρ µὲν ἄριστον hudorSUJET men aristonPREDICAT » Lit. « L’au est est le meilleur » « L’eau est ce qu’il y a de meilleur » I.1. Terminologie : « prédicatif », « attributif »… Benveniste n’utilise pas ici le terme « attribut », pas plus qu’il ne le fait dans la caractérisation sommaire qu’il donne en introduction de l’article : 1 Il s’agit de la première phrase des Odes olympiques de Pindare ; elle fait référence à l’eau comme principe de toutes choses (dans la mythologie grecque, Oceanus et Tethys sont parentes de tous les dieux de la Nature). R. Camus. 2010 2/14 « (…) la phrase nominale comporte un prédicat nominal, sans verbe ni copule, et elle est considérée comme l’expression normale en indo-européen là où une forme verbale éventuelle eût été à la 3ème personne du présent de l’indicatif de ‘être’ ». Comparer cette formulation avec celle d’une monographie récente, au sujet de la langue russe et de ce quelle rebaptise « phrase averbale », laquelle « [se] trouve dans la plupart des phrases attributives qui seraient au présent de l’indicatif , si elles comportaient un verbe2 » Ces deux formulations liminaires se font écho, reprenant la fiction de substitution que proposait déjà Meillet : « une forme verbale eût été à la 3ème personne du présent de l’indicatif » « phrases (…) qui seraient au présent de l’indicatif ») Mais la seconde substitue l’attribut (« phrase attributive ») au prédicat. Benveniste, de son côté, parle plus loin de « syntagme attributif »pour caractériser le syntagme tagalog traduisant « le bon enfant ». Le terme « attribut » est donc compris dans cette article dans le sens que lui accorde la terminologie grammaticale actuelle des pays anglo-saxons et slaves, à savoir : ce que notre grammaire scolaire appelle « épithète ». L’actuelle tradition française est née au XVIe siècle et fut généralisé par la Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal d’Arnauld et Lancelot, 1660. Laquelle Grammaire générale avait dû opter pour l’un des deux emplois qui coexistaient au XVIIe ; comparer (orthographe normalisée) : - « attribut » = « déterminant non précédé d’article » : L'article indéfini s'applique immédiatement devant les noms propres [...] mais si on vient à spécifier un Pierre ou un autre, et y entremettre quelque attribut, on se servira du defini : comme la femme du gros Pierre [...]. (Antoine Oudin, Grammaire francoise, Douay, Wion, 1648, p. 54.) - « attribut » = « prédiqué du nom » : Dans cette Proposition, Dieu est Juste, ces deux noms, Dieu et Juste, sont Sujet et Attribut, qu'on lie par le Verbe est. (René de Ceriziers, Le Philosophe françois, Lyon, Valançot, t. I, 1649 p. 22.) Benveniste a de bonnes raisons de s’écarter de l’usage de la grammaire scolaire française : la tradition des grammaires grecques et l’usage anglo-saxon, l’adéquation descriptive et la redéfnition des structures étudiées. - Tradition des grammaires grecques et adéquation descriptive. Comme tout helléniste, il utilise la syntaxe grecque de Kühner et Gerth (première édition 1898) qui distingue deux fonctions adjectivales : l’ « adjectif attributif » est précédé de l’article défini (on dit alors littéralement en grec : le bon homme, l’homme le bon, homme le bon), l’ « adjectif prédicatif » ne l’est pas. En grec, le critère de la présence de l’article fait reposer cette distinction sur le sens du syhtagme nominal (degré de détermination), alors que l’opposition entre l’adjectif épithète (au sein d’un groupe nominal) et l’adjectif attribut (au sein d’un groupe verbal ou « attributif ») est affaire d’analyse syntaxique. Cela dit, plusieurs emplois des adjectifs n’entrent pas dans un découpage en deux catégories : en grec comme en français existent des appositions, des tournures comme rien de neuf, toute la grande ville (ou 2 Fl. Lefeuvre, La phrase averbale en français, p. 12. R. Camus. 2010 3/14 toute ne peut guère être dit « épithète ») etc.3. Tout au plus peut-on relever que le terme d’ « attribut » s’applique bien à l’exemple tagalog traduisant « le bon enfant » et dérivé d’un tour glosé « l’enfant qui est bon ». - Mieux circonscrire les phrases nominales. Benveniste vise non seulement les phrases sans verbe prédiquant une propriété, mais l’ensemble des phrases nominales : les phrases de type sujet-prédicat en général (y compris les phrases possessives), ainsi que les phrases sans sujet (grec. dêlon « il est clair [que] »). II.2. Ordre des mots et particules L’exemple est emprunté au grec classique, qui offre beaucoup plus d’exemples de l’ordre prédicat+sujet (sans verbe) que le latin, et de nombreux exemples de « coexistence » dans les textes4. Tantôt « la meilleure chose » + « l’eau », « l’eau » + « la meilleure chose » : selon Benveniste, « une distinction de forme, mais non de sens ». Plutôt qu’une indiscernabilité absolue des interprétations, est ici visée la différence qui oppose ce couple, par exemple, aux analogues apparents en français : Heureux les pauvres… présente une articulation entre un prédicat et un sujet (structure phrastique canonique qu’il appelle « syntagme prédicatif »), alors que les pauvres heureux ou les heureux pauvres ne le font pas (« syntagmes attributifs »). Les exemples cités dans l’article exhibent en outre deux sous-variantes sur la base de l’ordre déterminé/déterminant dans le syntagme nominal : - ordre « déterminé + déterminant » dans le syntagme nominal Vieil irlandais: infer maith « le bon homme » maith infer « l’homme est bon » homme bon(té) bon(té) homme - ordre déterminant + déterminé dans le syntagme nominal : Turc : kırmızı ev « la maison rouge » ev kırmızı « la maison est rouge » rouge maison maison rouge Hongrois : a meleg viz « l’eau chaude » a viz meleg « l‘eau est chaude » article chaude eau article eau chaude (idem pour l’exemple en coos d’Oregon, langue disparue au milieu du XXe siècle, glosé dans le texte) La syntaxe a donc quelque sens, elle qui est pourtant réduite à de simples configurations obtenues par épure des éléments superflus, volatiles. C’est pourquoi on ne tiendra pas compte de la particule grecque men « vraiment, en réalité assurément » malgré le sentiment qu’elle n’est pas entièrement étrangère à l’assertion que constitue la phrase (au sens commun du terme : « proposition qui énonce un jugement et que l’on soutient absolument »5). Le point est que men n’est pas indispensable : une présence occasionnelle ou même fréquente ne garantit pas en soi l’existence d’une place uploads/s3/ pour-lire-l-article-la-phrase-nominale-e.pdf
Documents similaires



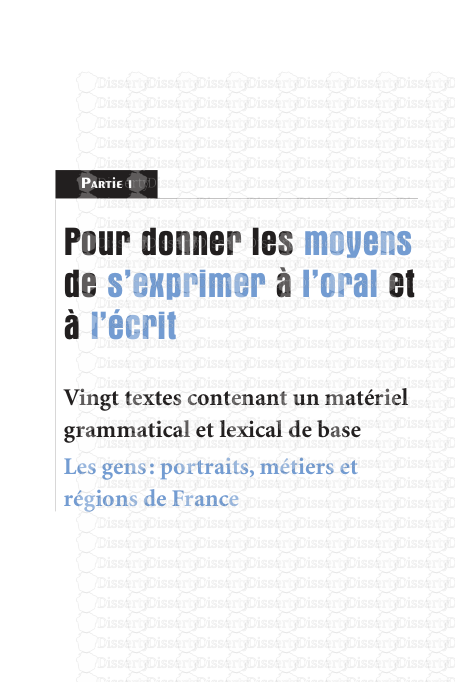






-
19
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 10, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1680MB


