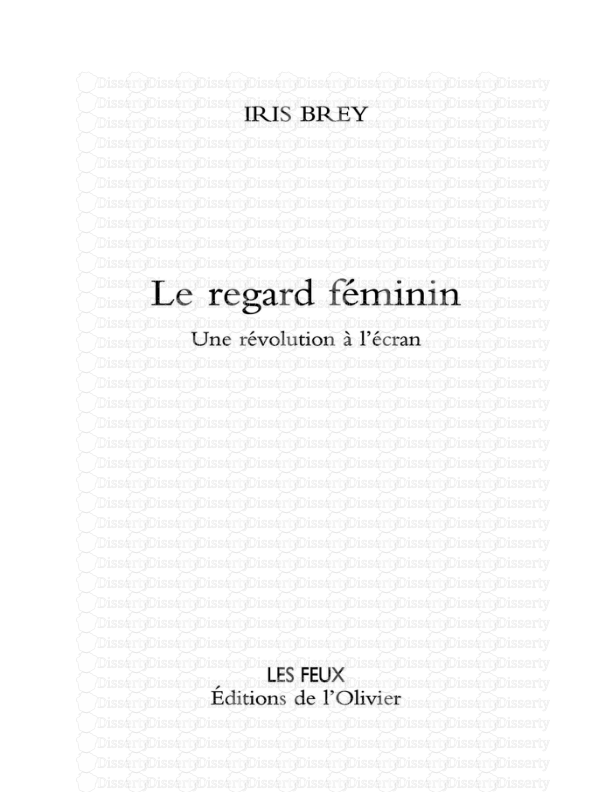De la même autrice Sex and the series Éditions de l’Olivier, « Les Feux », 2018
De la même autrice Sex and the series Éditions de l’Olivier, « Les Feux », 2018 ISBN 978.2.8236.1408.4 © Éditions de l’Olivier, 2020. Ce document numérique a été réalisé par Nord Compo. « Nommer, c’est dévoiler. Et dévoiler, c’est déjà agir. » Simone de Beauvoir TABLE DES MATIÈRES De la même autrice Copyright Introduction Chapitre 1 - Du male gaze au female gaze Au départ, le regard Le male gaze Le Female gaze Une approche phénoménologique et féministe du regard féminin Chapitre 2 - Une esthétique du désir Écriture féminine, regard féminin De La Leçon de piano au Portrait de la jeune fille en feu Madame a des envies, le premier film female gaze Une esthétique du désir Woman's film et « portrait de femme » vs female gaze Chapitre 3 - Le viol Couvrez ce viol que je ne saurais voir Regarder le viol Le point de vue de la chatte : Elle, de Paul Verhoeven Rape and Revenge Le viol au plus proche des corps Chapitre 4 - Jouissance Orgasmes féminins La jouissance dans Je, tu, il, elle Scènes de sexe lesbien I Love Dick Le male gaze queer L'excitation sans male gaze Chapitre 5 - Le corps en mouvement des femmes déchaînées Les flâneuses Les vagabondes Les marginales Les liminales Les charnelles Les femmes enceintes Conclusion Bibliographie sélective Filmographie et sériegraphie sélectives d'œuvres female gaze Remerciements Introduction Il existe un regard féminin, ou female gaze, un regard qui nous fait ressentir l’expérience d’un corps féminin à l’écran. Ce n’est pas un regard créé par des artistes femmes, c’est un regard qui adopte le point de vue d’un personnage féminin pour épouser son expérience. Pour le faire émerger, les cinéastes ont dû tordre le corps de la caméra, inventer et réinventer une forme filmique afin de s’approcher au plus près de l’expérience des femmes. D’Alice Guy, qui utilise pour la première fois le gros plan au cinéma à des fins dramatiques dans Madame a des envies en 1906, à Phoebe Waller-Bridge, qui utilise le regard caméra pour créer non plus une distanciation mais un lien entre l’héroïne et les spectateur.trice.s (Fleabag, 2016), le regard féminin est là, sous nos yeux. Pourtant, même si de nombreuses œuvres privilégient cette perspective depuis les débuts du cinéma, le regard féminin semble avoir été relégué à une culture souterraine, invisible. Dès lors, il s’est doté d’une autre puissance, d’une autre aura, celle des œuvres secrètes qui existent dans un murmure, dans les soupirs de celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans le cinéma dominant. Un régime d’images qui appellent à désirer autrement, à explorer nos corps, à laisser nos expériences nous bouleverser. Des images qu’il faut aujourd’hui nommer et définir. Le Regard féminin, une révolution à l’écran tisse des ponts, des filiations imaginaires ou revendiquées entre des œuvres du passé et du présent. Faire dialoguer ces films permet de leur redonner, ainsi qu’à leurs réalisateurs et réalisatrices, une place dans l’histoire du cinéma, mais aussi de générer une poésie des images, dans le sens de poesis, de création d’un langage visuel commun. Même si le terme female gaze s’est démocratisé ces dernières années, il ne s’agit pas d’une nouveauté post-MeToo. L’expérience féminine a toujours été mise en scène au cinéma mais son impact n’avait pas encore été théorisé. Aucun livre sur le female gaze, qui en donne une définition autre que « film de femmes », n’avait été écrit jusqu’à maintenant. Le terme commençant à abonder dans les médias, j’ai éprouvé le besoin de regarder avec des yeux neufs notre patrimoine et notre matrimoine audiovisuels. Non pas dans une approche révisionniste, mais dans celle d’une revalorisation du féminin. La troisième vague du féminisme a d’abord défini le genre comme une construction sociale, avant de s’intéresser aux queer zones 1, à la fluidité. J’ai baigné dans cette culture pendant mon doctorat à New York University. Ce nouveau cadre théorique est devenu un terrain de jeu foisonnant pour les études universitaires, mais aussi pour se penser soi-même. La théorie queer a apporté un vent de liberté, une infinité de possibilités, de nouveaux régimes sexuels. Circonscrire un regard à ce qu’il possède de « féminin » peut paraître aller à contre-courant de ce mouvement. L’expression female gaze peut sembler essentialisante, enfermante, renvoyer à une assignation sexuée. Pourtant, je suis persuadée que c’est l’expression adéquate. En premier lieu parce qu’elle fait écho au male gaze théorisé par Laura Mulvey en 1975 dans son article « Visual Pleasure and Narrative Cinema 2 ». Je ne considère pas pour autant que le female gaze est le concept miroir du male gaze, tout comme le féminin n’est pas le miroir du masculin, pour moi il s’agit d’une nouvelle façon d’appréhender les images. Dans sa chronique du dernier Tarantino, « Il était une fois… à Hollywood, la soif du mâle 3 », la philosophe Sandra Laugier se trompe. Elle considère un plan du torse nu de Brad Pitt comme une forme de female gaze, alors que la représentation du corps comme objet de désir, que ce soit un corps masculin ou féminin, reste une forme de male gaze. Le regard féminin filme les corps comme sujets de désir. On peut se permettre de réinvestir cette terminologie en abandonnant l’opposition masculin-féminin au profit d’une démultiplication des possibles, une différance 4. Si on réfléchit au female gaze à la manière de Derrida, quand il a détourné le mot différence en différance, c’est pour bousculer le sens de female, pour décortiquer ce terme et en appréhender la complexité, l’envisager comme un élément de la marge qui déstabilise l’ordre et pour sortir d’un discours phallocentrique. C’est la raison pour laquelle, dans cet essai, j’ai privilégié une approche thématique de ce concept. Dans le premier chapitre, j’analyse le female gaze, ses enjeux, sa définition, en examinant en détail ses différences avec le male gaze. Dans le deuxième chapitre, je reviens sur ma rencontre avec le regard féminin d’Alice Guy, de Jane Campion et de Céline Sciamma et m’interroge sur la façon dont il répond à une esthétique du désir. Dans le troisième chapitre, j’explore les représentations du viol au travers d’un regard féminin chez Paul Verhoeven, Virginie Despentes, Ida Lupino ou encore dans la série La Servante écarlate. Voir le viol à travers le regard du personnage féminin est une expérience rare dans l’histoire du cinéma, lequel a tendance à érotiser les violences sexuelles faites aux femmes. Puis dans le quatrième chapitre, je me tourne vers la jouissance et étudie la manière dont l’orgasme féminin fait vibrer nos écrans, notamment dans les films de Chantal Akerman, Barbara Hammer, Andrea Arnold ou encore dans les séries de Jill Soloway. Enfin, dans le cinquième et dernier chapitre, j’accompagne les corps en mouvement des héroïnes déchaînées – c’est-à- dire libérées des oppressions du patriarcat et vivant une sexualité libre – de Dorothy Arzner, Agnès Varda, Barbara Loden et Marie-Claude Treilhou, qui font trembler la norme. Le regard féminin est un point commun à toutes ces œuvres. Ce livre génère un premier corpus d’œuvres au regard féminin. Un corps multiple, vivant, hybride, qui habite le trouble 5. Il me paraît nécessaire aujourd’hui d’utiliser l’expression « regard féminin » afin de valoriser l’expérience féminine. Même si nous vivons dans une époque queer, fluide et trans, cette expérience – liée au corps féminin – reste encore à définir. Ne pas mettre de mots sur la représentation des expériences féminines, ne pas oser les analyser, c’est aussi une façon d’invisibiliser le point de vue d’une « minorité ». En regardant des centaines de films et de séries pour l’écriture de ce livre, j’ai été choquée que si peu d’expériences concernant le corps féminin (d’un personnage cisgenre ou transgenre) soient montrées. De manière physiologique (des seins qui poussent, aux règles, à l’orgasme, l’avortement, l’accouchement, l’excision, la ménopause) ou sociologique (l’exclusion, la domination, les violences sexuelles, le viol). Comme si ces états n’avaient pas d’importance. Nous assistons là à un mépris flagrant du féminin dans nos fictions, majoritairement écrites et réalisées par des hommes. Les autres fictions, celles qui épousent l’expérience féminine, interrogent les rapports de domination et de pouvoir au sein et en dehors de la diégèse, les rapports de pouvoir sur le plateau, aussi bien que la relation entre les spectateur.trice.s et l’œuvre : quel est le pouvoir de celui ou celle qui regarde ? Dans la philosophie traditionnelle occidentale, l’esprit et la parole sont plus importants que le corps. De même pour la critique cinématographique, qui met en avant les films tenant à distance le corps. Les cinéastes célébrés sont des « intellectuels », ceux dont le cinéma est truffé de références cinéphiles (d’autres films d’hommes !). Analyser un film se résume à le regarder comme un objet, à réfléchir à la position du spectateur (et non à celle de la spectatrice), à mettre de côté la corporéité d’une expérience qui serait incarnée, sensuelle. La critique féministe a souvent analysé les films en opposant les spectateurs féminins aux spectateurs masculins, les personnages masculins aux personnages féminins, avec l’idée centrale uploads/s3/le-regard-feminin-une-revolution-a-l-x27-ecran-by-iris-brey.pdf
Documents similaires










-
67
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 26, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.2299MB