1 1ère année groupe 2 – Droit constitutionnel semestre 2 Eléments de correction
1 1ère année groupe 2 – Droit constitutionnel semestre 2 Eléments de correction Sujet n° 1 : Dissertation Le Conseil constitutionnel et les droits de l’homme Analyse du sujet Ce sujet est un sujet très classique du second semestre de droit constitutionnel. Il fait le lien entre un thème du premier semestre, les droits de l’homme, et une partie importante du programme du second semestre, le Conseil constitutionnel. Les connaissances mobilisables pour traiter ce sujet figuraient à la fois dans le cours de Madame Cohendet et dans les fiches de TD relatives au Conseil constitutionnel et à la hiérarchie des normes. Il convenait évidemment d’éviter de procéder à une énumération sous forme de catalogue de toutes les connaissances relatives au Conseil constitutionnel. A l’instar de toute dissertation, un tel sujet impliquait une argumentation en réponse à une problématique précise. Délimitation du sujet La définition des termes du sujet permettait de délimiter ce dernier. Le Conseil constitutionnel est la juridiction chargée principalement du contrôle de constitutionnalité des lois. Les droits de l’homme sont, suivant la définition de Madame Cohendet, des prérogatives reconnues aux individus, considérées comme inhérentes à la personne humaine et essentielles à la démocratie et à la paix. Les droits de l'homme sont par conséquent reconnues par des normes de valeur constitutionnelle et /ou par des conventions internationales, afin que leur respect soit assuré. Il était à ce titre important de ne pas cantonner le sujet aux droits de l’homme garantis pas la Constitution, mais aussi d’évoquer, dans le devoir, ceux protégés par les conventions internationales. Problématique possible Le terme le plus important du sujet était ici le « et ». Il n’impliquait pas, en l’espèce, une comparaison (les termes du sujet n’étant pas comparables), mais d’établir la relation entre les termes du sujet. La relation était ici à sens unique. Il était ainsi possible de s’interroger sur l’apport du Conseil constitutionnel à la garantie des droits de l’homme. Les grands axes d’un plan 1. Le Conseil constitutionnel a d’abord permis l’intégration des droits de l’homme dans le bloc de constitutionnalité. Cette intégration a été progressive. Elle a été entamée dans la décision du 16 juillet 1971, dans laquelle le Conseil constitutionnalise le Préambule de la Constitution de 1958 et les textes auquel il se réfère. Acquièrent ainsi une valeur constitutionnelle la DDHC, mais Ce document est strictement réservé aux étudiants du Centre de formation juridique. Document imprimé le 04/05/2018 à 19h42 par Papa Sarr (identifiant:182557 :: email:padiegane@gmail.com :: mdp:marie) 2 aussi les principes économiques et sociaux du Préambule de 1946, ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Mais la constitutionnalisation des droits de l’homme ne se limite pas à cette décision. Le juge constitutionnel dégage en effet de manière récurrente des principes à valeur constitutionnelle, ainsi que des objectifs à valeur constitutionnelle. Cette intégration des droits de l’homme dans le bloc de constitutionnalité a été très contestée et a nourri les critiques récurrentes relatives au « gouvernement des juges » Il convenait de contester ces critiques, et de relever que la légitimité du Conseil constitutionnel n’est atteinte. Le Conseil, dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, exerce un pouvoir d’interprétation qui ne saurait être remis en cause. Il était aussi possible de relever que le Conseil n’a constitutionnalisé que certains droits de l’homme. Le Conseil n’pas constitutionnalisé ceux protégés par les conventions internationales, dès lors qu’il se refuse à exercer un contrôle de conventionalité des lois (CC, 175, IVG). 2. Le Conseil constitutionnel a surtout permis la protection des droits de l’homme contre les atteintes du législateur. Ceci résulte en premier lieu de l’évolution de ses techniques de contrôle. Tout d’abord, le contrôle du Conseil au regard des droits fondamentaux est devenu plus systématique. L’élargissement de la saisine à soixante parlementaires, en 1974, a permis un accroissement quantitatif de l’activité du Conseil, et donc un contrôle accru de l’activité du législateur au regard des droits fondamentaux. Plus encore, le Conseil d’autorise à statuer ultra petita, et ainsi à contrôler certaines dispositions non déférées. Ensuite, et surtout, les tehcniques de contrôle développées par le Conseil ont permis un accroissement qualitatif de la protection des droits fondamentaux. La jurisprudence de l’effet cliquet, et dans une moindre mesure, la technique des réserves d’interprétation, en témoignent. Ceci résulte en second lieu de l’évolution des modes de contrôle. La mise en place de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), contrôle a posteriori et par voie d’exception, permet une extension du contrôle de constitutionnalité aux lois non contrôlées a priori, ou devenue inconstitutionnelles suite à une révision de la Constitution. Surtout, la QPC porte exclusivement sur les atteintes aux droits et libertés fondamentaux par le législateur. Des développements conséquents sur ce thème étaient attendus. Ce document est strictement réservé aux étudiants du Centre de formation juridique. Document imprimé le 04/05/2018 à 19h42 par Papa Sarr (identifiant:182557 :: email:padiegane@gmail.com :: mdp:marie) 3 Sujet n° 2 Commentaire du texte de Montesquieu Analyse du sujet Le texte reproduit est un extrait bien connu de l’Esprit des lois, qui fait traditionnellement l’objet d’un commentaire dans le cadre du thème de la séparation des pouvoirs. Le texte étant très court, le devoir s’apparentait presque à une dissertation sur la pratique des pouvoirs présidentiels. Mais l’exercice demeurait avait tout un commentaire, et il convenait impérativement de partir d’une citation du texte, en la citant, afin de l’expliquer et enfin l’analyser. Le respect de cette méthode permettait d’éviter de sombrer dans la dissertation et donc le hors sujet. Il était demandé ici de commenter le texte en les appliquant au Président de la République. Il ne fallait pas ici se laisser tromper par l’usage du singulier : le « président de la Vème république » n’est pas seulement l’actuel chef de l’Etat, mais tous les chefs de l’Etat depuis les débuts de la Vème République. Pour le reste, le commentaire se devait d’être très engagé, à l’instar du cours de Madame Cohendet. Les pratiques présidentielles des chefs de l’Etat ne devaient ainsi pas être analysées comme de simples interprétations de la Constitution, mais comme de véritables violations de la Constitution. Problématique La problématique du texte, qui devait être celle du devoir, concernait l’étendue et les limites des pouvoirs du chef de l’Etat dans le système politique de la Vème République, pour reprendre la terminologie de Madame Cohendet. Les grands axes d’un plan Le plan était largement déterminé par la structure du texte à commenter, et il était possible d’organiser le devoir en commentant les deux phrases du texte tour à tour. Le devoir pouvait ainsi montrer que les différents chefs de l’Etat de la Vème république ont largement abusé de leurs pouvoirs prévus par le texte de la Constitution (I), abus qui s’expliquent par les limites insuffisantes aux pouvoirs du chef de l’Etat (II). I – Les abus de pouvoirs conséquents des présidents de la Vème république « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». Cette formule bien connue de Montesquieu est toujours d’actualité concernant le Chef de l’Etat sous la Vème République. Le texte de la constitution ne fait du Président qu’un arbitre et un gardien de la Constitution (art. 5). Mais la pratique présidentielle constante depuis de Gaulle (même sous l’alternance) a consisté à dépasser la lettre la Constitution. Les présidents se sont ainsi attribué des pouvoirs que la Constitution ne leur conférait pas (A). Ils ont aussi exercé leurs pouvoirs propres au-delà de ce que prévoyait le texte constitutionnel (B). A – L’appropriation des pouvoirs du gouvernement Ce document est strictement réservé aux étudiants du Centre de formation juridique. Document imprimé le 04/05/2018 à 19h42 par Papa Sarr (identifiant:182557 :: email:padiegane@gmail.com :: mdp:marie) 4 Les différents chefs de l’Etat se sont tout d’abord reconnu le pouvoir de révoquer leurs premiers ministres, alors même que l’article 8 de la Constitution subordonne cette révocation à la démission du chef du gouvernement. Cette pratique a été rendu possible par le soutien d’une majorité parlementaire, et par la forte légitimité du chef de l’Etat, en raison de son élection au suffrage universel direct depuis 1962. Ce pouvoir de révocation a eu une conséquence importante : il a conduit à la subordination du premier ministre au chef de l’Etat, et in fine à la responsabilité politique du premier ministre devant le président. Plus encore, en raison de sa subordination au chef de l’Etat, le premier ministre et le gouvernement ont vu leur pouvoir se réduire au profit du Président. Le Président s’est ainsi approprié le pouvoir de déterminer la politique nationale, alors même qu’une telle mission incombe au gouvernement (art. 20). En matière de pouvoirs partagés, c’est toujours le chef de l’Etat qui a le dernier mot, alors même que le pouvoir de décision devrait appartenir, selon madame Cohendet, au premier ministre (si on avait voulu en faire eu pouvoir de décision, on en aurait fait un pouvoir propre). Enfin, et surtout, la théorie du domaine réservé à permis aux chefs de l’Etat de s’approprier les compétences en matière de défense et de diplomatie, uploads/S4/ analyse-du-sujet 1 .pdf
Documents similaires






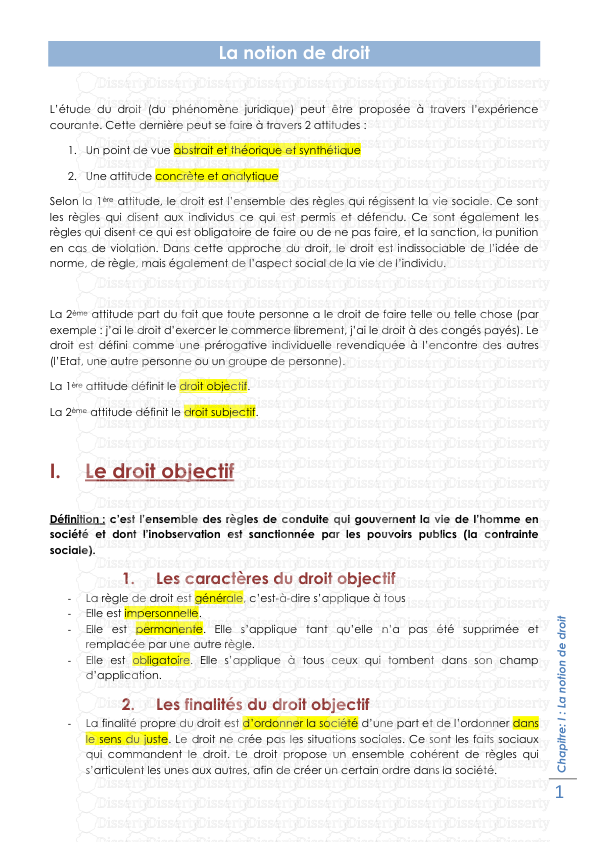



-
78
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 06, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.0438MB


