Commentaire composé de l’arrêt du 18 janvier 2010, CCass, 1ère chambre civile D
Commentaire composé de l’arrêt du 18 janvier 2010, CCass, 1ère chambre civile Dans un arrêt rendu en date du 18 janvier 2010, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation est appelée à se prononcer sur l’assouplissement de la recherche du lien de causalité lorsque l’on est en présence de plusieurs acteurs possibles, mais indéterminés, de dommages résultant de l’utilisation d’un produit de santé. Dans cet arrêt, il est question d’une molécule de synthèse, le Distilbène, ayant été prescrit aux femmes enceintes présentant un risque de fausse couche ou de naissance prématurée entre 1948 et 1977 en France. Au regard de la dangerosité de cette molécule pour les patientes à qui elle a été administrée, cette dernière est retirée en 1977 du marché français. En effet, des risques de malformations ou de pathologies, vis-à-vis des enfants à naître dont la mère avait fait l’objet du traitement au distilbène, ont été mis en lumière. Ainsi, de nombreuses actions en responsabilité des deux laboratoires fabricant le distilbène, UCB Pharma et Novartis santé familiale, ont été engagées par les victimes de cette molécule afin d’obtenir une réparation de leur préjudice. Ici, l’action en responsabilité est menée par une personne rendant responsable la molécule de distilbène, prescrite à sa mère pendant sa grossesse, de sa stérilité. Le tribunal de grande instance rejette la requête de la victime concernant l’engagement de la responsabilité des sociétés fabricantes de la molécule en question. La victime interjette appel du jugement. Cependant, l’arrêt de la Cour d’Appel confirme celui du tribunal de grande instance et rejette l’ensemble des demandes en expertises et en indemnisation de la victime. Pour cela, la Cour d’appel s’appuie sur l’absence de preuve d’un lien de causalité direct entre le dommage causé à l’enfant et l’administration à la mère de la victime de la molécule de distilbène. Ainsi, il n’est pas possible de déterminer laquelle des entreprises commerçantes est à l’origine même du dommage de la victime. Selon la cour d’Appel, l’indemnisation n’est donc pas possible puisque le véritable responsable ne peut être déterminé. La victime se pourvoie alors en cassation. La haute Cour de justice va alors casser et annuler l’arrêt confirmatif d’appel pour violation des articles 1382 et 1315 du Code Civil. Elle réaffirme par ailleurs le principe selon lequel la charge de la preuve de l’absence du lien de causalité entre la molécule du distilbène et le dommage causé à la victime repose, en l’espèce, sur les laboratoires fabricants de cette molécule. Nous étudierons tout d’abord la nouvelle conception de la causalité alternative en tant que fiction permettant le contournement des difficultés probatoires du lien de causalité (I) avant de nous intéresser plus particulièrement à ce mécanisme en tant que moyen d’étendre l’indemnisation des victimes de dommages (II). I. Une nouvelle conception fictionnelle vers le contournement de la difficulté de prouver le lien de causalité Il conviendra en l’espèce d’entreprendre une description de l’évolution de la notion de causalité alternative jusqu’à son caractère fictionnel (A) avant de nous attarder sur l’assouplissement de la preuve du lien de causalité qu’entraine cette nouvelle conception (B). A. La nécessaire conception fictionnelle de la causalité pour une meilleure adaptation au sort des victimes Selon l’article 1382 du code Civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ainsi, une personne n’est tenue à réparation d’un préjudice causé que dans la mesure où le fait entre bien dans un rapport de causalité juridique avec le dommage. La question de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques a ainsi été au cœur d’une importante évolution jurisprudentielle ces dernières années. C’est lors de cette évolution qu’une nouvelle conception de la causalité alternative a été posée. Il convient dès lors de définir le plus précisément possible la notion complexe de causalité alternative. Il s’agit d’une situation dans laquelle on assiste au concours d’activités similaires dont chacune est suffisante à la production du dommage en cause mais dont une seule seulement a été à l’origine du dommage. Dans un tel cas, la victime peut aisément déterminer l’acte à l’origine de son préjudice mais ne pourra en revanche pas désigner avec précision l’activité génératrice d’un tel acte. La causalité alternative était rarement utilisée jusqu’à présent en la matière au regard de la complexité de sa définition et de sa qualification en tant que telle. En effet, la doctrine s’interrogeait sur le fait de savoir si la causalité alternative tenait plus de la notion de coresponsabilité (ou coaction) ou de celle de la présomption simple. Finalement, la doctrine s’est accordée sur le caractère de fiction de la causalité alternative. Ainsi, en droit, une reconnaissance de responsabilité civile est permise d’un dommage résultant d’une relation de cause à effet n’ayant pas été expressément prouvée. Aujourd’hui, en ce qui concerne les cas de causalité alternative, on retient une responsabilité collective (in solidum) de chacun des auteurs présumés alors même que leur responsabilité individuelle n’a pas été expressément établie dans le préjudice occasionné. Une vérité hypothétique peut donc constituer la base de l’engagement de la responsabilité des éventuels fautifs. Par conséquent, il est bien évident qu’une telle conception de l’engagement de responsabilité doit être strictement encadrée même si le lien de causalité n’a pas disparu (il n’a subit qu’un assouplissement). B. Un assouplissement de la démonstration du lien de causalité Nous venons de voir que la jurisprudence opère un assouplissement des exigences de démonstration du lien de causalité au regard de son acceptation de l’engagement d’une responsabilité sur le fondement d’une hypothèse. C’est d’ailleurs la question du régime probatoire de la causalité alternative qui pose le plus de problèmes en la matière. En vertu de l’article 1315, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Néanmoins, la charge de la preuve peut s’avérer très lourde pour les victimes, et tout particulièrement dans des domaines plus techniques comme les actes médicaux. Pour aider les victimes à obtenir réparation, la jurisprudence, a donc développé des stratagèmes leur permettant, dans certaines situations, de contourner les difficultés probatoires. Nous verrons plus en détail dans cette partie le détournement par les techniques de fond après que la Cour de Cassation ait accepté d’assimiler la cause alternative à la cause juridique. En l’espèce, avec l’affaire du distilbene, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts qui font application du principe de contournement des difficultés probatoire par les techniques du fond. Dans le dernier arrêt concernant le distilbène du 18 janvier 2010, la difficulté probatoire résidait dans le fait qu’on ne savait pas quel était le laboratoire fabriquant du médicament pris par la mère de la victime. Ainsi, l’action en réparation aurait pu échouer selon la conception traditionnelle. La Cour d’appel avait d’ailleurs opté pour cette solution en retenant que, puisque la victime ne parvenait pas à établir que sa mère avait pris la molécule produite par tel ou tel laboratoire, alors il n’était pas possible de considérer un lien de causalité direct entre le dommage et l’absorption du médicament par la mère de la victime. La cour de Cassation censure cette solution édictée par la cour d’appel au visa des articles 1382 et 1315 du code civil et énonce qu’en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le distilbene avait bien été la cause directe de la pathologie de la fille, et partant que la mère avait absorbée la molécule litigieuse, il appartenait donc à chacun des laboratoires de prouver que son produit n’était pas à l’origine du dommage. C’est un raisonnement en termes de causalité alternative car la Cour de cassation réserve la possibilité pour chacun des laboratoires de prouver qu’il n’a pas été à l’origine du dommage de la victime et donc de ne pas être tenu à la responsabilité in solidum. Un reversement de la charge de la preuve est opéré au profit des victimes du distilbène. II. Une nouvelle conception fictionnelle de la responsabilité alternative vers une meilleure indemnisation et protection des victimes de dommages Il conviendra dans cette partie de nous attacher aux raisons de ce revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation avec en premier lieu une logique d’extension du régime des indemnisations des victimes (A), tout cela en accord avec les législations européennes (B). A. D’un droit de la responsabilité civile à un droit de l’indemnisation des victimes Lorsque le préjudice subi par la victime a un lien avec un acte médical ou un produit de santé, la loi, et surtout la jurisprudence récente (notamment dans les affaires liées à l’utilisation du distilbène), tendent à faciliter la preuve incombant à la victime, en principe, en application de l’article 1315 du Code civil. Il en résulte un assouplissement considérable de la recherche de la causalité. Cette extension du droit à l’indemnisation des victimes s’inscrit dans une logique protectionniste de la Cour et du droit en général à l’égard de la population. Jusqu’à présent, les victimes uploads/S4/ commentaire-arret-distilbene-18-janvier-2010.pdf
Documents similaires







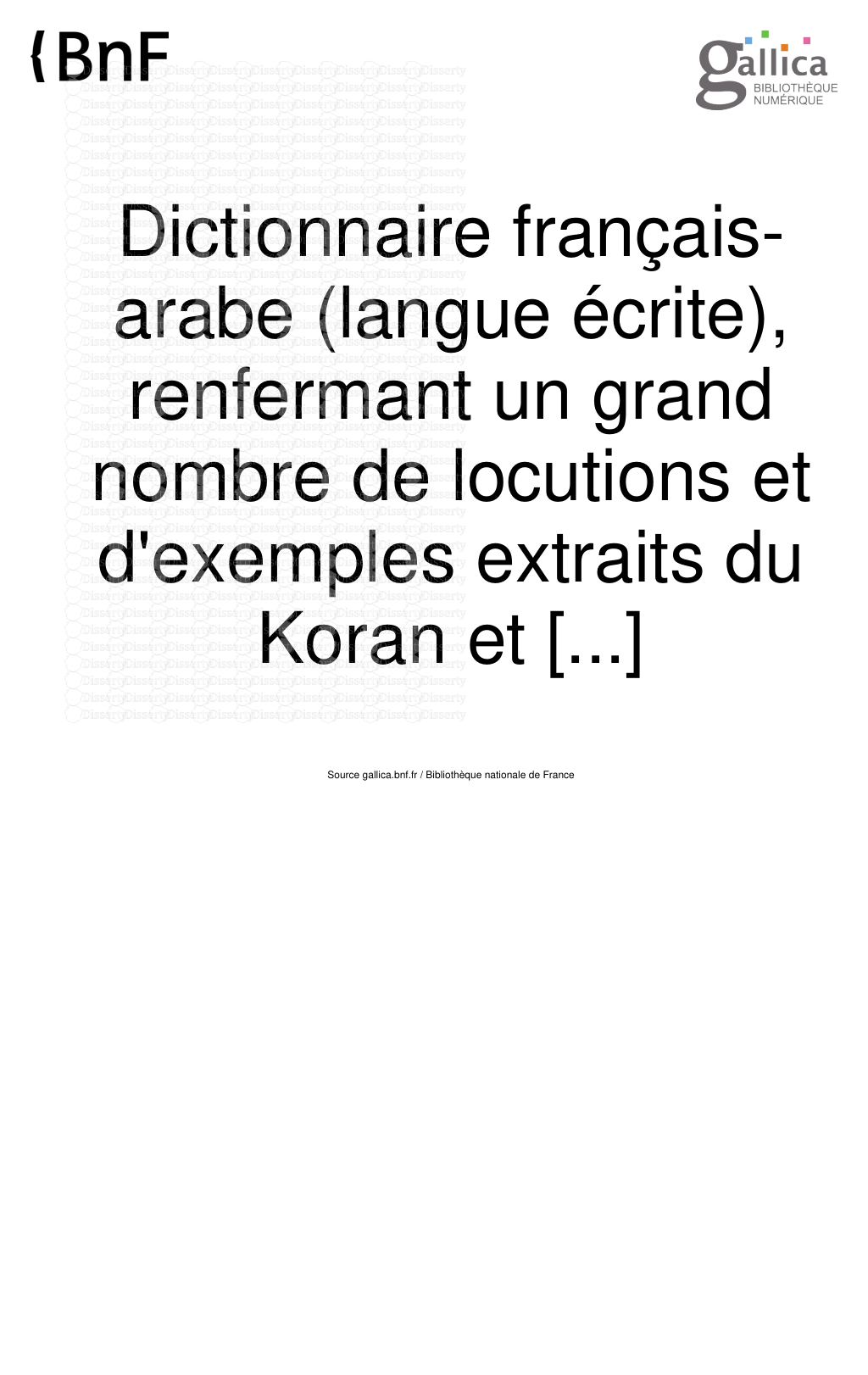


-
80
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2768MB


