Patrick Renaud Zah BI, chargé de cours 1 %2 ANNEE ACADEMIQUE : 2013-2014 LES CO
Patrick Renaud Zah BI, chargé de cours 1 %2 ANNEE ACADEMIQUE : 2013-2014 LES CONTRATS D’AFFAIRES - Règlementation - Techniques de rédaction - Contrats types GECOS –FORMATION Yopougon quartier millionnaire AMAND HERMANN LANDRY Patrick Renaud Zah BI, chargé de cours 2 INTRODUCTION Dans notre activité professionnelle, ou pour des besoins d’ordre privé, nous passons quotidiennement des contrats les plus divers. Afin de leur donner une sécurité juridique, le législateur est venu préciser la manière dont se concluent et s’exécutent les plus importants d’entre eux. Ainsi une connaissance parfaite des règles applicables à ceux-ci en général mais à ceux dits d’affaires en particulier s’impose afin de mieux les négocier pour en tirer le maximum de profit. L’objectif du présent cours est donc d’une part de familiariser les apprenants à l’environnement des contrats d’affaires les plus usuels pour leur permettre de les identifier facilement et d’autre part, leur donner un schéma de réflexion et de rédaction pour éviter les erreurs et autres pièges consistant notamment à mentionner dans leurs conventions des stipulations illicites ou des clauses ayant une efficacité illusoire ou les insérer sans en mesurer la portée. L’intérêt de cet enseignement réside dans le fait qu’au-delà des considérations d’ordre financières et des cas de gestions calamiteuses, la grande majorité des entreprises mettent la clé sous le paillasson parce que leurs gérants n’ont pas su négocier leurs contrats faute de connaissances en la matière. Au regard du nombre pléthorique de contrats d’affaires, il est prétentieux de notre part de vouloir les étudier dans leur totalité, ce pourquoi une délimitation s’est avérée judicieuse ; ainsi tout au long de l’enseignement nous verrons dans une première partie les règles applicables aux contrats spéciaux d’usage fréquent ( le bail à caractère commercial, le crédit- bail, la franchise, la vente et le contrat d’entreprise, le mandat) et dans une seconde partie, les techniques de rédaction des contrats d’affaires à l’aide de cas pratiques ; mais avant nous ferons un résumé des règles contractuelles générales. Patrick Renaud Zah BI, chargé de cours 3 LA THEORIE GENERALE DES CONTRATS Le contrat par définition est l’accord de volonté de deux ou plusieurs personnes ayant pour effet la création entre elles d’obligations soit de donner, soit de faire, soit de ne pas faire. Ainsi défini, le contrat est dominé par le principe de l’autonomie de la volonté qui se traduit par la liberté contractuelle, l’égalité entre les parties et la force obligatoire du contrat. 1. LA CLASSIFICATION DES CONTRATS La classification des contrats se fait en fonction du contenu des obligations ou des conditions de formation. 1.1/- La classification fondée sur le contenu des obligations Ici la classification se fait selon ce à quoi s’engagent les parties et comment s’engagent-elles ? A cet effet il faut distinguer : - Contrat synallagmatique et contrat unilatéral Dans le contrat synallagmatique, les obligations sont réciproques entre les parties (la vente ; le contrat d’assurance…) alors que le contrat unilatéral, ne fait naitre les obligations qu’à la charge d’une seule des parties (le prêt) - Contrat à titre gratuit et contrat à titre onéreux Dans le contrat à titre gratuit, un seul des cocontractants est engagé et l’autre enrichira son patrimoine sans contrepartie (la donation, le prêt d’argent sans intérêt…) ; à contrario le contrat à titre onéreux fait naitre un profit pour chacune des parties (la vente, le louage..) - Contrat commutatif et contrat aléatoire Les obligations sont certaines et connues dès leur conclusion pour ce qui est du contrat commutatif (le contrat de transport, la vente…) le contrat aléatoire quant à lui fait naitre des obligations qui sont incertaines et dépendent d’évènements aléatoires (le pari…) 1.2 /-La classification selon l’exécution des obligations Ce sont : - Le contrat à exécution instantanée : c’est le contrat dont l’exécution est mise en œuvre par une seule prestation sur simple échange des consentements (la vente…) - Le contrat à exécution successive : l’exécution des obligations dans ce type de contrat est échelonnée dans le temps (le contrat de travail…) 1.3/- La classification selon les conditions de formation Selon cette classification on a : Patrick Renaud Zah BI, chargé de cours 4 - Le contrat consensuel : il se forme par la seule volonté des parties, sans aucune formalités ne soit nécessaire (la vente) - Le contrat solennel : il doit prendre nécessairement la forme d’un écrit c'est-à-dire la forme d’un acte écrit ou sous seing privé pour être valable (la donation entre vif) - Le contrat réel : dans ce type de contrat, l’accord de volonté ne suffit pas pour que le contrat soit valable, il faut qu’il y ait nécessairement remise d’une chose au cocontractant (gage, prêt, dépôt…), tant qu’il n’y a pas remise de la chose, il n’y a contrat mais plutôt promesse de contrat. 2. LA NAISSANCE DU CONTRAT Le contrat comme tout acte juridique nait c'est-à-dire se forme. Une fois formé, il doit être valide sans quoi il est frappé de nullité. 2.1/- la formation du contrat La formation du contrat suppose la rencontre d’au moins deux volontés à savoir celle de l’offrant (pollicitation) et une acceptation. Aussi convient-il de voir successivement l’offre et l’acceptation ainsi que les conditions de validité du contrat. 2.1-1/- L’offre L’offre par définition est la manifestation unilatérale de volonté par laquelle l’offrant propose à une autre la conclusion d’un contrat. Quelles sont les conditions à remplir pour qu’elle produise des effets ? - Les formes : l’offre peut revêtir diverses formes (orales, écrites, affiches, marchandises exposées avec affichage du prix, taxi en station,) et être faite à personne dénommée ou à personne indéterminée. - Les conditions : elle doit être précise et complète, c'est-à-dire comporter tous les éléments nécessaires à la formation du contrat ( objet bien déterminé, prix bien défini…) - Les effets : en principe tant qu’elle n’est pas encore acceptée, l’offre ne peut être retirée. En fait si l’offre ne crée pas le contrat, elle crée néanmoins des effets à l’égard du pollicitant. Ainsi s’il n’a pas fixé de délai d’acceptation, l’offre doit être maintenue dans un délai raisonnable, par contre s’il a fixé un délai d’acceptation, il ne peut retirer son offre avant l’expiration du délai sauf refus express de celui à qui elle est destinée. Le retrait précipité engage la responsabilité délictuelle du pollicitant. 2.1-2/ - L’acceptation Patrick Renaud Zah BI, chargé de cours 5 C’est la manifestation de volonté par laquelle une personne donne son accord à une offre qui lui est faite. Elle peut être expresse c'est-à-dire orale, écrite, ou par geste. Peut elle être tacite c’est à dire résulté d’un comportement ? En principe le silence ne vaut pas acceptation sauf dans certains cas particuliers tels que l’existence de relations d’affaires entre les parties (tacite reconduction…) ou en cas d’accord sur les clauses essentielles du contrat. 2.2/ - Les conditions de validité du contrat Les quatre conditions de validité du contrat énoncées par le code civil sont : le consentement non entaché de vices, la capacité des parties, un objet certain matière de l’obligation et une cause licite. La défaillance de l’une de ces quatre conditions emporte nullité du contrat. 2.2-1/ - Le consentement Le consentement c’est l’accord de volonté par lequel se forme le contrat. Aussi la première condition de validité d’un contrat est un consentement non vicié. Les vices sont : l’erreur, le dol et la violence. - L’erreur : elle est une cause de nullité de la convention si elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. EX : vous achetez un tableau comme considéré comme une œuvre d’art, vous apprenez plus tar à l’aide d’une expertise que le tableau ne l’est pas. Elle est aussi la cause de nullité quand elle tombe sur la personne du cocontractant dans le cas où la considération de la personne avec laquelle on contracte joue un rôle déterminant. - Le dol : on appelle dol, les manœuvres frauduleuses, tromperies, mensonges, réticences dont une personne use pour en tromper une autre à l’occasion d’un contrat. EX : un commerçant simule des bénéfices exagérés pour vendre plus cher son fonds de commerce. - La violence : c’est la contrainte exercée sur la volonté d’une personne pour la forcer à contracter en la menaçant d’un mal considérable. La violence doit présenter une certaine gravité. EX : vous ne pouvez pas payer à l’échéance l’un de vos créanciers ; celui-ci menaçant de poursuite, vous oblige à passer un contrat désavantageux pour vous. 2.2-2/ - La capacité Pour contracter valablement, il est nécessaire d’avoir la capacité exigée pour accomplir l’acte envisagé. Il s’agit de vérifier la capacité de jouissance et d’exercice des parties. Par ailleurs pour les personnes morales, la question de la capacité d’exercice ne se pose pas, elles agissent par l’intermédiaire de représentants qui tirent en général leurs pouvoirs d’un mandat. Patrick Renaud Zah BI, chargé de cours 6 2.2-3/ - L’objet L’objet du contrat désigne l’opération juridique que les parties ont voulu effectuer. Il doit être déterminé ou déterminable, possible et dans le commerce, conforme uploads/S4/ contrat.pdf
Documents similaires



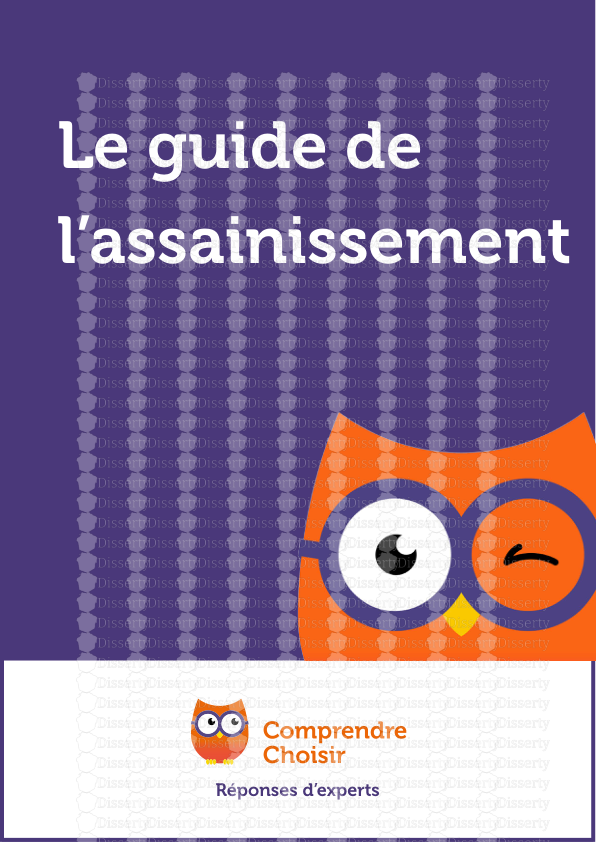






-
40
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 27, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 1.0490MB


