LE GRAND ARRET 18/04/00 Le grand arrêt est en voie de disparition : les journau
LE GRAND ARRET 18/04/00 Le grand arrêt est en voie de disparition : les journaux en parle avant que les tribunaux les rendent. La grandeur de l’arrêt en est atténuée. Qu’est ce qui fait qu’un arrêt marque, est porteur de l’histoire ? Thème technique. Qui a-t-il de commun entre le jugement de Salomon, Nuremberg, Oxygène Liquide, Villemin, Perruche ? Grandeur : difficile à caractériser car repose sur de bonnes raisons ou de mauvaises raisons. Bonnes raisons : justice de Salomon (jurisprudence perspicace). Un grand arrêt permet d dévoiler, de découvrir la vérité. Mais la grandeur d’un arrêt peut reposer sur de mauvaises raisons comme une erreur judiciaire (condamnation de Dreyfus par exemple ou Callas). Il peut être un revirement jurisprudentiel aberrant, dramatique. Les raisons de la grandeur ont varié au fil du temps. Chaque période semble user d’un argument original pour défendre un grand arrêt (politique, social, économique). Dans cette évolution constante, il est difficile de trouver le critère historique et juridique capable de déterminer deux parties distinctes dans l’histoire. Jurisprudence : signification fluctuante : - au Moyen Age, le Jurisprudence évoque la vertu de prudence appliquée au droit, la recherche du juste. - Au 18ème, la Jurisprudence désigne autant la science des juristes que les arrêts d’une cour. Les pays anglo-saxon : la Jurisprudence s’assimile à la science du droit. - Définition française de la Jurisprudence au 19ème offre trois indices : la publication de recueil d’arrêt, la suppression du référé législatif et la motivation obligatoire des décisions. Ces trois indices n’ont pas tous, au regard de l’histoire, un même valeur : les recueils d’arrêt sont bien antérieurs au 19ème. La suspension du référé législatif qui pose la question des rapports entre le judiciaire et le législatif semble aussi un critère ancien ne serait-ce qu’à cause de l’arrêt de règlement. La motivation qui est le dernier critère semble résistant, le meilleur pour la démarcation dans l’évolution historique du grand arrêt. I. Le grand arrêt avant la motivation Le développement de la Cour Souveraine du Parlement à partir du 13ème siècle s’est accompagné de l’usage de consigner par écrit les décisions et la procédure conduisant à l’arrêt. Les registres conservés dans les quatre premiers connus sous le nom d’OLIM rapportent avec sincérité le texte ou la teneur des arrêts prononcés par la Cour Souveraine. Les archives ont le mérite de prendre l’arrêt en note. 1 A. De l’arrêt notable à la cause célèbre Les archives du Parlement restent pratiquement à l’usage exclusif du parlement (avocats, parties et même les officiers du Roi n’y ont pas accès sans autorisation). Cette connaissance limitée de l’usage des cours est justifiée par différents motifs : 1. il ne faut pas laisser au justiciable la possibilité de discuter les arrêts. 2. il ne faut pas révéler les secrets de la Cour et surtout, les juges n’étant pas contraints de motiver leur décision, il n’est pas jugé utile de dévoiler ses archives. Aux 14ème et 15ème siècle, certains praticiens rédigent des ouvrages pour connaître les réaction de ceux qui jugent au nom du roi. Des coutumiers privés, des styles de Cour sont composés. Ces styles de procédure tendent à regrouper des arrêts notables c’est-à-dire des arrêts caractéristiques des différents genres de procès jugés en Parlement. Guillaume Du Breuil, avocat au Parlement, reprend dans son style de procédure les arrêts notables entre 1323 et 1329. Son ouvrage ne porte pas encore d’intérêt au précédent. Il ne cherche même pas à dégager un précédent. Il présente plutôt la règle défendue de l’arrêt et la rapporte de manière abstraite. Les références restent imprécises : il n’y a jamais mention des noms et de la date. La pratique aboutit pourtant au Recueil des Arrétistes. Un des premiers Arrétiste : le praticien anonyme a, au 14ème, noté pour les arrêts qu’il reproduisaient les noms des parties, la date, les arguments des avocats et enfin la décision (c’était la première fois) Ce praticien anonyme (étudiant ?) ajoute souvent des remarques personnelles. Ce praticien reste méconnu. Le plus connu s’appelle Jean Lecoq. Jean Lecoq est avocat au Parlement. Il prend des notes sur les arrêts et les présente en résumant le pour et le contre (méthode dialectique). Il donne la solution de l’arrêt avec pour chacun une note où il essaie de rechercher les motifs qui ont pu fonder la décision. Dans sa présentation, il sacrifie souvent l’accessoire et modifie aussi parfois la portée de l’arrêt qu’il rapporte. Il va même jusqu’à modifier le problème de droit. Son apport cependant : d’avoir dégagé le casus, le cas susceptible de faire date et d’impressionner d’autres décisions (pas encore de définition de Jurisprudence). Cette impression reste relative pour l’époque. Le Parlement est une cour souveraine et sa décision ne saurait être influencée même par des moyens précédents. Au 14èm siècle, et pour cette raison, l’invocation devant la cour d’un arrêt notable est toujours aléatoire. Il arrive cependant qu’un tel arrêt soit invoqué devant la chambre criminelle par le procureur de roi ou par l’avocat du prévenu. Généralement, le plaideur qui ose évoquer un grand arrêt ne s’appuie que sur un seul arrêt et le plaideur précise la matière de l’arrêt pour bien montrer son adéquation avec le cas d’espèce. Pour être reconnu avec succès, le précédent invoqué doit présenter une identité de droit. (pas d’identité des faits). A des conditions strictes, le précédent invoqué alors peut devenir une cause célèbre. B. De la cause célèbre à l’arrêt de règlement Au 14ème, les arrêts du Parlement sont copiés et parfois regroupés en collection, souvent entreprises à l’initiative des prévôts de Paris dans les livres de couleur du Châtelet. 2 Le soin apporté à la transcription de certains arrêts prouve que l’intérêt de ces arrêts dépasse la simple satisfaction culturelle. Sur ce modèle et animé du même intérêt, des particuliers vont compiler également les arrêts. Ces œuvres sont importantes pour les praticiens, la coutume et la jurisprudence. La coutume qui fonde le droit est toujours délicate à prouver devant les tribunaux d’où l’intérêt de se pencher sur les précédents de jurisprudence qui tendent eux même à se constituer en coutume judiciaire. Ce rapport entre la coutume et la Jurisprudence apparaît de plus en plus nettement au 15ème. L’ouvrage de Jean Lecoq a influencé incontestablement la rédaction de la coutume de Paris. La coutume d’Auvergne, également, reprend un recueil d’arrêt d’un praticien régional. Cependant, toujours devant le Parlement, l’invocation du précédent provoque toujours une opposition de principe : devant la chambre criminelle en 1400, l’Evêque de Paris invoque un précédent. Contre lui, le procureur du Roi oppose deux moyens pertinents pour ruiner l’utilisation du précédent c’est-à-dire l’avenir de la Jurisprudence. Il déclare que le précédent ne peut pas être opposable au Roi parce que : - les parties n’étaient pas les parties au précédent et que - le précédent invoqué n’est pas un arrêt de règlement. La Cour va suivre le procureur du Roi. L’absence de motivation de la décision interdit le contrôle de la cour sur le précédent. Le procureur admet cependant a contrario que le précédent pourrait être valablement invoqué en cas d’arrêt de règlement c’est-à-dire un arrêt contenant de manière expresse une disposition valant de manière générale pour l’avenir. L’arrêt de règlement se répartit en deux catégories : 1. ils visent les arrêts rendus à l’occasion d’un procès qui révèle et qui nécessite une intervention plus large. L’arrêt va généraliser les principes de l’affaire. La solennité de l’arrêt est remarquable : les présidents, les juges, les avocats en robe rouge (arrêt en robe rouge). De tels arrêts adaptent les ordonnances royales aux circonstances de temps et de lieu. 2. l’arrêt de règlement est constitué par des décisions rendues en dehors de tout procès et touchant au gouvernement de l’Etat pour sauvegarder la tranquillité intérieure, assurer la paix publique ou encore garantir la défense du royaume. Ces interventions exceptionnelles, ces arrêts, sont à chaque fois justifiées par l’urgence et la nécessité, et sont donc strictement limitées par le Roi et sur sa demande. Sinon, ils sont cassés par le Conseil du Roi. Lors de la cassation, le conseil peut demander à la cour de faire connaître les motifs qui ont fondés la décision. Ainsi, en matière de pourvoi en cassation, le principe de l’absence de motivation tend à s’assouplir et, à la fin de l’Ancien Régime, cette obligation contribue à la naissance de la Jurisprudence moderne : elle transforme alors l’idée du grand arrêt. II. Le grand arrêt depuis la motivation Il revêt un caractère spectaculaire qui n’est pas réservé aux spécialistes du Roi. Aux 17 et 18ème, des recueils de cause célèbre sont composés, non par des praticiens mais par le grand public. Les jugements retenus sont ceux de célèbres controverses du barreau. Ainsi, Gayot De Pitaval va publier en 1738 une importante collection de causes célèbres. Il veut faire « goûter 3 le vrai et le merveilleux ». Aussi, l’affaire de Martin Guer : curiosité qui est racontée et attire les foules. Pour les professionnels du droit, les recueils commencent à réunir et diffuser uploads/S4/ culture-judiciaire.pdf
Documents similaires



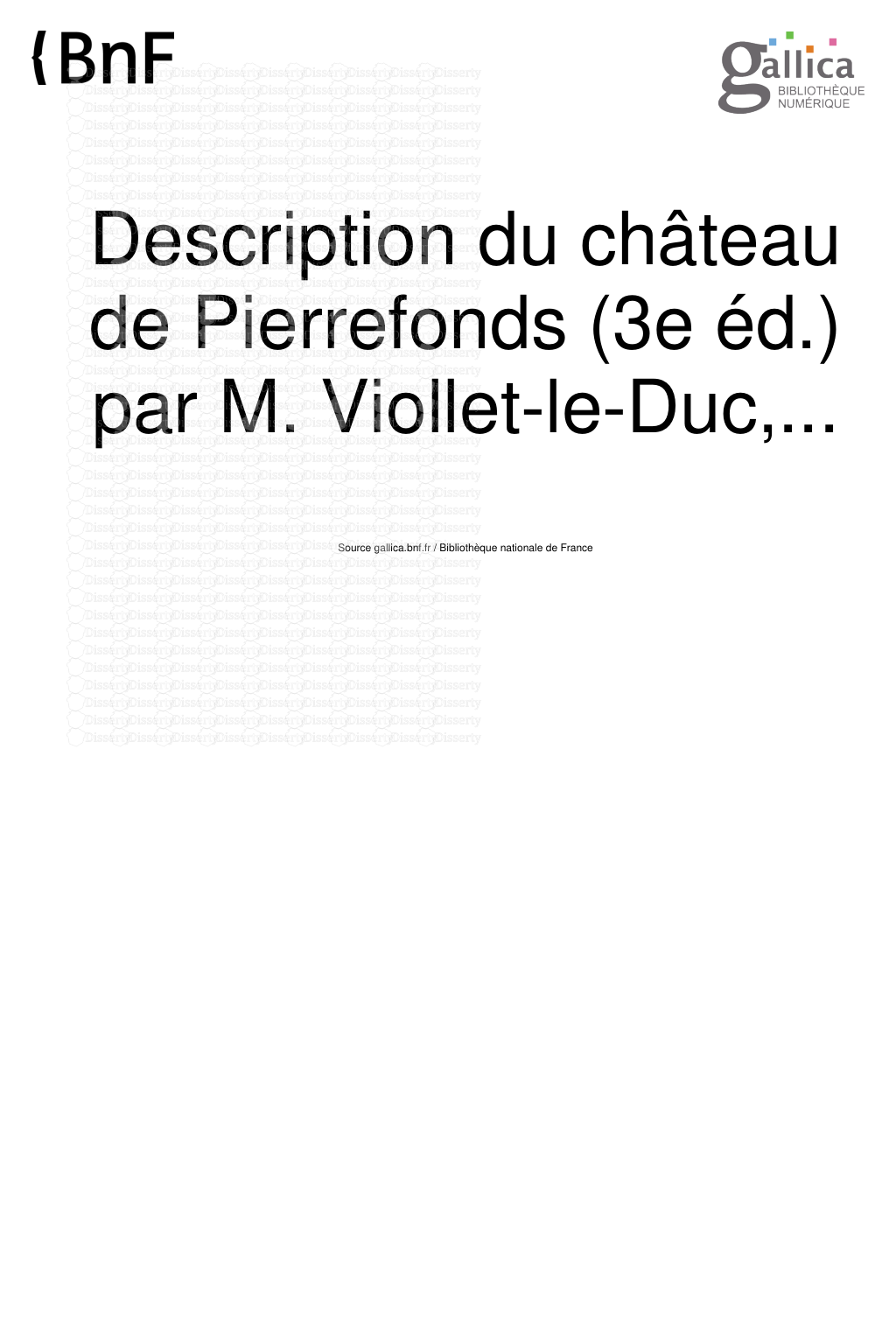






-
58
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 10, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.0829MB


