DROIT ADMINISTATIF Livres : Hachette JC Ricci + LGDJ, Broyelle + Larcier La jus
DROIT ADMINISTATIF Livres : Hachette JC Ricci + LGDJ, Broyelle + Larcier La justice administrative 4 modèles : 1. Le modèle britannique = unité des juridictions. Il n’y a pas des juridictions administratives distinctes. 2. Le modèle allemand = s’est exporté en Autriche et dans des pays de l’est. Il existe plusieurs ordres juridictionnelles : 5 = civile, administrative, pénale, sociale (du travail), commerciale La deuxième caractéristique = l’obligation du recours administratif avant de saisir le juge administratif. La saisine du juge se fait après une demande à l’administration de revenir sur sa décision. La précision très stricte de l’intérêt à agir. On peut attaquer un acte que si on est affecté par lui. Il est très difficile de contester un règlement pare que le règlement comporte des dispositions générales et impersonnelles. La conséquence est que le contentieux administratif allemand se limite au recours contre des décisions individuelles. Difficile de démontrer l’intérêt à agir pour un règlement. La quatrième : l’effet suspensif du recours. Le recours contre un acte suspende l’application. Il y a des exceptions. 3. Le modèle scandinave : une patte importante du contentieux est réglée de façon alternative, en particulier par une institution appelée l’Ombudsman = une autorité avec pouvoirs limités ; l’administration suit ses recommandations est rende inutile la saisine d’un juge. 4. Le modèle français : exporté dans les pays bas, la Grèce etc. Le Modèle français La notion de l’administration. Elle se caractérise par trois éléments : par son BUT = l’intérêt général. Les actes doivent respecter ce but par ses Prérogatives = les prérogatives de puissance publique / prérogatives exorbitants du droit commun. Pouvoirs qui n’existent pas dans les relations de droit privé. Les privées agissent par une libre volonté. L’administration agit parfois par le contrat. L’intérêt général doit prévaloir sur l’intérêt particulier. Exemples : l’acte unilatéral (= l’administration peut unilatéralement modifier une situation juridique, sans l’accord de la personne visée) ; l’expropriation ; par ses ORGANES : 4 types des personnes juridiques : l’état ; les collectivités territoriales/locales ; les établissements publiques = services publique personnifié ; les personnes du droit privé chargés de la mission du service publique (fédérations sportives, associations etc) La soumission de l’administration au droit L’administration dispose du monopole de la violence légitime. Aucune autorité ne se trouve au-dessous de cela (ni étatique, ni internationale). Il résulte que nul ne peut contraindre l’administration au respect du droit. Sans d’être contraindre, l’administration accepte d’être lié par des règles juridiques, de se soumettre aux décisions du juge. Seulement le juge peut obliger l’administration au respect du droit. Les modes alternatives du règlement des conflits C’est sont des techniques de résolution des litiges extérieures à la justice étatique. Jugée par un autre organe que les instances (engl. alternative dispute resolution). Connaissent un développement expliqué par 2 raisons : 1. les caractéristiques de la société contemporaine. Le refus des décisions de l’état 2. encouragement par le juge administrative qui cherche à favoriser les solutions alternatives. La pression du contentieux est forte et le volume montre chaque année. On doit décongestionner les instances du contentieux. Les modes alternatives : 1. le recours administratif : définition = une demande adressé à l’autorité administrative de modifier, d’abroger (mettre fin aux effets pour l’avenir) ou de retirer (agit rétroactivement) un acte. Il est possible d’invoquer des considérations juridiques mais aussi des considérations d’opportunité (pour convaincre l’administration de revenir sur sa décision et sur sa position). Les types de recours administratif : le recours gracieux = devant l’autorité qui a pris la décision le recours hiérarchique = formé devant le supérieur de l’émetteur de l’acte le recours organisé = fait l’objet d’une procédure spécifique et est examiné par un organe collégiale. Assurer un examen plus attentif que les premières deux. Offrent une possibilité de règlement amiable. L’administration peut être convaincu par l’auteur du recours et renoncer à un procès. Un moyen de régler les litiges sans utiliser le juge. Proroger le délai de recours contentieux/juridictionnel. Le délai pour contester est de 2 mois. Si un recours est formé avant l’expiration du délai, il va proroger ce délai. L’administration va répondre. Si on a une décision de rejet un nouveau délai va commencer. = gagner temps supplémentaire pour formuler une requête juridictionnelle. Elles sont facultatives. Des exceptions : cas des recours administratives obligatoires = les RAPO = recours administrative préalable obligatoire. La saisine du juge sans le RAPO est irrecevable. L’augmentation des RAPO = la tendance. En matière fiscale, des visas. L’inconvénient : un démarche supplémentaire à l’administré. 2. la médiation et la conciliation : La conciliation : les parties parviennent elles-mêmes à un accord. (assez peu fréquente) La médiation : la même chose mais grâce à l’intervention d’un tiers. Un caractère facultatif, mais dans des rares cas elles ont un caractère obligatoire. Ce mécanisme était très peu utilisé dans le droit administratif. La loi J21 de 2016 est venue pour apporter des garanties pour les personnes qui vont s’impliquer dans la médiation. Le médiateur doit assurer sa mission avec impartialité, compétence et diligence. La loi ajoute que sa mission est soumise au principe de confidentialité. Ce qui on dit durant la procédure est soumis au secret. La sécurisation des parties par deux innovations : la loi prévoit que la médiation interrompe les délais de recours et de prescription. La rémunération du médiateur : qui va payer, comment fixer la rémunération etc. médiation obligatoire dans le Domain de la fonction publique. Le médiateur rend un avis qui ne s’impose pas aux parties qui sont libre de suivre ou de ne pas suivre le règlement du médiateur. Si les parties acceptent la solution du médiateur, on va faire un transaction/accord/compromis = un contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naitre ou mettent fin à un litige existent en se faisant des concessions réciproques. L’effet de la transaction : elle a l’autorité de la chose jugée. Ça signifie qu’elle a un effet extinctif du litige = le litige ne peut pas être portée devant le juge. Le litige est éteint. Une force obligatoire de la transaction : celui qui s’engage doit respecter son obligation. La transaction n’a pas la force exécutoire d’un jugement. Seul un organe de justice étatique peut donner la force exécutoire. On ne peut pas utiliser les procédés d’exécution contrainte. Il est possible de donner une force obligatoire : la juridiction administrative peut conférer une force exécutoire à la transaction. 3. l’arbitrage : C’est une justice privée. Il faut payer l’arbitrage (très couteau). Le recours est toujours accepté par les parties. Le fait de s’engager dans une procédure arbitrale est volontaire. Dans deux manières : une clause compromissoire : les parties d’un contrat prévoient que si un litige va survenir relativement à l’exécution du contrat, s’est un arbitre qui va intervenir. Le recours est décidé avant que le litige intervient ; la signature d’un compromis d’arbitrage : les parties vont, après la survenance d’un différend, choisissent de le soumettre à un arbitre ; a posteriori. L’arbitre est une juridiction du pont de vue juridique. Il va rendre une sentence arbitrale. La force de cette sentence (comparable à la transaction) : autorité de la chose jugée + effet extinctif du litige. Une fois que les parties ont pris cette décision, elles ne peuvent pas soumettre le litige au juge administratif (on peut supprimer/annuler la clause compromissoire ou le compromis). Pas de force exécutoire, mais il est possible de présenter une demande d’exequatur administratif et si le juge délivre l’exequatur, la sentence devient obligatoire (le juge doit vérifier les conditions : arbitrabilité du litige, respect de l’ordre publique, respecter la procédure). La règle : interdiction pour les personnes publiques de recourir à l’arbitrage. Ce principe connait deux exceptions : pour les contrats internationaux du droit publique ou droit privé. On peut prévoir une clause compromissoire. Une exception législative : la loi a posé un certain nombre des cas (8 cas) : le partenariat public privé peut voir une clause compromissoire. Affaire Tapie. Le dualisme juridictionnel Deux ordres juridiques : juridiction judiciaire (civile, commerciale, pénale ; tgi, tribunaux en matière de commerce, tribunaux de première instance + cour d’appel + cour de cassation) + juridiction administrative (tribunaux administratives + cour d’appel administrative + Conseil d’état). Le volume des décisions administratives sont un gout d’eau dans le système français (300.000). Le raison de ce dualisme. La naissance de la juridiction administrative. 1789 : avant 1789 sous l’ancien régime, les cours de province avaient pris l’habitude de contrôler les actes du pouvoir exécutif, les annulés, alors que cette compétence n’était pas reconnu. Eux textes qui interdissent au juge judiciaire de contrôler l’administration. L’absence du juge ne signifie pas absence du contentieux. Il fallait le régler, mais le seul juge qui existait ne pouvait pas le faire. L’administration a jugé elle-même les recours. Dans un deuxième temps elle se fait assistée par un organe de conseil = le conseil d’état (= système du ministre juge). Le conseil gagne de la légitimité. L’administration ne uploads/S4/ droit-administatif.pdf
Documents similaires







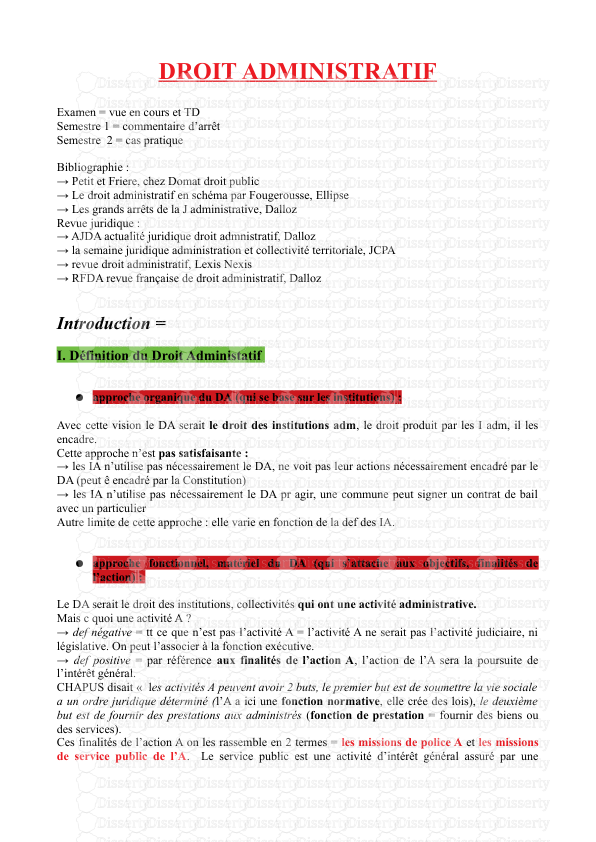


-
91
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 10, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.6456MB


