1 Introduction • Droit public : ensemble des règles relatives à l’existence, à
1 Introduction • Droit public : ensemble des règles relatives à l’existence, à l’organisation, au fonctionnement et aux relations de l’Etat • Droit administratif : ensemble des règles de droit public français qui s’appliquent à l’activité administrative • Lien étroit avec la société • Droit administratif suivant un programme politique, au sens d’organisation de la cité Première partie – l’existence du droit administratif • Pays de Common Law développant à divers degrés de l’administration law. • Droit communautaire : spécificité de l’administration (règles portant sur l’organisation et le fonctionnement des institutions communautaires) o Construction d’un modèle de droit administratif européen • France : type de droit administratif, caractérisé par le primat de l’intérêt général, de la puissance publique, du service public et par le rôle du juge administratif Chapitre 1er ) l’évolution du droit administratif Section 1 -‐ apparition du droit administratif 1. les origines • droit romain : chute de l’empire romain (476) mettant fin à ses institutions et à ses règles • influence du droit canonique : importante administration et le Pape exerçait un pouvoir temporel fort • MA : régime seigneurial + émancipation des villes : sécrétion de structures d’administration, de réglementation, libertés et sujétions et services et rapports d’intérêt commun • Symbole d’une solidarité sociale et d’un pouvoir privilégié mais aussi réglé • Affirmation du pouvoir royal faisant de la France un Etat unitaire : développement d’une administration (non homogène et complexe), + développement de règles (fiscales et polices) • Monarchie absolue : apparition d’un contentieux administratif distinct du contentieux ordinaire, appliquant une procédure propre : annonciation de la séparation de l’administration et de la justice • Edit de Saint Germain 1641 : interdisant aux parlements de connaître des affaires qui peuvent concerner l’Etat, administration et gouvernement d’icelui que nous réservons à notre personne seule • Révolution : inspiration par la philosophie des Lumières o DDHC de 1789 : exigence constitutionnelle de la séparation des pouvoirs o Organisation administrative uniforme : création des communes par la loi de décembre 1789 et des départements par celle de 1790. • Consulat : o Article 52 de la Constitution du 22 frimaire an VIII (1799) créant le CE o Loi du 28 pluviôse an VIII (1800) : institution dans chaque département d’un préfet et d’un conseil de préfecture avec des attributions contentieuses étroites et mise en place du régime de la fonction publique • XIX ème siècle : administration nationale et locale avec ses agents, des juridictions, des droits et des règles, mais absence de droit administratif et de juge administratif 2. la naissance du juge et du droit administratif I. la naissance du juge administratif • loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire : mise en œuvre de la séparation des pouvoirs. Réaffirmée par un décret du 16 fructidor an III. • Théorie des ministres juges puis sur le rapport de ces derniers, le CE chargé à côté de ses attributions législatives et administratives de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative • Conseil de préfecture dont les décisions peuvent être portées en appel devant le CE • CE : donne à l’empereur des avis que ce dernier peut ne pas suivre dans la décision qu’il prend pour régler l’affaire (système de la justice retenue) • Loi du 24 mai 1872 : juge statuant souverainement au nom du peuple français (système de la justice déléguée) • Emergence progressive du contentieux administratif o 1806 : création d’une commission du contentieux o mise en place d’une procédure propre aux affaires contentieuses possibilité de saisir directement le conseil, délai de recours, effet suspensif du recours, débat contradictoire, représentation du requérant par les avocats au conseil • 1831 : institution du commissaire du gouvernement chargé de dire le droit et non de représenter le gouvernement • arrêt CADOT (CE, 1889) : disparition de la théorie du ministre-‐juge. CE en tant que juridiction de droit commun en matière administrative (pouvant être saisie par un administré, sans qu’un texte spécial ne soit nécessaire pour le permettre) • proximité avec le pouvoir politique valant au CE quelques épurations (2 disparitions en 1851 et de 1870 à 1872). 2 • Critiques récurrentes également : conflits de compétence avec la juridiction judiciaire • Tribunal des conflits créé pour les résoudre sous la IIème république en 1872 • Existence de la justice administrative reposant sur la conception française de la séparation des pouvoirs • Vision pragmatique et forte de l’administration, de la conviction de sa nécessaire soumission à des règles objectives et de la volonté de protéger les droits légitimes des administrés. II. la naissance du droit administratif • évolution pragmatique • application du seul corps de règle existant, en particulier le code civil • arrêt BLANCO (TC, 1873) : « la responsabilité qui peut incomber à l’Etat pour les dommages causés aux particuliers par le fait de personnes qu’il emploi dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier » (pétition de principe). « cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue, elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés ». • Arrêt BLANCO o Donne au juge administratif son caractère prétorien o Liaison de compétence (du juge) et du fond (du droit) o Droit administratif : régime exorbitant de droit commun o Débat sur les critères de compétence du juge et de l’application du droit o Equilibre essentiel du droit administratif • D’autres arrêts CE ? 1903 Terrier et CE, 1910, Thérond : pour le contentieux contractuel des collectivités territoriales • Produit d’une politique jurisprudentielle dans sa continuité III. la naissance de la matière universitaire • Hauriou : droit administratif fondé sur la puissance publique, l’ordre public, la police • Duguit : droit administratif comme un instrument de solidarité sociale fondée sur le service public Section 2 – Constantes et changements 1. Constantes • Stabilité reposant sur la permanence de l’objectif poursuivi • Recherche des équilibres nécessaires à la société, entre les pouvoirs de l’administration et les droits des citoyens • Impossibilité de tracer de manière définitive et parfaitement précise les frontières du droit administratif et de s’accorder sur le critère d’application de ses règles • Très dépendant de l’intensité et des modalités variables de l’intervention de l’administration dans la vie économique et sociale 2. Changements I. l’évaluation des sources du droit administratif • dialogue entre la loi et le juge • sources constitutionnelles • apport du droit européen communautaire et de celui de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales • conseil d’Etat : appropriation jurisprudence reprenant une place prépondérante dans la modernisation du droit administratif II. la distribution des pouvoirs • droit administratif soumis à la volonté du pouvoir politique démocratiquement désigné par les électeurs • vague de décentralisation • transfert de compétences • nationalisation puis privatisation III. la conception des personnes publiques et privées • forte opposition entre personnes publiques et personnes privées • banalisation des personnes publiques o répression pénale des personnes morales o droit de la concurrence (CE, 1997, Société Million et Marais). Chapitre 2 – la place du droit administratif dans l’ensemble du droit • trois éléments : o un élément organique et fonctionnel : le droit administratif est celui de l’administration, de l’action administrative ou d’une partie des activités du gouvernement et des autorités décentralisées. 3 o Un élément historique et structurel : le droit administratif ne contient pas toutes les règles qui s’appliquent à l’administration mais seulement celles qui dérogent au droit privé o Un ou des éléments matériels (ces règles reposent sur le service public ou sur la puissance publique, voire les deux) Section 1 – le droit administratif, sous ensemble du droit public 1. le droit public • ensemble des règles juridiques relatives à l’existence, à l’organisation, au fonctionnement et aux relations de l’Etat • souveraineté, en tant que puissance initiale • souveraineté : notion complexe. Puissance publique en vertu de laquelle son titulaire a la compétence de sa compétence o Etat disposant d’une entière maitrise des objets dont il s’occupe et des règles qu’il pose et qu’il respecte. o Existence d’autolimitation : il a posé lui-‐même les règles qui fondent et qui encadrent ses pouvoirs ou qu’il y a consenti. 2. l’appartenance du droit administratif au droit public • tronc commun • continuité de l’Etat, sécurité, respect des compétences, respect des droits fondamentaux : exigences fondamentales, celles de l’Etat de droit : Etat devant respecter les règles de droit, sous le contrôle du juge • de la souveraineté de l’Etat : principal moyen juridique d’action de l’administration : la puissance publique Section 2 – le droit administratif, droit de l’activité administrative • régit l’action administrative de l’Etat 1. l’activité administrative • fonction législative et fonction judiciaire échappant au droit administratif. Fonctions distinctes de la fonction administrative • activité administrative consistant en la fourniture aux citoyens de prestations juridiques et matérielles : droit uploads/S4/ droit-administratif-pdf 4 .pdf
Documents similaires







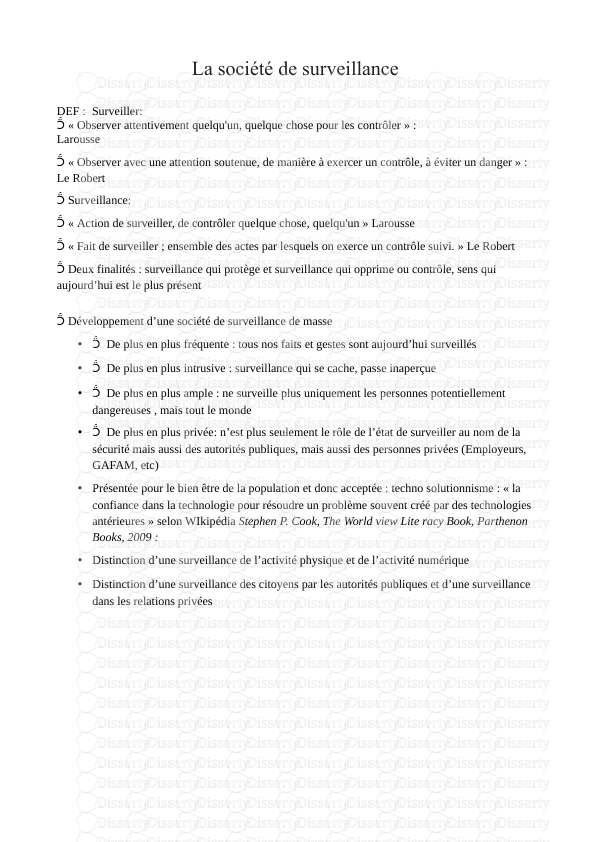


-
37
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 12, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.5069MB


