Droit Civil. 05/02/13 Une note de cours. Une note de TD. Une note de Galop d'Es
Droit Civil. 05/02/13 Une note de cours. Une note de TD. Une note de Galop d'Essai. Un commentaire d'arrêt. Cours organisé en deux parties : 1 : La responsabilité civile delictuelle. 2 : Les quasis-contrats (très court). Introduction. Matière extrêmement large : il y a toujours eu, il y aura toujours des accidents, de manières diverses. La question est : Qui supporte la charge des dommages qui sont subis à l'occasion de ces accidents ? Au sens très large, la responsabilité civile est « l'obligation mise par la loi à la charge d'une personne de réparer un dommage subit pas une autre. » (Définition de Flour/Aubert). La responsabilité créée véritablement un rapport d'obligation, avec une créance et une dette entre les parties. Si la loi n'intervient cependant pas, cela revient à mettre la charge du dommage sur les épaules de la seule victime : partout où la loi ne prévoit pas de réparation, la victime n'a finalement pas eu de chance. On parle de responsabilité délictuelle, de responsabilité extra-contractuelle (quasi-synonymes). Délictuelle : appellation historique de la matière. Elle fait référence au délit : faute de l'auteur du dommage. Aujourd'hui l'expression est critiquée, parce que le fondement n'est plus aujourd'hui seulement délictuelle. On parle également de responsabilité de plein-droit. A côté, il y a les responsabilité quasi-délictuelle : faute par imprudence dans la plupart des cas. On parle de responsabilité extra-contractuelle : pour faire la différence avec la responsabilité contractuelle. Serait donc une responsabilité extra-contractuelle tout ce qui n'est pas dans le contrat. Nous allons voir que ce n'est pas aussi simple que cela. 1). Les fonctions de la responsabilité. A. Réparation. C'est une justice commutative. On ne gagne pas, on obtient uniquement la réparation de ce que l'on a perdu. (/!\ L'introduction est la base du commentaire → Toujours y revenir). Le système est fondé autour de ce que l'on appelle la faveur à la victime, à la fois dans la jurisprudence et chez le législateur. Une faveur à la victime sans limite est impossible. Idéologie de la réparation. B. La sanction. Notion historique qui a diminué au fur et à mesure des années. Cependant, on ne peut l'ignorer. La responsabilité a une fonction dissuasive, pédagogique et même une prévention du dommage. C. Fonction préventive. On trouve des traces de ces fonctions dans plusieurs mécanismes. D'abord via la faute d'imprudence (le quasi-délit), et à travers l'apparition de nouveaux principes, notamment ce que l'on appelle le principe de précaution. Principe lié de près à l'idée de risque. De plus en plus, les justiciables sont confrontés à des risques de développement/risque d'atteinte à l'environnement. Un grand nombre d'affaire sont liées à ce principe : sang contaminé, amiante, maladie de la vache folle. L'idée du principe de précaution, c'est qu'en l'absence de certitude, on devrait prendre des mesures préventives pour éviter les possibles risques. Certains textes de loi vont imposer ce principe de précaution. Si cela n'a pas été respecté, cela va engager la responsabilité des personnes qui y était soumises. On les retrouve en matière d'environnement : Article L 110-1 du Code de l'Environnement par exemple. En 2005, le principe de précaution en matière d'environnement est devenu constitutionnel : Article 5 de la Charte. Le principe de précaution ne devait s'adresser qu'aux autorités publiques. Aujourd'hui cependant, ce principe s'applique en responsabilité civile. Cela est contesté mais il y a bien application. Exemple : 3 Mars 2010 de la 3ème Chambre Civile. http://legifrance.org/affichJuriJudi.do? oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021928716&fastReqId=32344853&fastPos=1 Fermeture d'une forage d'une source d'eau minérale. La responsabilité civile délictuelle est traitée par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation : Lorsque la Chambre n'est pas précisée, on peut présumer que c'est la 2ème. 2). Les différents fondements. 4 Fondements. • La Faute. • Le Risque. • La garantie. • La solidarité : la sécurité sociale n'est ni plus ni moins que de faire supporter les maladies et les accidents impliquant des soins médicaux. A. La Faute. Article 1382 du Code Civil. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'obligation de réparer ne peut être qu'exceptionnelle, ne peut être engagée que s'il commet véritablement une faute. Exceptionnelle : on est en matière de fait juridique, et non en matière d'acte. La volonté est donc a priori inexistante. On peut commettre une faute volontairement, mais la question n'est pas là. C'est un fait : la personne n'a pas voulu entraîné des conséquences juridiques. La responsabilité doit donc être pleinement justifiée. Aujourd'hui, ce fondement est en perte de vitesse : on assiste au développement de responsabilité de plein droit, objectives, c'est à dire sans faute. (/!\ On affirme pour l'instant c'est la même chose. Plus tard, il ne faudra pas confondre les notions). Au départ, la responsabilité sans faute était conçue comme une simple dérogation. La jurisprudence a modifié cet état de chose. La responsabilité du fait des choses est une responsabilité objective. La responsabilité du fait d'autrui peut être sans faute également. La responsabilité contractuelle (par exemple pour l'obligation de résultat) dispense de prouver la faute. XIXème siècle : Il a commencé à être extrêmement difficile de déterminer l'auteur du dommage, et de caractériser la faute d'une personne (machines, ouvriers). La victime, souvent un ouvrier, se retrouvait sans possibilité de réparation. Parallèlement au nouveau type de dommage créé, on a une tendance à s'intéresser à la victime. On se centre d'avantage sur la victime, on recherche en permanence la sécurité, et on estime que le dommage est une véritable injustice. Aujourd'hui, on recherche immédiatement un responsable : dans la liste de tous les acteurs, qui est le plus solvable, qui est responsable. Perte du terrain de la responsabilité pour faute en faveur de la théorie du risque. B. Le risque. L'idée de fonder la responsabilité sur le risque revient à dire que celui qui a une activité risquée, qui cause le risque de dommage par son activité, même s'il ne commet pas spécialement de faute, doit réparer les dommages causés par son activité. On distingue différents types de risques. Risque au sens strict. Risque profit : risque par quelqu'un qui tire profite d'une activité. Par exemple l'employeur. Risque danger : certains régimes de responsabilité (circulation, dommages nucléaires...) sont fondés sur le fait qu'une activité est particulièrement dangereuse. Risque autorité : responsabilité du chef, de celui qui commande. En droit positif, il n'y a pas de loi, de code qui caractérise la responsabilité pour risque. C'est une interprétation doctrinale. On estime que certains régimes sont plutôt fondés sur le risque. C'est le cas de la responsabilité du fait des choses, de la responsabilité en cas d'accident de la circulation. C'est le cas de la responsabilité du fait d'autrui. Attention : ce n'est pas un fondement général de la responsabilité. Le risque ne remplace pas la faute. Le risque la concurrence. Exemples : Les dommages causés par un avion aux personnes et aux biens qui se trouvent au sol. Les accidents du travail. Les dommages causés à l'occasion de la production ou l'utilisation de technologies nucléaires. On assiste à ce que l'on appelle la socialisation des risques : on essaye de répartir la charge qui résulte de l'obligation de réparation. Cela se manifeste de deux façons : Le développement des assurances (permet à la jurisprudence de prendre plus de liberté) facultatives ou non, ce qui n'empêche pas d'avoir des responsabilités extrêmement sévère (responsabilité des parents vis à vis de leurs enfants). (→ Assurer ses gosses !) Système d'assurance : collectivisation des risques. La prise en charge de certains dommages, de certaines hypothèses de dommage par l’État lui-même. Dans certains domaines, il existe des mécanismes de solidarité nationale pour indemniser les dommages. On pense tout de suite à la sécurité sociale, mais ce n'est pas le seul. Il y a un fond d'indemnisation pour les victimes d'infraction, et un fond pour les catastrophes naturelles et météorologiques. La socialisation du risque amène à parler de la garantie. C. La Garantie. La loi encourage, et parfois impose la conclusion d'assurance de dommage. Notamment pour l'automobile, en matière de chasse (il y a plus d'accident qu'on le croit)... Il y a une double influence : le développement d'assurance est le résultat du développement de la sévérité des régimes de responsabilité. Mais la responsabilité subit l'influence du développement des assurances. Droit comparé. Il existe des divergences, même derrière des mots identiques, y compris au sein du système juridique européen. Ces divergences sont extrêmement fortes. Le droit français fonctionne autour de ce que l'on appelle des clauses générales de responsabilité. Cela signifie que derrière ces clauses, ces principes, ces mécanismes, on peut engager tous les types de fautes, de dommages... On a une très grande marge d'appréciation a partir d'un petit texte (l'Article 1382). Le Droit Anglais énumère un grand nombre de délits spécifiques. Il énumère les fautes qui engagent la responsabilité. Le Droit Anglais recense plus de 70 délits spéciaux. Il faut caractériser à chaque fois un certain type de faute, et un remède. Il existe en droit uploads/S4/ droit-civil-2-mme-debourg.pdf
Documents similaires








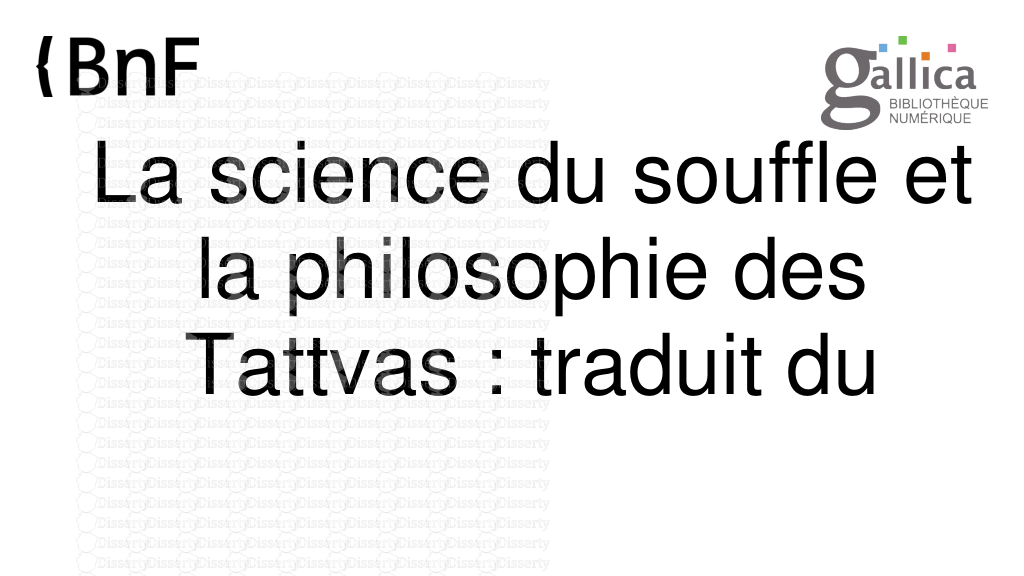

-
66
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 20, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.4557MB


