Introduction : I. La définition du droit commercial : Le droit commercial se co
Introduction : I. La définition du droit commercial : Le droit commercial se conçoit comme celui dont l’objet est de gouverner le commerce. Deux conceptions possibles : - Subjective ou personnaliste : selon laquelle le droit commercial est le droit applicable aux commerçants. Conception du droit allemand qui prend en considération des personnes. - Objective : selon laquelle le droit commercial est le droit applicable aux activités du commerce quel que soit leur auteur. Solution de compromis, bien que la deuxième solution sembla l’emporter. En effet, la notion d’acte de commerce est visée en tête du code du commerce ainsi le droit commercial constitue une composante du droit privé qui s’applique aux commerçants et à certains actes juridiques effectués par les commerçants soit entre eux soit avec leur clients, c’est-à-dire les actes de commerces. A. La notion de commerce : La définition du commerce n’est pas évidente dans son sens général, elle correspond à la conception romaine le commerce qui désigne tout échange quel qu’en soit l’objet et les modalités, tous les rapports juridiques que les êtres humains entretiennent, notamment à l’utilisation de leur biens. Dans un sens plus étroit, le terme de commerce ne désigne que les activités de circulation, des richesses à l’exclusion des activités industrielles et des activités de consommation. Ces conceptions sont extrêmes, l’une trop vague et l’autre trop restrictive et elles se sont avérées incomplètes, si bien qu’il a fallu dégager une conception intermédiaire. En effet, le commerce englobe les activités industrielles, de production ainsi que des activités connexes telles que la banque, le transport, les assurances. Il s’avère alors qu’une très grande partie des activités économiques relève du droit commercial pour autant, ce domaine n’est pas général car de nombreux secteurs économiques échappent encore, notamment pour des motifs sociologiques et historiques c’est le cas des activités agricoles, artisanales, immobilières et libérales. Lorsqu’elles ne s’exercent pas dans le cadre des sociétés commerciales, elles sont de nature civile. B. Les mutations de la notion de droit commercial : Le droit commercial classique, conçu comme la partie du droit privé qui s’occupe des opérations juridiques faites par les commerçants, s’est progressivement enrichie d’apports nouveaux constitués par des éléments de droit privé et de droit public. Il s’agit donc d’apport du droit public économique, du droit fiscal et du droit social, il a donc paru nécessaire de bâtir des concepts nouveaux de portée plus large susceptibles d’envelopper toutes les règles juridiques applicables à l’entreprise. Ainsi sont nées des expressions plus ou moins analogues tel que le droit des affaires, le droit économique ou encore le droit de l’entreprise. Ces termes tendent aujourd’hui à supplanter le droit commercial. Cette expression est devenue un peu trop étroite, néanmoins le terme de droit commercial demeure présent et est encore employé pour désigner certains ouvrages ou certains cours. II. La codification du droit commercial : La codification napoléonienne s’est exprimée en matière commerciale par la promulgation d’une loi de 1807, le code du commerce entré en vigueur le 1er janvier 1808, ce fut un code peu novateur qui pour l’essentiel se contentait de reprendre des normes antérieures, notamment l’ordonnance de Colbert de 1673, et certains usages appliqués par les tribunaux. Il présentait de nombreuses faiblesses dues à une mauvaise préparation et probablement à la méfiance de Napoléon à l’égard des commerçants. D’où vient la multiplication des réformes en dehors du code ? C’est ainsi, qu’à la fin du XVème siècle, le droit commercial était composé de textes spéciaux non intégrés dans le code de commerce et intervenant dans des secteurs aussi divers que celui des sociétés, du chèque, du fonds de commerce ou des faillites . Cette situation particulière conduit à l’abrogation du code de 1807 et à la création d’un nouveau code de commerce, en effet, le Gouvernement sur la base des lois d’habitation a édicté l’ordonnance de 18 sept 2000 qui a instauré de nouveau code de commerce. Ce nouveau code se contente de reprendre dans un seul ouvrage la plupart des anciennes dispositions, on parle de codification à droit constant, c’est-à-dire que les anciennes dispositions en vigueur ont été codifiées tel quel sans qu’il y été apporté des modifications autres que celles imposées par le respect de la hiérarchie des normes, par la cohérence rédactionnelle des textes et par l’harmonisation de l’état du droit. Désormais, l’essentiel du droit commercial se trouve réuni au sein du code de commerce, par ailleurs, il a été institué par une ordonnance du 14 décembre 2000 prise sur la base de la même loi d’habilitation du 16 décembre, un code monétaire et financier qui rassemble toutes les dispositions législatives relatives à la monnaie et aux activités bancaires et financières. III. Les principaux caractères et les raisons d’être du droit commercial : Le droit commercial est un droit en constante, un droit qui a connu une tendance à l’éclatement du fait de la multiplication des textes spéciaux régissent telle ou telle entreprise ou telle ou telle catégories d’activités mais aussi un droit dont on se souci aujourd’hui de l’unification. Néanmoins, la caractéristique majeure du droit commercial réside dans le fait que pour satisfaire les besoins propres du monde des affaires il doit répondre à des impératifs de rapidité et de sécurité. A. Les impératifs de rapidité : Les préoccupations du droit civil et du droit commercial ne sont pas les mêmes à bien des égards. Le droit civil s’intéresse plus à la conservation des biens qu’à leur distribution. Les opérations importantes qui sont plus rares lorsqu’elles sont conclues, requièrent du temps et des formalités de la patience, des vérifications approfondies. A l’inverse la distribution, étant le moteur du commerce, implique rapidité et souplesse du moins en ce qui concerne les opérations les plus courantes telles que vente, transport, assurance, opérations bancaires, par conséquent, le droit commercial a supprimé les formalismes en établissant certaines règles ou techniques originales. Ex : la liberté de la preuve, la place importante à la théorie de l’apparence, la réduction des délai de prescription, la simplicité des techniques de transmission des créances, la simplicité des techniques particulières, la simplicité des modes de règlement des modes de contentieux. B. Les impératifs de sécurité : Ces besoins de sécurité se sont manifestés à 2 égards. 1. Les procédés particuliers de crédit : Pendant très longtemps le recours au crédit a été la panache des commerçants pour financer leurs activités de négoce. Le droit commercial a alors imaginé des techniques particulière de mobilisation des créances la plus ancienne de ces techniques est la lettre de change appelée aussi traite par le moyen de l’escompte. L’escompte est l’opération par laquelle un banquier avance aux porteurs de l’effet du commerce le montant de cet effet quand le transfert de la propriété de cet effet est sous la déduction de la somme appelée escompte. Plus tard sont apparus d’autres procédés de financement soit de la pratique soit de décisions de législateurs pour remédier au formalisme du régime civil. L’affacturage qui est la cession par un vendeur de biens ou de services qu’on appelle l’adhérent la cession de créance qu’il détient sur ses biens. Un factor qui lui règle le montant de ses créances moyennant un versement, par conséquent, il opère une sélection parmi les créances qu’il achète. Le crédit-bail : allocation financière qui permet le financement d’un bien avec option d’achat à l’issue de la période de location. L’ouverture de crédit par laquelle un banquier s’engage à mettre dans la firme un financement d’un bien, une somme d’argent à la disposition du client en une ou plusieurs fois. Bordereaux de créances professionnelles créés par une loi de 1881 cette technique permet à un titulaire de créance professionnelle de céder à un banquier une série de ses créances regroupées dans un bordereau. La remise d’un tel bordereau au banquier investit celui-ci sans formalités de toutes les créances qui sont visées éventuellement des suretés dont elle bénéficiait. Cette cession doit être modifié mais sans formalités particulières. 2. Les garanties particulières de paiement : L’importance du crédit en matière commerciale a rendu nécessaire un renforcement des mécanismes de protection des créanciers afin d’assurer la sécurité des transactions. Ex : - La présomption de solidarité passive qui est la règle en matière commerciale. En matière commerciale lorsque 2 débiteurs sont redevables de la même dette à un même créancier ce dernier peut réclamer le paiement intégral à l’un des 2. - La rigueur du droit cambiaire c'est-à-dire des effets de commerce notamment la lettre de change ainsi, tous ceux qui apposent leur signature sur une traite effectuent un acte de commerce et sont solidairement responsables envers le débiteur de plus la loi supprime les délais de grâce et écarte le principe de l’opposabilité des exceptions qui permet au débiteur cédé de résister à la demande par les porteurs de la créance en lui opposant tous les moyens de défense qu’il aurait pu opposer à son créancier initial il convient également, de signaler le caractère répréhensible de l’émission d’un chèque sans provision. Depuis la loi du 30 décembre 1991 l’émission de chèques uploads/S4/ droit-des-affaires 19 .pdf
Documents similaires









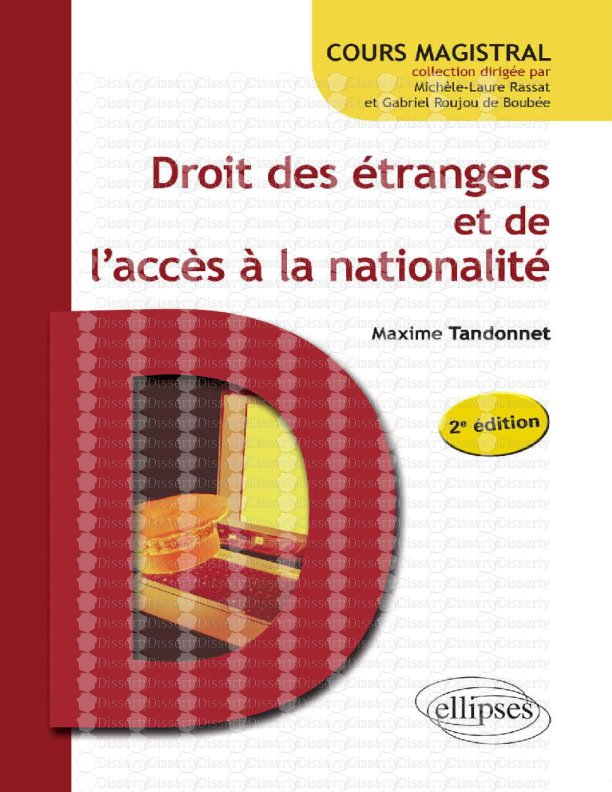
-
98
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 17, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.7054MB


