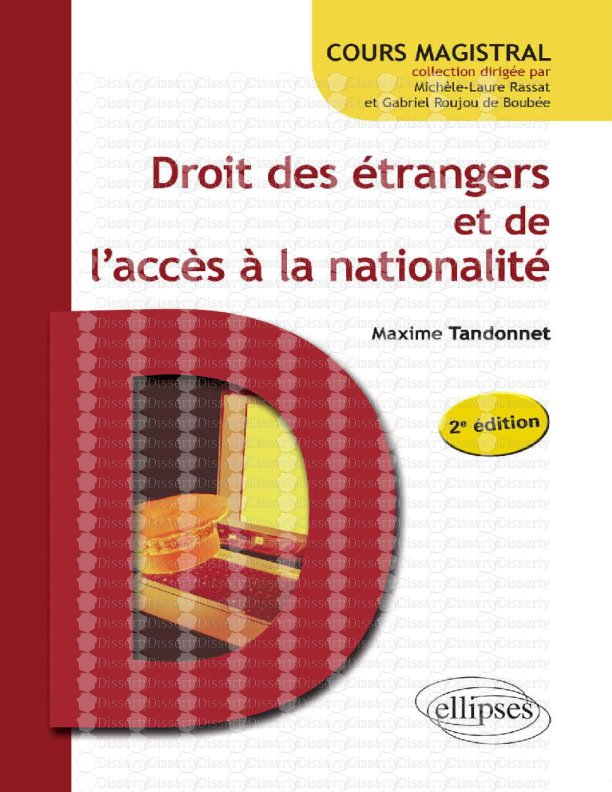DANS LA MÊME COLLECTION Contentieux constitutionnel, 2e éd., Valérie Goesel-Le
DANS LA MÊME COLLECTION Contentieux constitutionnel, 2e éd., Valérie Goesel-Le Bihan Droit administratif, 3e éd., Degoffe Michel Droit pénal spécial, 2e éd., Emmanuel Dreyer Droit des obligations, Daniel Mainguy et Jean-Louis Respaud Droit électoral, Bernard Maligner Droit des sûretés, 2e éd., Stéphane Piedelièvre Droit des partis politiques, Yves Poirmeur et Dominique Rosenberg Droit pénal général, 3e éd., Michèle-Laure Rassat Institutions administratives et juridictionnelles, Michèle-Laure Rassat, Jean-Michel Lemoyne de Forges et Patricia Lemoyne de Forges Philosophie du droit, 2e éd., Alexandre Viala Introduction générale 1. Le Droit des étrangers et l’accès à la nationalité française – Le droit des étrangers et le droit de la nationalité sont deux notions qui diffèrent tout en étant complémentaires. Le droit des étrangers concerne le statut des personnes qui sont extérieures à la communauté nationale mais souhaitent entrer ou résident sur le territoire français. Il relève du récent Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) depuis les années 2000, codiāant un grand nombre de textes, dont l’ordonnance du 2 novembre 1945, amendée à de multiples reprises. Le sujet est traité par le ministère de l’Intérieur. Il échappe en partie à la souveraineté nationale. Aujourd’hui, l’essentiel des normes concernant le droit des étrangers est issu des traités internationaux, en particulier la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 et du droit communautaire depuis le traité d’Amsterdam signé le 2 octobre 1997, même si le législateur français conserve une marge de décision. En revanche, le droit de la nationalité, relatif au statut qui s’attache à la qualité de Français dépend du Code civil de 1804, relève de la souveraineté nationale, du domaine de la loi selon l’article 34 de la Constitution. Il dépend principalement du ministère de la justice en France. Pourtant, les deux sujets sont liés, sinon imbriqués à travers l’acquisition de la nationalité française – traitée dans le présent ouvrage – c’est-à-dire l’entrée du ressortissant étranger dans la communauté nationale. La plupart des textes de loi sur l’immigration traitent des deux sujets en parallèle. En effet, l’acquisition de la nationalité française est en général l’aboutissement d’un parcours des étrangers en France : entrée sur la base d’un visa de long séjour d’un an ou de la délivrance d’une carte de séjour temporaire puis obtention d’une carte pluriannuelle de deux ou quatre ans, ensuite obtention de la carte de résident de 10 ans, et enān naturalisation, en moyenne une dizaine d’années après l’entrée en France. L’acquisition de la nationalité bénéācie à environ 100 000 personnes chaque année. Cet ouvrage est donc organisé sur une base chronologique, partant de l’entrée et du séjour des étrangers qui peut déboucher sur l’acquisition de la nationalité française. Le droit des étrangers a connu, en quatre décennies, une transformation profonde. Jusqu’au milieu des années 1970, il relevait pour l’essentiel du pouvoir du Parlement et d’une prérogative discrétionnaire du gouvernement. Quarante ans après, le champ d’action des politiques nationales en matière de droit des étrangers se voit, dans toutes les démocraties européennes, fortement encadré par le développement du contrôle de constitutionnalité, l’extension des possibilités de recours contre les décisions de l’administration, l’essor de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le transfert partiel de compétence à l’Union européenne par le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, les normes et les jurisprudences qui en découlent notamment de la Cour de Justice de l’Union européenne, s’imposant désormais comme une source majeure du droit des étrangers. L’internationalisation du droit des étrangers correspond à une réalité de fait : les phénomènes migratoires se déroulent à l’échelle de la planète et des continents. Son objectif est la protection du droit des personnes tout en préservant certaines marges de décision des États en matière de droit de l’entrée et du séjour. Sans doute est-elle partiellement inévitable dans un monde moderne et ouvert. L’idée d’un retour à un traitement purement national et politique de ces questions semble irréaliste et incompatible avec la cohérence du droit dans le temps et dans l’espace. Dès lors que la circulation et les migrations sont devenues un aspect essentiel du monde moderne, leur régulation et traitement juridique doivent intervenir, au moins en partie, à l’échelle internationale. De même, l’essor spectaculaire du rôle des juridictions en matière de droit des étrangers est généralement justiāé par la garantie qu’il offre à ces derniers contre le risque d’arbitraire et d’instabilité juridique. Cette évolution a cependant pour effet de réduire progressivement la marge de manœuvre des dirigeants nationaux en la matière, des Parlements élus et des gouvernements, étant de fait largement dépossédés de leur pouvoir régalien en ce domaine. À cet égard, elle encourt le reproche d’être en contradiction avec les souverainetés et démocraties nationales. Tout l’enjeu de cette matière tient dans la déānition d’un équilibre entre l’exercice de la démocratie nationale et la prise en compte de la dimension universelle des phénomènes migratoires. Le droit des étrangers et de l’accès à la nationalité représente une part considérable et croissante dans l’activité des juridictions administratives. En 2017, le contentieux des étrangers représentait 33,5 % des saisines des tribunaux administratifs, 48,1 % de celles des cours administratives d’appel (en hausse de 8 %) et 21,8 % du Conseil d’État1. Cette évolution correspond à l’importance de plus en plus marquée des questions liées à la gestion des Ăux migratoires, à l’accueil et à l’intégration des populations étrangères dans la société française. Ce thème est appelé à prendre une place toujours plus considérable dans la vie juridique des États modernes. Le présent ouvrage, à jour des toutes dernières évolutions européennes, législatives (loi du 10 septembre 2018), et jurisprudentielles, a pour objectif de fournir une vision synthétique des aspects les plus essentiels et les plus actuels du droit des étrangers et de l’accès à la nationalité, en France, sous un angle à la fois théorique et opérationnel, dans son contexte européen et international et dans son environnement historique, idéologique, politique, social et démographique. 1. Le contentieux des étrangers toujours en hausse, par Marie-Christine de Monteclerc, citant le rapport d’activité 2018 du Conseil d’État, AJDA n° 17/2018 du 21 mai 2018. Chapitre 1 Contexte général, géopolitique, historique I. Les enjeux du droit des étrangers 2. La montée en puissance d’un sujet de société – Longtemps, au XIXe et au XXe siècle, le continent européen a été marqué par une différence entre les pays d’immigration ou d’accueil, la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et les pays d’émigration, de départ, la Grèce, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, l’Irlande. Depuis le milieu des années 1990, tous les pays européens sont devenus des pays d’immigration, avec un phénomène de rattrapage rapide au sud de l’Europe. Les nations européennes, se voulant issues principalement de populations d’origine ancienne, ont souvent été opposées aux pays d’Amérique du Nord, forgés au āl des siècles par l’immigration. Les États-Unis comme le Canada se déānissent comme des nations de migrants. Aujourd’hui, ce clivage entre l’Europe et l’Amérique est en voie d’être dépassé dans les faits. Depuis 2010, l’Union européenne à 28 accueille à des āns de séjour durable et régulier environ 2 millions de ressortissants de pays tiers, ou non nationaux d’un État membre chaque année, soit le double des États-Unis1. L’arrivée supplémentaire de plus d’un million de migrants en Europe en 2015 par la Méditerranée, en dehors des voies légales, fuyant les situations de guerre ou de dictature au Moyen-Orient ou en Afrique, a profondément bousculé le vieux continent et remis en cause nombre de certitudes. L’immigration et le droit des étrangers sont des sujets de société qui ne peuvent pas échapper à une approche politique. Pour autant, on ne peut que déplorer leur récupération à des āns électoralistes qui attise les passions et les tensions tout en éloignant de l’action en vue d’améliorer la réalité. Mais au-delà de ces phénomènes, deux courants de pensée se trouvent généralement face à face sur ces questions. 3. La société ouverte – En général, les milieux d’un niveau socioprofessionnel élevé voient dans l’immigration une valeur plutôt positive. L’étranger est ressenti à la fois comme une personne qui, souvent, fuit la misère, et une source de richesse, par la diversité culturelle, le renouvellement démographique et son apport sur le plan économique. L’ouverture est une vertu qui bénéācie à l’individu comme à la société d’accueil. Cette sensibilité s’est particulièrement exprimée dans le célèbre ouvrage de Bernard Stasi L’immigration est une chance pour la France, publié en 19842. Elle s’exprime aussi à l’échelle planétaire : « L’histoire nous enseigne que les migrations améliorent le sort de ceux qui s’exilent mais aussi font avancer l’humanité tout entière3 » soulignait M. Koā Annan, secrétaire général de l’ONU. Dans cette vision se retrouvent le monde économique, qui voit dans la liberté d’immigrer la possibilité d’accueillir un renfort de main-d’œuvre, tout comme les défenseurs des droits de l’homme : « La migration internationale est l’un des principaux facteurs de transformation du monde dans lequel nous vivons4 ». Elle est donc au cœur des valeurs dominantes dans les milieux dirigeants ou inĂuents qui la considèrent comme un bienfait et une nécessité, uploads/S4/ droit-des-etrangers-et-de-l-acces-a-la-nationalite-2e-edition-cours-magistral-maxime-tandonnet.pdf
Documents similaires










-
67
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 25, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 2.4498MB