Droit international privé > > > I Introduction : présentation générale. Evoluti
Droit international privé > > > I Introduction : présentation générale. Evolution historique. Source du droit. > > > Présentation générale : Expression du 19ème siècle par opposition au droit international public qui vise les relations entre états, alors que le privé : est le droit des relations privées de caractère international. Henri Batiffol : ensemble des règles applicables aux seules personnes privées dans les relations de la société internationale. La division du monde en état souverain est la raison d'être de ces matières, chaque état étant doté de ses propres lois les relations publiques comme privées doivent être organisées par le droit. Au plan du DIP cette division du monde en différents états fait d'abord apparaître deux catégories de sujets. On distingue les nationaux, et les étrangers. C'est ainsi que le DIP va porter sur les règles relatives à la nationalité. Elles sont presque exclusivement nationales, ils existent un principe issu du DIPublic selon lequel chaque état détermine souverainement ses nationaux. En France les règles relatives à la nationalité française, son attribution, perte, déchéance, se trouvent dans le code civil 17 et suivant. Corrélativement le DIP porte aussi sur la condition des étrangers, il s'agit d'étudier les restrictions apportées à la jouissance des droits des étrangers au plan du DIP. Cette question a connu une évolution considérable. Avant l'étranger ne se voyait reconnaître quasiment aucun droit, puis des droits lui ont était reconnu sous réserve de réciprocité. Mais depuis 1948 la CC a posé un principe d'égalité entre les étrangers et les nationaux quant à la jouissance des droits. Les étrangers jouissent en France des droits qui ne leur sont pas spécialement refusés. Mais pour cela encore faut il que les étrangers puissent entrer en France et y séjourner. Or il existe à cet égard, des règles strictes, qui concernent l'immigration et qui figurent dans un code : de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. CESEDA. > Les conséquences ne sont pas minimes quant aux relations juridiques nouées entre ces personnes. On débouche sur le deuxième thème du DIP : droit des conflits. Il s'agit des conflits de lois, d'autre part, des conflits de juridictions. Les conflits de lois conduisent à s'interroger sur la loi applicable à telle situation présentant un caractère international (un couple franco-anglais se marie en France puis va s'établir en grande Bretagne, on peut se demander par exemple quelle est la loi applicable à leur régime matrimoniale ; un contrat entre une société allemande et une société française et devant être exécutée en Belgique.) Les conflits de juridictions posent le problème de la compétence judiciaire internationale, en présence d'un litige international, quel est l'état dont le tribunal peut être saisi? Quel est l'effet en France des jugements rendus à l'étranger? Les deux types de conflits entretiennent des rapports étroits. Le DIP est, en somme, propre à chaque état. Evolution historique : la perception des différents problèmes engendrés par la diversité des lois a été très progressive, historiquement on distingue une phase pré doctrinale qui va de l'antiquité jusqu'au haut moyen-âge, puis une phase d'apparition des grandes doctrines allant du 13 au 18ème siècle et enfin l'époque contemporaine. > > > > II) Évolution Historique > a) L'ère pré-doctrinale : l'antiquité primitive connaissait la distinction entre le citoyen et l'étranger. Mais l'étranger ne se voyait reconnaître aucun droit. En effet soit l'étranger était un ennemi (esclavage, emprisonné, tué) soit l'étranger était ami et bénéficiait des lois de l'hospitalité. Il n'y avait pas vraiment de conflit de loi car il n'était pas vraiment sujet de droit. Pour le droit romain, le droit n'était applicable qu'aux citoyens romains : Jus Civile. Pour les étrangers des régions conquises les Pérégrins on appliquait le Jus Gentium qui ne concernait que les relations d'affaires (mixte ou extra). Mais pour les relations de familles, les prêteurs pérégrins avaient admis l'application des lois du pays d'origine : les lois pérégrines. Cette situation prend fin en 212 avec le décret Caracalla qui a conféré la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'empire. Les invasions barbares du 5ème siècle fait basculer la situation (déferlantes de Wisigoths, Francs, Burgondes etc). Ils ont chacun leurs propres lois. Le système qui va s'appliquer alors est le système de la personnalité des lois. Chaque groupe ethnique demeure soumis à sa propre loi. Ce système dure 3-4 siècle puis une évolution se produit. D'une part une fusion des populations s'opèrent (mariage mixte) en même temps le développement de l'économie rurale va fixer ces personnes sur un territoire donné. Un autre facteur est la fusion des institutions. Les lois du groupe le plus nombreux dominent, mais de nouvelles règles apparaissent. On passe de la personnalité à la territorialité qui va se renforcer avec l'apparition de la féodalité caractérisée par le morcellement du pouvoir politique. Ainsi la loi de la seigneurie s'applique à tous ceux qui sont domiciliés à tous les biens qui s'y trouve et à tous les actes qui sont passés. C'est un système fermé. Simplement si une situation se rattache à plusieurs territoires différents, le juge saisi applique sa propre loi ce que l'on appelle la loi du For : lex Fori. > b) Le développement des doctrines : Le changement va apparaître dans le nord de l'italie au 13ème sicècle, en effet on y trouve des villes indépendantes, chacune dotée de ses propres codes, statuts, et fait du commerce. De plus on assiste à la redécouverte du droit romain, manuscrits des compilations de Justinien découvert à Bologne au 12ème siècle. La réflexion de va porter sur les limites qu'il convient de fixer à l'application des différents statuts : Théorie des statuts. > Première école : Ecole des glossateurs. 1228 Glose d'Accurse pose le problème de la citation en justice d'un habitant de Bologne en voyage d'affaire à Modène. Accurse dégage l'idée essentielle que le statut ne lient que les sujets. Par la même est admise une application limitée de la lex fori. Au 14ème siècle la réflexion est poursuivi par les post glossateurs : Bartole et Balde qui ont une méthode empirique casuistique : recherche des principes de solutions en distinguant entre les différents statuts en fonction de leur objet. Il distingue la procédure et le fond. Tout ce qui est procédural dépend de la loi du for. Puis ils dégagent des règles de fond comme la règle locus regit actum. L'acte juridique doit dépendre de la loi du lieu de sa conclusion aussi bien en sa forme qu'en son fond. Autre distinction entre statuts favorables et statuts odieux : origine de la théorie de l'ordre public international. Cette théorie sera reprise en France au 16ème Charles Dumoulin, Bertrand D'Argentré poursuivent le travail d'analyse des post glossateurs. Apport essentiel pour les contrats où sa réflexion fait émerger l'idée d'autonomie de la volonté. Dumoulin a raisonné à propos des régimes matrimoniaux qu'il a assimilé à des contrats. D'argentré est un magistrat breton auteur d'un commentaire de la coutume de Bretagne, sa position politique : défenseur du particularisme politique et juridique de la Bretagne. Doctrine de lutte, dogmatique et où les conflits apparaissent comme étant internationaux. Doctrine territorialiste qui a pour but d'émanciper la Bretagne. Systématiser la grande distinction entre le statut réel et le statut personnel. Réel soumis à la loi territorial, personnel à la loi du domicile mais ce dernier est entendu de manière étroite. Il inclut seulement le droit des personnes le mariage et la filiation. Cependant par soucis de réalisme il admet une catégorie mixte : touchant à la fois le droit des personnes et celui des biens et qu'il rattache également au territoire. La pensé de d'Argentré sera récupéré en Hollande. Hollande car nouvellement indépendante, elle reprend les idées tout en perfectionnant sa théorie. Paul et jean Voe't et Ulrich Huber. L'apport principal tient à l'explication donnée au fondement de l'applicabilité d'une loi étrangère. Ils ont l'idée du recours à la courtoisie internationale (loi équitable et utile au delà de la simple diplomatie) et au respect des droits acquis. On retrouve ses idées dans la doctrine américaine chez Joseph Story (19ème) comity vested rights. (droit de courtoisie). > c) Epoque contemporaine : Marquée par la constitution des états modernes. Ils se donnent des lois, les conflits deviennent habituellement internationaux. Diversité des règles matérielles qui s'étend aux règles de conflits de lois. En France le CC 1804 contient ainsi quelques règles de conflits dans son article 3, or le 3ème alinéa rattache l'état et la capacité des français non plus au domicile mais à la loi nationale. Malgré cela la doctrine de l'époque s'engage dans la recherche de solution universelle mais les résultats décevant engendreront une réaction particulariste. Entre les deux (universalisme et particularisme) une voie a parfois été recherchée. > > 1) les doctrines universalistes : Savigny. Mancini. Savigny 1779-1861 auteur Traité de droit romain, dans lequel un tome est consacré à l'application des lois dans le temps et dans l'espace. C'est une révolution copernicienne des conflits de lois. Le point de départ : il existe une communauté de droit, uploads/S4/ droit-international-prive.pdf
Documents similaires








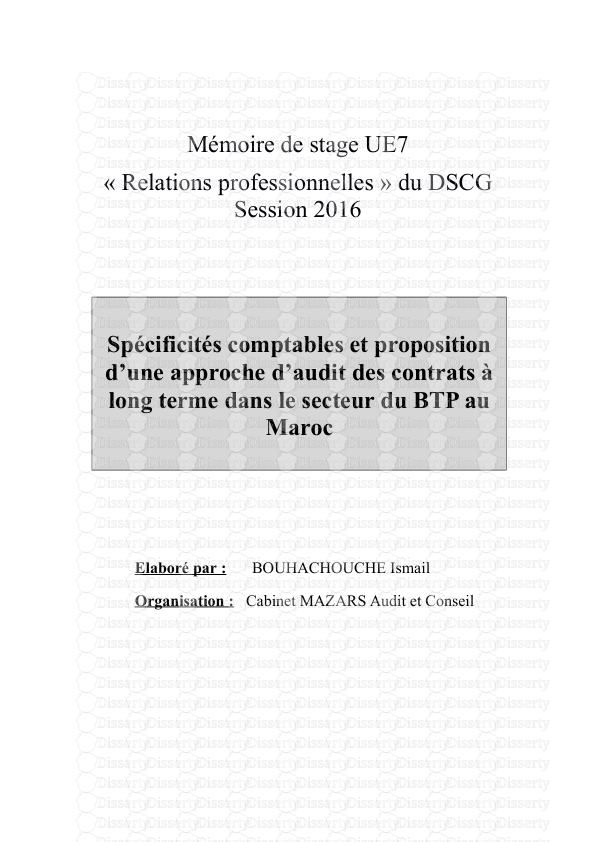

-
49
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 06, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1966MB


