MEMOIRE DE RECHERCHE : EN VUE DE L’OBENTION Du MASTER 2 OPTION DROIT PRIVE FOND
MEMOIRE DE RECHERCHE : EN VUE DE L’OBENTION Du MASTER 2 OPTION DROIT PRIVE FONDAMENTAL PRESENTE PAR BOUAFFON née AMOA T. MARIE-URBAIN T. ANNEE ACADEMIQUE 2013-2014 SOUS LA DIRECTION Du profeSSEUR silue nanga agrege des facultes de droit Et la co-direction du DOCTEUR GUE YEKAN MAÏTRE ASSISTANT ------------ UFR DE Sciences Juridique Administrative et de Gestion ----------- THEME : LA NOTION DE CONTRÔLE DANS LES GROUPES DE SOCIETES EN DROIT OHADA 1 INTRODUCTION L’harmonie entre le fait et le droit est une préoccupation constante du juriste. Le droit est, en effet, confronté à des comportements ou faits qu’il est utile d’enserrer dans des structures juridiques appropriées1. L’une de ces structures juridiques est la société. Communauté d’individus et d’intérêts divers, la société est instituée par une ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise2 commune, des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie à réaliser3. Les sociétés sont de différentes natures. Elles peuvent être civiles ou commerciales. En Côte d’Ivoire et, plus largement, dans l’espace OHADA, les sociétés commerciales relèvent d’une législation particulière, à savoir le droit des sociétés commerciales. Ce droit distingue, selon le critère de la forme, les sociétés de personnes (SNC, SCS) et les sociétés de capitaux (SA, SARL et SAS)4. Cette diversité de formes séduit les acteurs de l’économie capitaliste. Car, la société commerciale, personne morale, est un instrument juridique polyforme, qui favorise le développement des activités économiques. Au-delà de l’attractivité de ces sociétés commerciales, leurs propriétaires ont mesuré l’intérêt d’en détenir le contrôle. Par le contrôle, l’associé dominant est assuré de mener, sa politique et sa stratégie de rentabilité financière sans opposition5. 1PARIENTE M., Les groupes de sociétés aspects juridique, social, comptable et fiscal, LITEC, 1993, 334 p. 2 L’entreprise est une unité économique qui implique la mise en œuvre de moyens humains et matériels de distribution des richesses reposant sur une organisation préétablie. L’entreprise se distingue de la société, cependant plusieurs textes légaux obligent à user de ces deux notions de façon indifférente. 3Art. 1832 du code civil. 4Dans certaines législations il existe des Sociétés en Commandite par Actions. Cette forme de sociétés n’a pas été prise en compte en droit OHADA. 5PARIENTE M, op.cit. 2 Lorsque ce but est atteint, certaines personnes morales et parfois des personnes physiques voient leur désir d’expansion s’accroître. Une société peut en effet, s’allier à d’autres sociétés en vue de diversifier ses activités et/ou améliorer ses bénéfices. Aussi, pour satisfaire leurs désirs d’expansion, ces personnes physiques ou morales tissent des liens avec d’autres sociétés. Ces liens doivent permettre d’influencer voire maîtriser l’ensemble de sociétés, en somme acquérir le contrôle des différentes sociétés. Ces modèles d’organisation des entreprises sont nommés groupes de sociétés. Ce sont des figures incontournables du droit des affaires. Paradoxalement, ils ne bénéficient pas de la personnalité juridique et, corrélativement, ils n’ont pas la qualité de sujet de droit. En réalité, les groupes de sociétés sont plus un phénomène économique que juridique. Malgré cet état de fait, le droit des affaires, dans toutes ses branches, s’y intéresse fortement. Les groupes de sociétés sont nés à la faveur de l’essor industriel américain à la fin du XIX e siècle. Dans l’ordre juridique français, leur développement est beaucoup plus récent. Il faut attendre la fin des années 1960 pour que les pouvoirs publics français organisent, pour la première fois et de manière succincte, une réglementation fiscale du groupe de sociétés. Conscients du poids économique des groupes de sociétés, les pouvoirs publics français multiplient les aides fiscales et financières en faveur des sociétés qui se constituent en groupe. Ces efforts fiscaux ont favorisé le dynamisme du marché financier français. Certains faits d’actualité l’illustrent bien, à savoir : le rachat d'Orange par France Télécom (50 milliards d'euros), l'offre de la banque BNP sur son concurrent Paribas (20 milliards d'euros), la fusion Carrefour-Promodès (16 milliards d'euros) ou encore celle de Vivendi-Universal avec Canal Plus (12 milliards d'euros). Les secteurs de la banque et des télécommunications sont à la pointe de ces regroupements6. Les efforts fiscaux des pouvoirs publics français n’ont pas été les seules avancées sur la question des groupes de sociétés. Le code de commerce français, dans ses dispositions relatives aux groupes de sociétés, a fait l’objet de plusieurs réformes7 dont la plus 6MERLE Ph. (avec la collaboration de FAUCHON A.), Droit commercial, Sociétés commerciales, 8ième éd., 2009, Précis Dalloz. 843 p. 7La loi n°66-537 du 24 juillet 1966 et la loi n°85-11 du 03 janvier 1985. 3 récente date de 20038. Cette réforme a pour objet final la création d’un droit des groupes en droit français et en droit européen9. En France, la création d’un droit des groupes a suscité un débat houleux, aujourd’hui apaisé par le succès de la loi allemande règlementant les groupes de sociétés, le Konzernrecht. Qu’en est-il du droit OHADA ? Au préalable, les pays africains de cet espace n’avaient pas de textes réglementant les groupes de sociétés10. Les premières ébauches de législation sur les groupes de sociétés se dessinent l’avènement de l’OHADA. L’AUSCGIE semble alors influencé par la dynamique législative européenne sur cette question. En effet, trois dispositions, notamment les articles 173 à 175, ont été consacrées aux groupes de sociétés dans l’AUSCGIE publié en 1997. Cette situation n’a pas beaucoup varié avec la réforme de l’AUSCGIE du 30 janvier 2014, en dépit de l’évolution du droit français en la matière (qui aurait pu servir de modèle) et de l’expansion du phénomène des groupes en droit OHADA. Cette expansion s’effectue de plus en plus soit par le regroupement de sociétés nationales11 soit par la création de filiales par les grands groupes occidentaux12. L’attitude du législateur OHADA est donc surprenante. En l’état actuel des règles en vigueur, L’AUSCGIE ne détermine aucun régime juridique des groupes de sociétés. Il se contente, simplement, d’en donner la définition à l’article 173 de l’AUSCGIE en ces termes : « le groupe de sociétés est un ensemble de sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent à l’une d’entre elles de contrôler les autres ». 8Loi n°2003-706 du 1er août 2003. 9Un droit des groupes de sociétés pour l'Europe, Forum européen sur le droit des groupes de sociétés D. Revue des sociétés 1999 p. 43 10KONE M., Le nouveau droit commercial des pays de la zone OHADA, Comparaisons avec le Droit Français, LGDJ, 2003 416 p. 11A titre d’exemples nous pouvons citer TEYLIUM (Direct Access, Compagnie Sahélienne d’Entreprise, Continental Beverage Company, Bridge Bank Group), PROSUMA (SCI Business Center,S2P) SIFCA (PALMCI, MARYLAND OIL PALM, SANIA, SENDISO, SUCRIVOIRE, SAPH), BIAO-NSIA(BIAO- Guinée, NSIA-BIAO Côte d’Ivoire). 12A titre d’exemples : ORANGE, CASINO, BNP, LCL, BOLLORE. 4 Au-delà de cette législation partielle, ce texte a pour avantage de dégager le contrôle comme critère d’existence des groupes de sociétés. De façon générale, le contrôle est une situation inhérente aux rapports sociaux. Il s’impose comme un outil d’organisation dans les Etats, les sociétés ou les groupes d’individus. Comme tel, il revêt deux aspects essentiels : surveillance et domination, le contrôle est donc une notion polysémique. Le contrôle se définit, d’une part, comme la surveillance de la régularité des actes, il consiste dans ce cas à la vérification de la conformité à une décision, d’une situation ou d’un comportement. C’est l’opération par laquelle l’on vérifie qu’un organe de la société respecte les exigences de ses fonctions et les règles qui lui sont imposées13. D’autre part, le contrôle se définit comme l’exercice du pouvoir. Le détenteur du pouvoir prend des décisions en dernier ressort et impulse la conduite générale de l’ensemble14. Le droit public et le droit privé appréhendent le contrôle dans ces deux acceptions. En droit public, le contrôle surveillance porte sur la régularité des actes administratifs, il s’opère grâce au contrôle de légalité et de constitutionnalité. Quant au contrôle domination, il appartient au Chef d’Etat. Ce pouvoir qu’il reçoit du peuple lui permet d’orienter et de diriger les affaires de l’Etat selon ses prévisions et dans l’intérêt de la nation. En droit privé, particulièrement en droit des sociétés, les règles du contrôle n’échappent pas à cette dualité. Le contrôle surveillance fait référence au pouvoir de vérification des commissaires aux comptes dans la société, ou des associés sur la gestion de leurs mandataires.15 Cette forme de contrôle a été méticuleusement élaborée en raison des abus possibles dans l’exercice du contrôle domination. Mais le contrôle surveillance ne fera pas l’objet d’un débat approfondi dans cette étude. 13CORNU G, Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant PUF, 2007. 14 Idem. 15BLIN-FRANCHOMME M-P, Essai sur la notion de contrôle en droit des affaires, Thèse, Toulouse I, 1998. 5 Le contrôle domination désigne le pouvoir quasi-absolu de diriger les affaires sociales. Suite à la définition des groupes de sociétés énoncée à l’article 173 de l’AUSCGIE, l’article 174 définit le contrôle en ces termes: « le contrôle d’une société est la détention effective du pouvoir de décision au sein de cette société ». Dans le dessein de comprendre le lien entre le concept de contrôle et la réalité des groupes de sociétés uploads/S4/ le-controle-dans-les-groupes-de-societes.pdf
Documents similaires








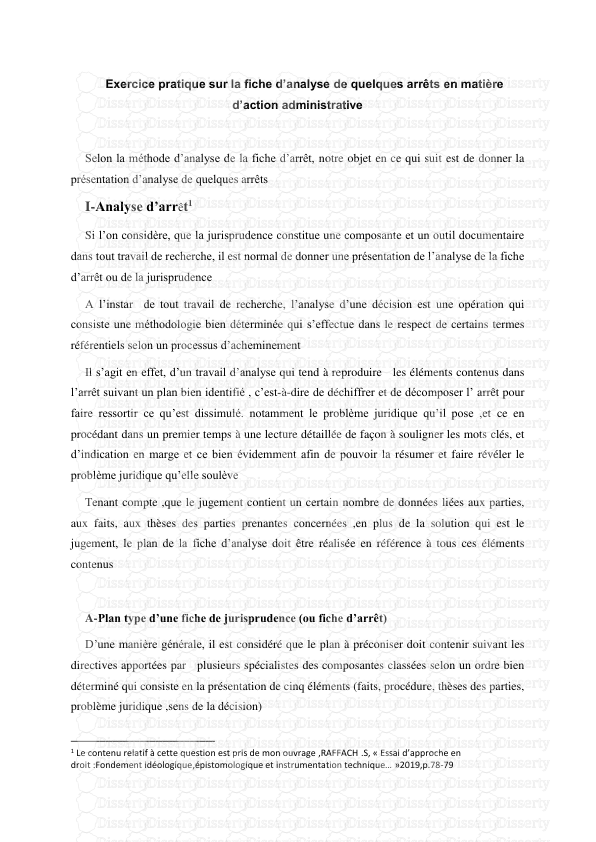

-
31
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 18, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 1.3847MB


