hChapitre 1 Le droit et la loi Ce que vous allez apprendre • La loi n’est pas l
hChapitre 1 Le droit et la loi Ce que vous allez apprendre • La loi n’est pas le droit • La loi n’est pas la morale • La loi n’est pas la justice • La loi n’est que le texte voté par le Parlement 22 Chapitre 1 Le texte qui suit est inspiré d’une allocution que nous avons faite le 31 mai 2008 devant la Compagnie des Experts Traducteurs Interprétes près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (CETIJ) La loi : nous connaissons tous ce terme, qui nous est enseigné depuis notre plus jeune âge, comme ferment de toute vie sociale, objet de respect et parfois de crainte révérencieuse. Pourtant, nous ne savons pas encore qu’elle est « l’expression de la volonté générale » (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, art.6) ni comment elle se forme. Nous ignorons davantage sa place dans l’ordonnancement juridique et dans la hiérarchie des normes (voir infra) et encore moins son contenu. Qui peut, à l’heure actuelle, prétendre connaître dans le détail les onze mille lois en vigueur à ce jour ou ne serait-ce que le contenu des deux cent soixante-quatre textes de lois adoptés lors d’une récente législature, entre 2007 et 2012 ? (Assemblée Nationale, Bilan de la XIIIe législature, 6 mars 2012) à tel point que certains auteurs et non des moindres parlent de « diar- rhée normative » (Antoine Leca, La genèse du droit, PUAM, 2002). Et encore, excluons-nous délibérément du décompte les dizaines de milliers de décrets, arrêtés, circulaires qui complètent l’ordonnancement juridique national ou les près de soixante-dix codes qui devraient nous en rendre l’accès plus facile. Mais c’est oublier que toutes les lois ne sont pas codifiées, telle la loi sur la Presse de 1881, et que le nombre des codes – et parfois même leur épaisseur comme le Code civil ou le Code général des impôts – a de quoi décourager. astuce Nous invoquons la loi que, du reste, tout un chacun est censé connaître selon le bon vieil adage « nemo censetur ignorare legem » (nul n’est censé ignorer la loi) car la loi est la règle suprême, celle qui s’impose à nous, au plus faible comme au plus fort. Pourtant, le citoyen français le plus vertueux peut-il prétendre nous détailler le « code du domaine de l’État et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte » ou nous résumer brièvement le « code du cinéma et de l’image animée » sans parler du « code général des impôts », épais comme un annuaire téléphonique, qui le concerne pourtant plus de près que de loin ? C’est la loi ! Tout au moins est-ce ainsi que nous nous adressons au voisin fêtard, au client récalcitrant ou au fonctionnaire obstiné dans son refus de nous accor- der ce que nous estimons nous être du. Et c’est ce que nous nous entendons répondre du même voisin, sûr de son bon droit, du même client arc-bouté sur son code civil ou de l’agent impassible qui nous fait valoir l’éternelle pièce manquante au dossier. C’est la loi ! sans que pour autant ni les uns ni les autres Le droit et la loi 23 (ni nous-mêmes) ne soient absolument sûrs du texte auquel ils font référence ni si celui-ci, à l’appui de leurs prétentions, constitue bien une loi. C’est la loi ! Et voilà en trois mots défini le socle sur lequel repose toute notre orga- nisation sociale, politique, administrative ; en ces quelques lettres est désigné ce dont on se réclame et que l’on redoute tout à la fois ; ce que l’on invoque à son avantage mais que l’on craindrait si, d’aventure, il nous était opposé. C’est en cela, paradoxalement, en cette référence mêlée de crainte que se trouve la définition idéale que nous pourrions donner de la loi. Ce n’est pas si simple. La loi est-elle le droit ? La loi est-elle la morale ? La loi est-elle la Justice ? Ni l’une ni les autres. Le droit, la morale et la Justice sont des concepts qui sous-tendent la perfection, des idéaux que l’on cherche à atteindre ; ils sont porteurs de principes gravés dans le marbre. La loi n’est rien de tout cela. Elle est impar- faite, ce qui explique que l’on en change régulière- ment, pour ne pas dire constamment en certains domaines. Faite pour des hommes davantage que pour les hommes et par des hommes plus que par les hommes, elle est avant tout conjoncturelle. Passent les hommes, c’est bien souvent les lois qu’il faudra changer, et pour cela on évoquera l’évolution de la société et des mœurs. Le droit qui est divin, la morale qui est exem- plaire, la justice qui est sacrée face à la loi qui est humaine, changeante, imparfaite, souvent injuste, quelquefois partiale. Le combat est inégal et la comparaison inéquitable, parce que la loi est par nature contestable et réformable et parce que là est le rôle de tout citoyen que de rester vigilant en la comparant sans cesse à ces trois axiomes qui sont les trois grands piliers sur lesquels repose toute la destinée humaine : le droit, la morale et la justice. p Éclairage On n’insistera jamais assez sur l’apport de Victor Hugo et, de façon plus générale, des écrivains et gens de lettres en matière juridique, principalement lorsqu’ils ont quelque chose à dire, qu’ils ont le talent pour l’écrire et la célébrité pour le faire savoir. Nous évoquerons plus loin, notamment dans Les plaideurs, l’apport de certains d’entre eux à l’évolution du droit. Si Émile Zola ou George Sand se sont illustrés dans la défense de causes célèbres, Victor Hugo ne peut-il être considéré comme un des pères de l’abolition de la peine de mort et, si nous y réfléchissons bien, aussi, de la reconnaissance par le juge puis par le législateur de l’État de nécessité ? 24 Chapitre 1 I. « PRO JURE CONTRA LEGEM » : LA LOI N’EST PAS LE DROIT La loi n’est pas le droit quel que soit le sens que l’on accorde au concept de « droit ». La loi n’est pas le droit envisagé au sens « d’idéal » Le droit en tant qu’idéal a été fort bien mis en lumière par Victor Hugo dans son opposition à la loi : « Le droit et la loi, telles sont les deux forces ; de leur accord naît l’ordre et de leur antagonisme naissent les catastrophes. Le droit parle et commande du sommet des vérités ; la loi réplique du fond des réalités ; le droit se meut dans le juste, la loi se meut dans le possible ; le droit est divin, la loi est terrestre. Ainsi, la liberté, c’est le droit ; la société, c’est la loi. De là la tribune : l’une où sont les hommes de l’idée, l’autre où sont les hommes du fait. L’une qui est l’absolu, l’autre qui est le relatif. De ces deux tribunes, la première est nécessaire, la seconde est utile. De l’une à l’autre il y a la fluctuation des consciences. L’harmonie n’est pas faite encore entre ces deux puissances, l’une immuable, l’autre variable, l’une sereine, l’autre passionnée. La loi découle du droit mais comme le fleuve découle de la source, acceptant toutes les torsions et toutes les impuretés des rives. Souvent, la pratique contredit la règle, souvent le corollaire trahit le principe ; souvent l’effet désobéit à la cause ; telle est la fatale condition humaine. Le droit et la loi contestent sans cesse ; et de leur débat, fréquemment orageux, sortent, tantôt les ténèbres, tantôt la lumière. Dans le langage parlementaire moderne on pourrait dire : le droit, chambre haute ; la loi, chambre basse. L’inviolabilité de la vie humaine, la liberté, la paix ; rien d’indissoluble, rien d’irrévocable, rien d’irréparable ; tel est le droit. L’échafaud, le glaive et le sceptre, la guerre, toutes les variétés de joug, depuis le mariage sans le divorce dans la famille jusqu’à l’état de siège dans la cité, telle est la loi. Le droit : aller et venir, acheter, vendre, échanger. La loi : douane, octroi, frontière. Le droit : L’instruction gratuite et obligatoire, sans empiétement sur la conscience de l’homme, embryonnaire dans l’enfant, c’est-à-dire l’instruction laïque. La loi : les ignorantins ; Le droit : la croyance libre ; La loi : les religions d’État ; Le suffrage universel, le jury universel, c’est le droit ; le suffrage restreint, le jury trié, c’est la loi. La chose jugée c’est la loi ; la justice c’est le droit. Le droit et la loi 25 Mesurez l’intervalle. » (Cf. Victor Hugo, Paris, juin 1875 in Politique, Robert Laffont, Coll. « Bouquins », 1985, p. 67) C’est pour cela que Victor Hugo, à qui l’on droit ces quelques lignes, avait fait sienne la maxime « pro jure contra legem » (pour le droit, contre la loi). Le droit pénètre les consciences, demeure en elles, devient cette plume par laquelle on écrit les lois mais aussi cette arme qui uploads/S4/ le-droit-et-la-loi.pdf
Documents similaires


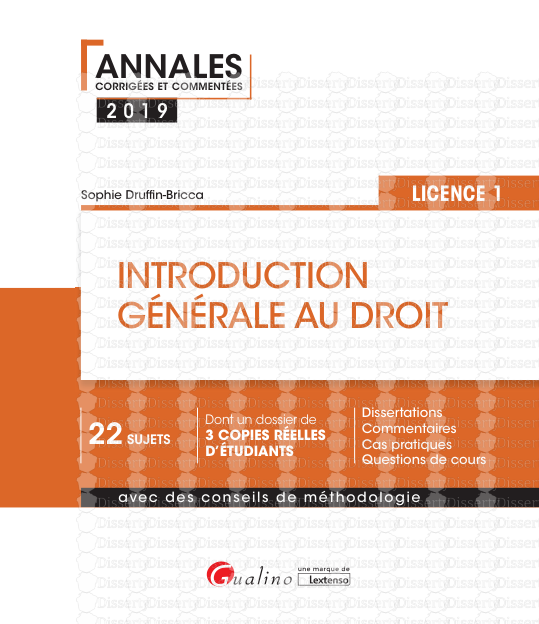







-
76
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 20, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1012MB


