Ozanam, Frédéric (1813-1853). Oeuvres complètes de A.-F. Ozanam. 1861. 1/ Les c
Ozanam, Frédéric (1813-1853). Oeuvres complètes de A.-F. Ozanam. 1861. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. OEUVRES COMPLÈTES DE A. F. OZANAM AVEC UNE PRÉFACE PAR M. AMPÈRE del'Académie française SECONDE ÉDITION TOMETROISIÈME ÉTUDES GERMANIQUES LES GERMAINS AVANT LE CHRISTIANISME PARIS. —IMP. SIMON RAÇON ET COMP-, RUE D'ERFURTIF,, 1. LES GERMAINS AVANT LE CHRISTIANISME RECHERCHES SUR LESORIGINES, LESTRADITIONS, LESINSTITUTIONS DESPEUPLES GERMANIQUES, ET SUR LEUR ÉTABLISSEMENT DANS L'EMPIRE ROMAIN, PAR A. F. OZANAM PROFESSEUR DE LITTERATURE ETRANGERE ALAFACULTÉ DES LETTRES DE PARIS TROISIEME EDITION PARIS JACQUES LECOFFRE ET Cie, ÉDITEURS RUE DUVIEUX - C 0L0M BIER, 29 1861 Ledroit de traduction estréservé. PRÉFACE Toute la société française repose sur trois fonde- ments : le christianisme, la civilisation romaine, et l'établissement des barbares. Ce sont les trois sujets d'étude auxquels il ne faut pas se lasser de revenir dès qu'on veut s'expliquer le droit public du pays, ses moeurs, sa littérature. Mais il n'est pas facile d'ignorer le christianisme ; il remplit le présent comme le passé, et force les plus indifférents à s'oc- cuper de lui. L'antiquité romaine a laissé des monu- ments qui se défendent de l'oubli par leur grandeur et leur beauté. Les barbares, au contraire, n'ont que des chroniques arides et des codes incomplets ; et ce peu qu'ils nous apprennent ne commence qu'après l'invasion, c'est-à-dire quand ils sortent de la bar- barie. C'est aussi l'époque où s'arrêtent la plupart de ceux qui ont porté la lumière dans les premiers siècles de notre histoire ; et, avec une louable réserve, E. G. I. 2 PREFACE. ils se sont contentés d'étudier les institutions des Francs, des Goths, des Burgondes, depuis l'entrée de ces peuples dans la société chrétienne. A cet égard, il ne reste rien à faire après les leçons de M. Guizot, après les travaux de M. Thierry, de M. Guérard, de M. Naudet, de M. Pardessus, de M. Laboulaye et de plusieurs autres que je ne puis nommer, mais qu'assurément personne n'oublie. Toutefois, depuis trente ans, les recherches qu'on ne devait point commencer en France, dans un pays tout romain par ses souvenirs, ont tenté la curiosité des Allemands, ces héritiers directs des Germains. Ils ont entrepris de s'enfoncer au delà du siècle des invasions, de pénétrer dans les traditions germani- ques avant le temps où elles s'altèrent par le désordre de la conquête et par le commerce de l'étranger, de rétablir l'histoire des peuples du Nord à une époque qui n'eut pas d'historiens, et de les suivre assez loin pour savoir enfin d'où ils vinrent et par quels liens ils tiennent au reste de la race humaine. Des études si graves, et qui semblent vouloir tant de calme, na- quirent cependant de l'agitation publique et de la guerre. Ce fut en 1812, dans cette sanglante année, que deux jeunes gens, les frères Grimm, découvri- rent, dans un manuscrit de la bibliothèque de Cassel, le poëme de Hildebrand et Hadebrand. L'Allemagne applaudit à la publication de ce chant, où éclatait le génie libre et guerrier de la barbarie. Le succès dé- cida deux des plus belles vocations littéraires de PREFACE. 5 notre temps; et les frères Grimm ouvrirent ces fouilles qui devaient produire la Grammaire alle- mande, la Mythologie allemande, les Antiquités du droit allemand, l'essai sur la Tradition héroïque, et mettre à nu tout le fond des antiquités du Nord (1). Des travaux si heureusement conduits ne pou- vaient rester isolés : toute l'Allemagne savante y vou- lut mettre la main. Bopp rattacha les idiomes ger- maniques à la famille des langues indo-européennes, dont il écrivait la grammaire comparée. Gans, Phil- lips, Klenze, poussaient l'analyse jusqu'aux derniers fondements du droit allemand, et y montraient les mêmes principes qui soutiennent toute la législation de Rome, de la Grèce et de l'Inde. En Danemark et en Suède, Rask et Geijer tiraient des poëmes Scan- dinaves une lumière qui rejaillissait sur tous les peuples du Nord. En Angleterre, Thorpe et Kemble reconnaissaient, dans les premiers chants des poëtes anglo-saxons, l'écho des traditions allemandes. De toutes parts, de jeunes savants s'étaient mis à creuser le sol de la patrie germanique; et, comme ce paysan que Virgile représente labourant un champ de ba- taille, ils admiraient les débris glorieux qu'ils retrou- vaient dans chaque sillon, et les tombes des géants dont ils étaient les fils : Grandiaque effossismirabitur ossa scpulcris. (1) M. Jacob Grimm vient de couronner ses travaux en publiant l'His- toire de la langue allemande. 4 PRÉFACE. Mais l'admiration a ses dangers: à la suite des maîtres une école s'est formée, qui a fini par ne rien voir que de gigantesque et de plus qu'humain dans les moeurs, de l'ancienne Germanie. On a vanté la pureté de la race allemande, quand, vierge comme ses forêts, elle ne connaissait pas les vices de l'Eu- rope civilisée. On n'a plus tari sur la supériorité de son génie, sur la haute moralité de ses lois, sur la profondeur philosophique de ses religions, qui pou- vaient la conduire aux plus hautes destinées, si le christianisme et la civilisation latine n'avaient dé- truit ces espérances. Ces rêves ne sont point ceux d'un petit nombre d'antiquaires fourvoyés : les esprits les plus élevés ne s'en défendent pas toujours. On sait avec quelle autorité les critiques prussiens, décidés à nous refuser l'inspiration poétique, ont fait justice de Racine et de la Fontaine. Il n'y a pas long- temps que Lassen, cet orientaliste consommé, oppo- sait, dans un éloquent parallèle, le paganisme libéral des Germains au dieu égoïste des Hébreux ; et Gervi- nus, l'historien de la poésie allemande, ne peut se consoler de voir que la mansuétude catholique lui a gâté ses belliqueux ancêtres (1). Les découvertes historiques de l'Allemagne pou- vaient donc se trouver compromises, aux yeux de l'étranger, par l'usage qu'on en faisait. D'ailleurs, les ouvrages de M. Grimm, excepté la Grammaire, où (1) Lassen, Indische Alterthumskunde, p. 415; Gervinus,Geschichte der poetischenNational-Littertur, p. 312. PRÉFACE. 5 il y a beaucoup d'art et de génie, étaient surtout des collections de documents bien choisis, qui atten- daient leur emploi. Les Allemands nous laissent vo- lontiers ce travail de rédaction, trop frivole pour eux. En 1831, M. Fauriel inaugurait la chaire de littérature étrangère par ces belles leçons, où il éclairait d'un jour si nouveau les commencements de la littérature provençale. C'est là qu'il rencon- trait le poëme barbare de Walther d'Aquitaine, et l'étude de cet épisode étrange le conduisait à exposer toute la suite de l'épopée germanique. En 1852, M. Ampère ouvrit la brillante carrière de son ensei- gnement, en menant ses auditeurs aux sources en- core peu connues de la poésie Scandinave. On se rappelle avec quel applaudissement il introduisit le premier, dans la chaire classique, les chants de l'Edda, les récits des Sagas, et tant de textes curieux dont la barbarie éloquente étonnait nos oreilles. D'un autre côté, M. Saint-Marc Girardin, après avoir analysé les institutions de l'ancienne Allemagne, la montrait pour ainsi dire toute vivante dans la fable héroïque des uploads/S4/ les-germains 1 .pdf
Documents similaires






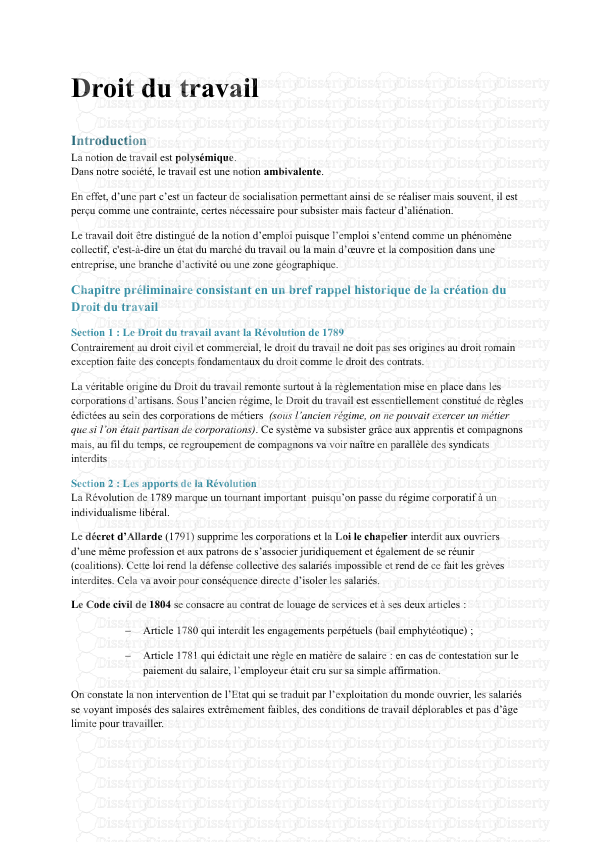



-
75
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 10, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 14.9838MB


