Relations collectives de travail N° 1 Introduction L’existence est d’abord un f
Relations collectives de travail N° 1 Introduction L’existence est d’abord un fait avant de devenir du droit. Dans la fabrique, dans l’usine, au côté de l’employeur s’exerce sur une masse et, corrélativement, une masse d’hommes s’oppose parfois à l’employeur. C’est une relation collective d’un seul côté : d’un côté une collectivité d’hommes celle des salariés qui entre en relation avec l’autre côté, avec le pouvoir, pouvoir de celui qui peut décider d’embaucher, de licencier, qui dirige et qui organise le travail. Cette relation collective d’un seul côté est sans doute la forme la plus spontanée de relations collectives de travail avec, entre autres comme manifestation, la grève. Autre phénomène qui se rattache aux relations collectives de travail, c’est le sentiment corporatif. Ce sentiment corporatif ne nécessite pas le travail en commun. En revanche, il requiert de ceux qu’il partage une conscience commune de leurs places dans la société. C’est le sentiment corporatif qui animait les corporations de l’Ancien Régime. C’était des personnes morales de droit public, auxquelles répondaient les compagnonnages ouvriers, qui sont d’une certaine façon les ancêtres des syndicats. Le sentiment corporatif anime les avocats, les médecins ainsi que de nombreux artisans. C’es professionnels travaillent en général isolément mais ils éprouvent le sentiment d’appartenance à un groupe, à une corporation et ils vont tenter de défendre ce groupe contre d’éventuelles menaces. La corporation recherche naturellement le monopôle. Les médecins ont obtenu la répression du délit d’exercice illégal de la médecine qui a fait disparaître progressivement les soins empiriques et les autres corporations, touts libérale qu’elles soient en théorie agissent de même. Il a fallu par exemple une directive européenne pour permettre aux italiens de diriger un salon de coiffure en France puisque les textes de droit interne l’interdisait. La corporation est un groupe et ce groupe peut conclure des accords avec d’autres groupes. On a alors une relation qui est collective des deux côtés . lorsqu’un syndicat de salariés signent une convention collective avec un syndicat d’employeurs, la relation est collective non seulement du côté des salariés comme dans la grève d’entreprise mais aussi du côté patronal. Il y a une tradition du syndicalisme qui emprunte au phénomène corporatiste. C’est ce que l’on appelle le syndicalisme de métier. Le syndicalisme de métier, par exemple les ouvriers qualifiés du bâtiment , les charpentiers, les couvreurs peuvent avoir le sentiment d’appartenir à une élite. Le sentiment corporatif d’un groupe d’ouvriers qualifiés conduit tout naturellement à la convention collective par laquelle ce groupe définit ses relations ave »c le groupe des employeurs. Il n’y a là pas seulement une espèce de révolte spontanée qui peut naître de la subordination partagée mais aussi l’affirmation réfléchie de l’identité collective d’un groupe. Le troisième phénomène, c’est loa conscience de classes. La classe sociale désigne un groupe plus vaste que celui des salariés de telle ou telle usine ou celui de telle profession. La notion de classe constitue évidemment une abstraction, elle évoque un ensemble d’hommes qui partage une destinée historique commune. Le concept de classe tel que nous l’utilisons a été pour l’essentiel élaboré à partir du bilan de la Révolution Française, qui a été présenté par les auterus du 19ème siècle. Suivent ces auteurs, de 1789 à 1793, la classe bourgoise détruit l’Ancien Régime, le pouvoir royal et la prédominance de l’aristocratie. La classe bourgeoise, c’est une classe inférieure avant 1789 puisque même s’ils étaient riches, les bourgeois se voyaient fermer les fonctions les plus élevées de l’armée de la marine et de l’Etat. La bourgeoisie fournit les dirigeants radicaux de la Révolution française, Robespierre Marat, comme elle avait fourni Cromwel en Angleterre, comme elle avait fourni également les dirigeants des révolutions protestantes de Suisse et de Hollande. Et de ce constat , les révolutions du 18ème et 19ème siècle ont opposé la bourgeoisie à l’aristocratie. On passe à une abstraction, la mission historique de la bourgeoisie était de détruire la féodalité. Et à partir de cette abstraction, c’est d’abord au 19ème siècle, une autre abstraction.. il existe au 189ème siècle une classe ouvrière dont la mission historique est de détruire le capitalisme tout comme la mission historique de la bourgeoisie était de détruire la féodalité. C’est cette abstraction qui inspire les dispositions de la Charte d’Amiens. La chartes d’Amiens a été adoptée au moment de la fondation de la CGT et d’après cette charte, le but final du syndicalisme est l’abolition du patronat et du salariat. C’est une conception escatologique de l’histoire, il y a une fin. Les syndicats anglais sont dans une certaine mesure restés au stade du corporatisme, tout comme les syndicats américains où les rapports de travail se nouent au niveau de l’entreprise. En France, la conscience de classe a joué un rôle très important dans l’histoire du mouvement syndical. La conscience de classe peut conduire à la prétention de défendre l’intérêt général puisque la classe a une mission historique, à moins que comme en Angleterre, elle ne soit une sorte de caste qui défend uniquement ses intérêts égoïstes, immédiats. La conscience de classe peut faire passer des intérêts à long terme avant les intérêts immédiats. Ainsi, le syndicat recherchera, ce qui est souvent le cas en France, une adhésion idéologique. Il ne se satisfera pas d’une adhésion consumériste. En somme, la conscience de classe peut conduire à ce que le syndicat se comporte comme une élite. Paradoxalement, c’est peut être l’un des facteurs du caractère très minoritaire des syndicats en France. Les différences entre les pays sont considérables même si nous verrons ensuite qu’il y a des points communs et de forts éléments de convergence. Par exemple, l’Allemagne qui a autrefois connu une tradition de syndicat influencé par le marxisme a maintenant des syndicats réformistes, en parole beaucoup plus sage que la CGT française. Et il est vraisemblable que les syndicats allemands ne pensent pas lutter pour l’abolition du salariat et du patronat. Malgré ces différences, il y a de très fortes convergences. Da,ns tous les pays de l’Occident développé et de plus en plus de l’Asie développée, le droit des relations collectives de travail a progressé suivent les trois axes suivants. Premier Axe, la reconnaissance juridique de l’existence d’un intérêts collectifs des salariés. Cette reconnaissance passe d’abord par la reconnaissance du droit syndical dans tous les pays. D’autant plus que maintenant des conventions internationales y contraignent. La reconnaissance de l’intérêt collectif des salariés conduit aussi, surtout en Europe continentale à la mise en place d’une représentation élue du personnel dans les entreprises. En France, en Italie, en Espagne, c’est le comité d’entreprise ; en Allemagne c’est le conseil d’établissement. Syndicats et élus des salariés représentent l’intérêt collectif des salariés suivants des modalités techniques qui sont évidemment très variables d’un pays à l’autres. Mais l’idée majeure est toujours la même : on va compenser la faiblesse individuelles du salarié en plaçant les discussions sur un plan collectif, en abandonnant la fiction de l’égalité des volontés privées. Une fois que l’intérêt collectif des salariés a été reconnu, c’est la reconnaissance du droit de grève comme moyen de promouvoir cet intérêt et dans tous les pays on trouve la même évolution. Au début, les syndicats sont interdits et puis on a un processus de légalisation progressive. Et, en France, à partir de l’interdiction initiale, interdiction posée par la loi Le Chapelier (Loi des 14 et 17 Juin 1791), le droit de grève a évolué mais on retrouve la même évolution ailleurs suivant deux étapes : 1864, c’est l’abrogation du délit de coalition , le droit de grève cesse d’être un délit pénal qu ‘elle était depuis 1791 et 1946 c’est la prescription du droit de grève dans le préambule de la Constitution. La grève va alors cesser d’être une faute civile. Mêmes étapes dans de nombreux pays même si la reconnaissance du droit de grève n’est pas toujours aussi net qu’en France. Par exemple, aux Etats-Unis, c’est une loi fédérale, ce n’est pas la Constitution qui reconnaît le droit de grève. L’opinion commune, en toutes hypothèses, sait que le droit de grève constitue dorénavant un élément essentiel de l’Etat de droit et une facette irremplaçable de la démocratie. Un auteur responsable de la CGT a qualifié la grève de droit naturel, c’est une formule curieuse parce que les théories du droit naturel se conjuguent à priori assez mal avec l’influence du marxisme mais elle est significative, on est passé de l’interdiction à la protection avec la consécration d’une exception évidente au principe de la force obligatoire du contrat, le droit de grève c’est le droit dans certain cas de ne pas exécuter des contrats pourtant déjà conclu, le droit de grève a connu un complet reversement de perspectives depuis le 19ème siècle. Troisième axe, la reconnaissance de l’autonomie collective. La notion d’autonomie collective est évidemment plus complexe que celle d’intérêt collectif du salarié ou encore a fortiori de grève. Elle est transposée de l’idée d’autonomie de la volonté dans le contrat. De même qu’on parle d’autonomie de la volonté pour le contrat individuel, un parle d’autonomie collective pour évoquer la possibilité uploads/S4/ relations-collectives-du-travail 1 .pdf
Documents similaires




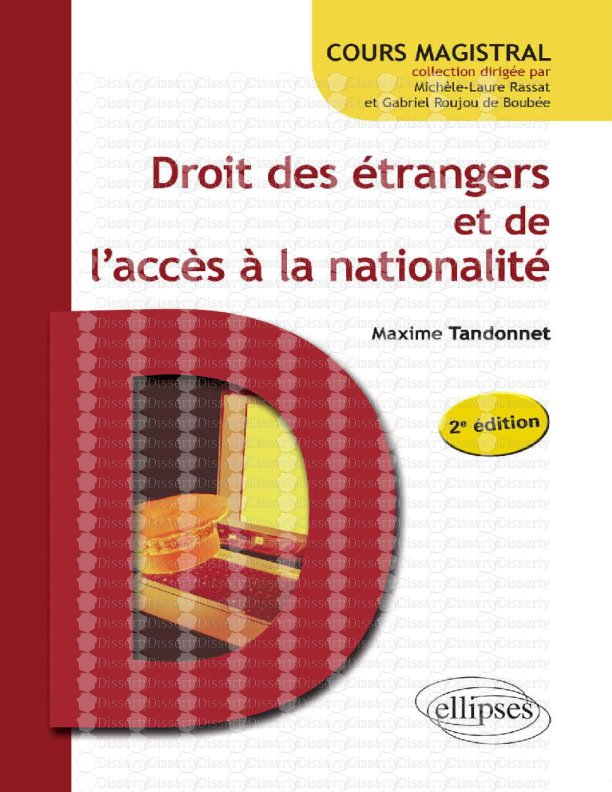





-
53
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 23, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.6387MB


