0 La C.I.J., l’avis consultatif et la fonction judiciaire: entre décision et co
0 La C.I.J., l’avis consultatif et la fonction judiciaire: entre décision et consultation Pierre-Olivier Savoie∗ ∗ B.C.L./L.L.B. Hons. (McGill), 2005. Stagiaire judiciaire à la C.I.J., 2005-2006. L’auteur tient à remercier les professeurs René Provost, qui a supervisé la rédaction de ce travail dirigé, et Armand de Mestral pour leurs précieux commentaires. L’auteur tient également à remercier ses collègues Simon Chamberland, Aileen Doetsch, Alexandra Popovici et Jean-Frédérick Ménard d’avoir accepté de lire une version préliminaire. L’idée de ce texte ayant pris naissance durant la préparation pour le Concours de droit international Charles-Rousseau 2004, l’auteur tient à remercier Prof. Jaye Ellis, Karina Kessaris, Me Sylvain Gagnon, Karine Péloffy et Rébecca St-Pierre pour leur support indéfectible et la contribution de toute l’équipe à tous ces stimulants débats sur les avis consultatifs. 1 La C.I.J., l’avis consultatif et la fonction judiciaire : entre décision et consultation Introduction I- La fonction judiciaire de la C.I.J. relative aux demandes d’avis A. L’évolution de la fonction judiciaire dans le temps B. L’évolution des avis consultatifs dans le temps C. Les avantages et inconvénients de la procédure consultative 1. Les avantages 2. Les inconvénients 3. L’assimilation des procédures consultatives et contentieuses II- La nécessité et l’utilité de la fonction consultative de la C.I.J. A. Leur nécessité 1. Du droit d’ester devant la Cour 2. Le problème du consentement nécessaire des États B. Leur utilité 1. Le développement du droit des Organisations et le contrôle de la légalité des actes des organisations 2. Le développement du droit international 3. Les limites des avis consultatifs III- L’avis : un hybride entre décision judiciaire et consultation 2 Introduction Avant même que ne soit rendu le dernier avis consultatif de la C.I.J. sur la licéité d’un mur construit par Israël autour des territoires palestiniens1, le gouvernement d’Israël avait clairement indiqué qu’il ne s’y conformerait pas, position qu’il n’a pas changée le jour du jugement.2 Est-ce là une raison de déplorer que l’avis ait été rendu? L’absence de consentement d’Israël ou d’autres raisons liées à la compétence, la recevabilité ou, généralement, à l’intégrité judiciaire de la Cour auraient-elles dû mener celle-ci à décliner de rendre l’avis? Ces questions sur l’autorité et la légitimité des avis consultatifs sont avec nous depuis maintenant deux siècles.3 En droit interne comme en droit international, l’irritant de l’avis consultatif est le fruit de la montée de l’État démocratique et de la séparation des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire – qui ne devrait se prononcer que sur des différends nés et réels. En droit international, l’avis consultatif irrite aussi parce qu’il porterait atteinte à la souveraineté de l’État qui n’y a pas consenti et dont les droits pourraient être affectés par celui-ci dans le futur.4 L’avis sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur semble constituer une excellente occasion pour réexaminer l’apport des avis consultatifs de la C.I.J. Cependant, il existe déjà une littérature abondante sur l’utilité des avis consultatifs à l’intérieur du système des Nations Unies et du droit international. C’est pourquoi notre approche vise à mesurer 1 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, [2004] C.I.J. Rec. [Conséquences juridiques de l’édification d’un mur]. 2 « Sharon orders Israeli barrier construction continued », CNN, 11 juillet 2004, en ligne: http://www.cnn.com/2004/WORLD/meast/07/11/israel.barrier/. 3 C’est aux États-Unis, en 1793, que s’est posé pour la première fois la question de la compatibilité des avis consultatifs avec la fonction judiciaire. Voir généralement Stewart Jay, Most humble servants : the advisory role of early judges, New Have, Conn., Yale University Press, 1997. 4 Voir Statut de la Carélie orientale, avis consultatif, C.P.J.I. série B (no. 5) à la p. 27 [Affaire de la Carélie] : aucun État n’est tenu « de soumettre ses différents avec les autres États, soit à la médiation, soit à l’arbitrage, soit enfin à n’importe quel procédé de solution pacifique sans son consentement. » 3 l’utilité des avis consultatifs au regard d’une théorie construite en examinant plusieurs systèmes juridiques. À notre connaissance, la dernière étude comparatiste exhaustive au regard des avis consultatifs est celle de Manley O. Hudson dans son cours à l’Académie du droit international.5 Il y a quatre-vingts ans, l’évaluation que faisait Manley Hudson des premières années de la procédure consultative devant la C.P.J.I. était plutôt positive.6 Cet enthousiasme découlait entre autres du fait que la C.P.J.I. venait de rendre huit avis en deux ans et qu’elle avait par le fait même contribué à rétablir la paix et la sécurité. Un des avis avait même été accepté comme obligatoire par les deux parties au conflit, ce qui avait contribué à sa résolution.7 Essayant aussi de convaincre un lectorat américain plutôt froid à l’action judiciaire en l’absence de « controverse », Manley Hudson voyait les avis consultatifs comme donnant la chance aux tribunaux de prévenir et non seulement de guérir les problèmes juridiques de la société.8 En un sens, Manley Hudson fit figure avant son temps de défenseur des modes alternatifs de résolution des conflits. 5 Manley O. Hudson « Les avis consultatifs de la Cour Permanente de Justice Internationale » (1925) 8 R.C.A.D.I. 341. [Hudson, « Les avis consultatifs »]. Voir aussi, Manley O. Hudson, « Advisory Opinions of National and International Courts » (1924) 37 Harv. L. Rev. 970. [Hudson, « Advisory Opinions »]; Kenneth James Keith, The Extent of the Advisory Jurisdiction of the International Court of Justice, Leyden, A.W. Sijthoff, 1971 aux pp. 16-18; Dharma Pratap, The Advisory jurisdiction of the International Court, Oxford, Clarendon Press, 1972 aux pp. 263-267. 6 Hudson, « Advisory Opinions », supra note 5. 7 Requête pour avis consultatif sur les décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc (zone française) le 8 novembre 1921, avis consultatif, C.P.J.I. série B (no. 4) qui opposait la France et la Grande-Bretagne, à savoir si le conflit entre les deux États relevait, aux yeux du droit international, d’une question considérée comme relevant purement d’une question interne, selon les allégations françaises. Après une procédure à peu près similaire à un litige contentieux, la France a accepté le jugement qui réfutait ses thèses et a conclu un accord avec la Grande-Bretagne pour aller un arbitrage. Les deux États ont conclu un accord avant que les procédures arbitrales ne soient engagées. Voir aussi Hudson, « Advisory Opinions », supra note 5 aux pp. 994-995. 8 Hudson, ibid. 4 Un certain malaise par rapport à la pratique des avis consultatifs ne tarda cependant pas à s’établir dans la doctrine internationale.9 On peut même dire qu’il précéda l’adoption de la pratique, comme le démontre le débat du comité international des juristes chargé de la rédaction du Statut de la C.P.J.I.10 Les critiques viennent essentiellement en deux temps. D’abord, l’avis consultatif est généralement considéré comme une fonction suspecte pour un tribunal qui, pour préserver son intégrité, devrait seulement exercer des fonctions à « caractère judiciaire ». En l’absence d’un différend né entre deux ou plusieurs parties, on questionne le bien-fondé d’un avis qui s’apparenterait moins au jugement d’un tribunal qu’à l’opinion juridique que pourrait rendre un procureur général ou n’importe quel avocat. Cette critique est présente autant en droit international qu’en droit interne. Ensuite, la position classique du droit international selon laquelle les parties contractent leurs obligations serait incompatible avec des avis généraux qui pourraient contraindre à l’avance les acteurs qui n’auraient pas accepté d’être ainsi liés. Ces deux critiques nous semblent mal fondées. D’une part, c’est une vision trop statique de la fonction judiciaire que d’affirmer que tout ce qui va au-delà de la décision du juge dans un conflit né entre deux parties peut dangereusement porter atteinte au caractère judiciaire d’un tribunal, même international. Ces critiques font fi de la constante évolution du rôle du juge et de la fonction judiciaire en droit interne comme en droit international (I). D’autre part, une vision trop classique du droit international ne reflète en rien la réalité puisque les États membres de l’Organisation des Nations Unies se sont liés à cette fonction consultative de la C.I.J.11 De plus, autant en droit interne qu’en droit international12, la vraie source 9 Charles de Visscher, « Les avis consultatifs de la Cour internationale de justice » (1929) R.C.A.D.I. 1 [de Visscher, « Les avis consultatifs »]; D.W. Grieg, « The Advisory Jurisdiction of the ICJ and the Settlement of Disputes Between States » (1966) 15 I.C.L.Q. 332. 10 Voir les propos de Elihu Root et John Bassett Moore cités au début de la section II.B, infra. 11 Charte des Nations Unies, art. 96 [Charte]. 5 de la norme juridique, qui est par ailleurs constamment remodelée par les actions des acteurs,13 demeure la force persuasive et l’adhésion des acteurs à cette norme. C’est pourquoi les mauvais jugements14 sont évoqués « sans insister sur le[ur]s conclusions »15 et que les extraits convaincants d’avis « non-obligatoires »16 sont cités à répétition par la Cour dans sa propre jurisprudence17. Les avis consultatifs de la C.I.J. seraient donc légitimes lorsqu’ils permettent de poser des jalons nécessaires au fonctionnement de la société internationale (II). Ce uploads/S4/ savoie.pdf
Documents similaires



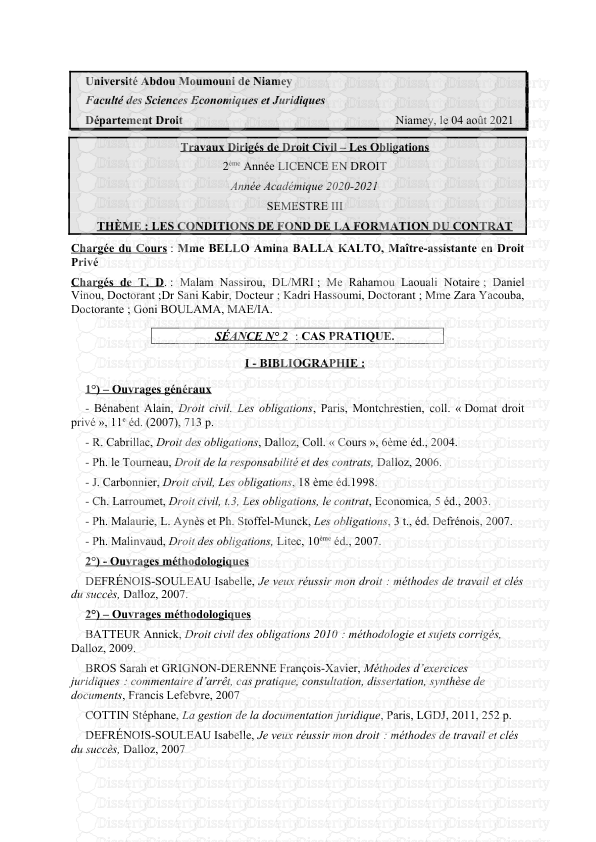






-
49
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 03, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.4383MB


