PRISON Article écrit par Gilles CHANTRAINE Prise de vue Depuis les années 1980,
PRISON Article écrit par Gilles CHANTRAINE Prise de vue Depuis les années 1980, les analystes du système pénal cherchent à décrire l'inertie qui caractérise les institutions carcérales pour en interpréter l'étrange dynamique : au fil des époques, la prison semble changer autant qu'elle paraît immuable. Les tenants de la pensée critique, notamment dans le sillage de Michel Foucault – Surveiller et punir paraît en 1975 –, ont ainsi analysé comment les réformes pénitentiaires reproduisent plus qu'elles ne transforment le régime de pénalité moderne, et comment, en conséquence, elles participent paradoxalement à sa reproduction en en épousant explicitement ou implicitement la rationalité et les impensés. La prison est le lieu où l'imposition d'une discipline spécifique permet le redressement et l'amendement de personnes anormales ou perverties qui ont commis des infractions pénales : telle est la définition de la vocation de la peine de prison forgée par le XIXe siècle qui, par le biais de plusieurs moments de réélaboration dont le dernier s'est produit après 1945, s'est transmise comme horizon de la réforme du système carcéral. Pourtant, comment ne pas voir que, derrière ce monolithisme apparent, les transformations organisationnelles des prisons, mais également les nouvelles théories et plus largement encore les mutations des sociétés contemporaines modifient significativement cette institution ? Du point de vue organisationnel, la diversité, le pluralisme et le processus d'ouverture relative qui caractérisent la détention depuis quelques décennies (dans les domaines du travail, des activités, des interdits et des sanctions, des droits...) entraînent une complexification des rapports sociaux en détention. Du point de vue théorique de la pénologie, l'apparition de nouvelles idéologies pénales, l'usage de la catégorie du « risque », ses hybridations avec les notions de « dangerosité » et de « besoin », mais également l'essor de peines alternatives, la focalisation sur certaines incriminations ou figures de dangerosité, déplacent les fonctions carcérales, modifient les circuits d'alimentation de l'institution et en reconfigurent l'économie. Enfin, qu'on mette l'accent sur la mondialisation, les transformations du capitalisme international, les mutations du marché du travail ou sur les caractéristiques de notre seconde modernité, force est de constater que l'environnement du système pénal et carcéral transforme significativement les finalités qu'on lui attribue. Dans un premier temps, la reconstruction de la sociogenèse de l'institution et la structure générale des réformes pénitentiaires au fil du temps permettront de saisir la dynamique particulière de l'institution : si la prison constitue d'abord un outil de gestion des illégalismes, son inertie ne réside pas tant dans son fonctionnement disciplinaire que dans le parasitage permanent du désir de correction par la réalisation pragmatique de l'objectif central de l'institution : la contention des reclus ; par ailleurs, les conditions de détention que doit supporter le prisonnier constituent certes une peine corporelle, mais ce châtiment doit cependant rester « acceptable » aux yeux d'une démocratie, et les conditions de détention doivent, en conséquence, s'adapter à leur temps, à l'évolution des sensibilités collectives. Dans un second temps, nous expliciterons la situation spécifiquement contemporaine des prisons françaises, prises en étau entre deux tendances contradictoires. D'un côté, le déclin de la mission de réinsertion de la prison, l'essor d'une société du risque et la volonté d'éliminer socialement les individus dangereux tendent à renforcer la structure sécuritaire de l'institution, ce qui multiplie inévitablement les violations des droits des individus enfermés ; de l'autre, la critique du totalitarisme de l'institution et l'exigence du respect des droits de l'homme (le détenu en l'occurrence) mettent quotidiennement à l'épreuve l'exercice traditionnel du pouvoir en prison, et contrecarrent partiellement la première tendance. Là s'esquisse l'ambiguïté sociale-historique majeure de la prison du XXIe siècle. I- Naissance et reproduction d'une institution La notion d'illégalisme, forgée par Michel Foucault, souligne la fausse neutralité des catégories juridiques qui représentent « l'ordre » et « le désordre » comme des faits historiques stables et universels, faits objectifs dépourvus de tout jugement de valeur. Ainsi, l'ordre social apparaît au moins comme le produit d'une double construction : celle qu'opère le jeu des catégorisations juridiques et celle que mènent les diverses instances de contrôle et de sanction. L'association crime-punition-prison doit donc être dénaturalisée. Par la mise en évidence de ses circuits d'alimentation sélectifs, la population carcérale apparaît alors comme le produit d'une construction sociale spécifique. Illégalismes populaires et mise à l'écart des « grands déviants » Ici, la reconstruction de la genèse de l'institution permet de saisir le lien qui, dès sa naissance et jusqu'à aujourd'hui, unit la prison à une « clientèle » spécifique. Sous l'Ancien Régime, en effet, l'administration royale, l'appareil judiciaire et la famille se répartissent le contrôle des comportements indésirables selon des procédures traditionnellement réglées. Les lettres de cachet, moyen informel de répression hors des justices communément établies, visent particulièrement deux groupes : d'une part, ceux qui semblent représenter un danger sociopolitique, souvent décrits comme des ennemis sociaux, tels les vagabonds de la campagne, mendiants, gens sans aveu, ouvriers au chômage, et, d'autre part, les indisciplinés de toute sorte. Avec leur abolition, une pièce essentielle du dispositif disparaît et ruine l'édifice ; la reconfiguration des modes d'administration et de répression des indésirables doit maintenant s'inscrire dans le nouvel ordre légaliste. L'analyse du Code pénal de 1810 est éclairante : les anciennes logiques d'enfermement, et les anciennes catégories de personnes qui font l'objet de ces enfermements sont codifiées et construites comme infractions et comme infracteurs : les pauvres, mendiants, vagabonds sont assimilés à des malfaiteurs, et un certain nombre de pratiques, touchant aux mœurs et aux écrits par exemple, sont définies comme des délits punissables. Avec cette codification, la prison s'installe comme un pilier de l'ordre public. Le droit pénal légalise et légitime ainsi la continuité des pratiques d'enfermement dans le nouvel ordre contractuel mis en place par les révolutionnaires. Comme l'ont notamment souligné Claude Faugeron et Jean-Michel Le Boulaire, la prison revêt, dès lors et jusqu'à aujourd'hui, deux fonctions principales. D'abord, une fonction pratique de sûreté, centrée sur la cessation du trouble et sa sanction immédiate, caractérisée par la rapidité de l'intervention et sa fréquence (cas français de la procédure de comparution immédiate). Elle consiste en une mise à l'écart temporaire, des procédures presque automatiques et des justifications essentiellement liées à l'ordre public. Cette première fonction, remplie par les maisons d'arrêt, gère des populations peu qualifiées, main-d'œuvre potentielle ou individus définitivement écartés du marché du travail, indifféremment sous le régime de la courte peine de prison ou de la détention préventive. La seconde fonction, statistiquement minoritaire, tout en restant de l'ordre de la sûreté et de la neutralisation, est davantage ordonnée à la peine. Elle est ritualisée, fortement investie symboliquement et dotée d'une procédure mettant en scène l'appareil judiciaire. Son résultat attendu est, à travers l'application du châtiment, le changement individuel du condamné. La deuxième dimension du concept d'illégalisme, au-delà de l'analyse sociologique de la construction du droit et de la nature spécifique de l'infraction, rend également nécessaire l'analyse des caractéristiques, notamment socio-économiques, qui constituent des facteurs de « succès » du passage d'un maillon à l'autre de la chaîne pénale, aboutissant finalement à une incarcération. Philippe Robert et Claude Faugeron montrent que le système pénal apparaît ici comme un entonnoir muni de filtres successifs, qui vont de l'enquête policière jusqu'aux organes d'exécution des peines, en passant par le parquet, les juridictions d'instruction, les tribunaux. Ces filtres ont un effet cumulatif et la personne qui arrive « en bout de parcours » a de forts risques d'être condamnée à une peine de prison ; à chacun des mécanismes sociaux conduisant à l'emprisonnement, les mêmes causes produisent les mêmes effets et finissent, par un processus d'accumulation, à rendre l'incarcération irréversible. La police a d'autant plus tendance à garder à vue et à transmettre immédiatement au parquet l'auteur présumé d'une infraction que ses garanties d'insertion sociale sont plus faibles. Le parquet en fait autant et le juge d'instruction, s'il ne se sent pas protégé par une prise en charge de l'inculpé qu'il estime efficace, préférera ne pas le remettre en liberté plutôt que de courir le risque de le voir disparaître. Enfin, la peine prononcée en sera d'autant plus une peine de prison ferme : à délit égal, la probabilité d'être condamné à une peine de prison ferme est plus grande si l'on comparaît détenu que si l'on comparaît libre. Ainsi, les critères de pauvreté et de désaffiliation réduisent les chances de protection contre le processus de prise en charge institutionnelle, et « facilitent » à chaque fois le passage d'une étape à une autre du processus répressif. La population carcérale doit donc être saisie comme le produit d'une sélection dont le caractère discriminatoire est réparti sur plusieurs instances décisionnelles. En ce sens, nous pouvons affirmer que les institutions carcérales incarnent par excellence une contradiction centrale de la modernité, entre, d'un côté, l'universalisme des références qui sont au fondement de l'État, du droit et de la démocratie politique, et, d'autre part, le particularisme des formes de domination sociale telles qu'elles se déploient à partir du XIXe siècle et de la mise en place du capitalisme industriel. Depuis sa naissance jusqu'à nos jours, la population pénitentiaire uploads/S4/la-prison.pdf
Documents similaires
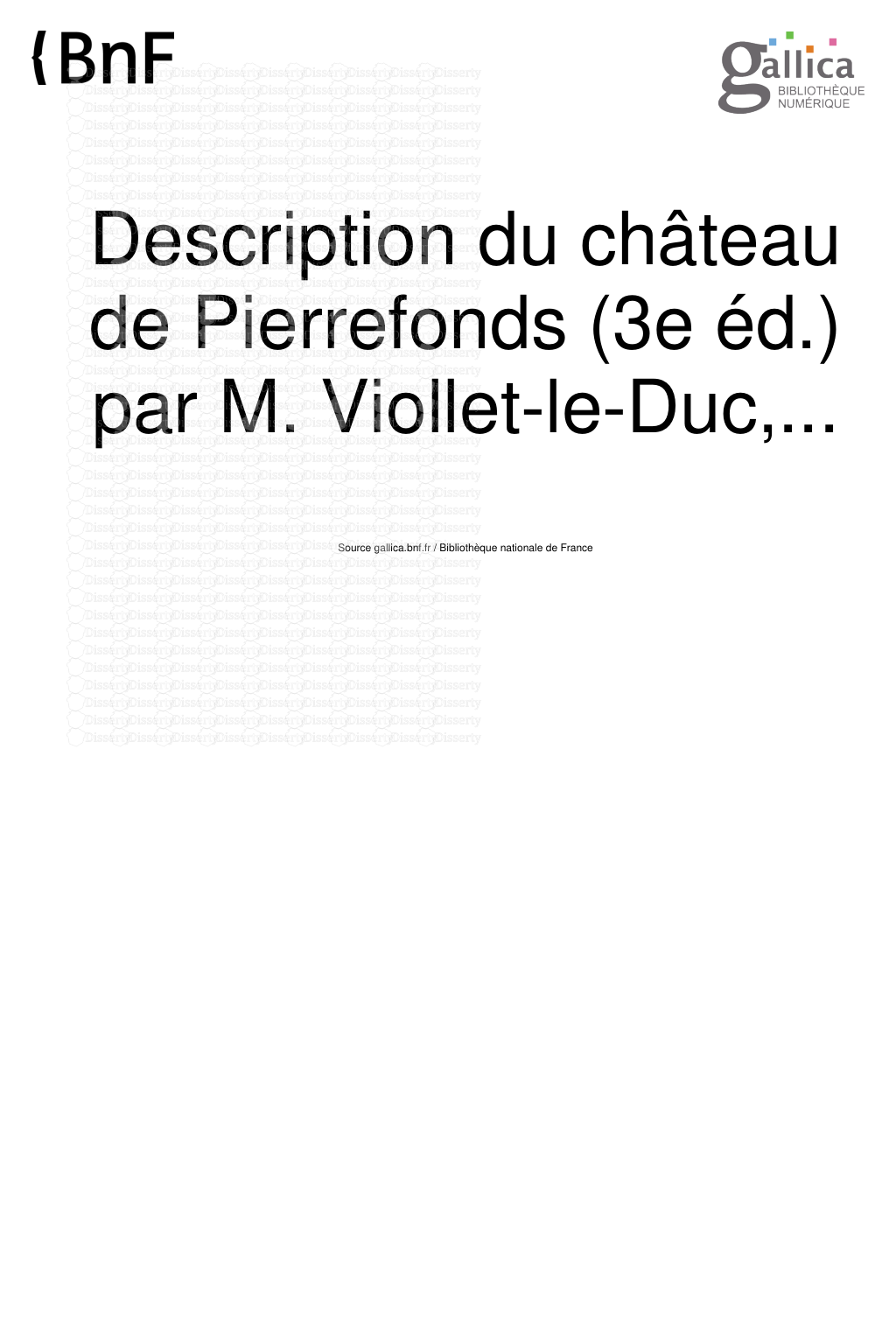









-
60
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 25, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.0896MB


