NOTE N°3 L’alcali-réaction dans les bétons Sommaire 1. Généralités 2. Pathologi
NOTE N°3 L’alcali-réaction dans les bétons Sommaire 1. Généralités 2. Pathologie et manifestations externes 3. Introduction 4. Le dépistage des granulats réactifs 5. Les recommandations pour la prévention des désordres dus à l’alcali-réaction 6. Les méthodes d’essais de qualification des granulats 7. Remarques et conclusion 8. Tableaux et schémas 9. Bibliographie 1. Généralités Le développement des phénomènes d’alcali-réaction dans les bétons nécessite la conjugaison de trois principaux facteurs : - des alcalins dans la phase liquide intrestitielle du béton, - des granulats réactifs, - de l’eau ou un environnement humide. Le premier facteur nécessite la connaissance du processus des réactions et du rôle des ciments. La connaissance du deuxième facteur est essentielle dans la démarche préventive que tout projeteur doit effectuer lors de l’étude de l’ouvrage. Le troisième facteur, lié à l’environnement de l’ouvrage, peut dans une certaine limite être maîtrisé par l’adoption de dispositions constructives. La présente note rappelle dans un premier temps, la pathologie et les manifestations externes résultant du phénomène d’alcali-réaction, puis décrit les méthodes nouvelles récemment mises au point et normalisées en France, permettant de dépister de façon rapide et fiable les granulats potentiellement réactifs. Enfin, elle présente, dans l’état actuel des connaissances, les recommandations techniques établies en France en janvier 1991 et en juin 1994, permettant de prévenir des désordres dus à l’alcali-réaction. Dans le cas d’un risque éventuel, il est utile de contacter les organismes spécialisés. Des tableaux et schémas complètent cette note. 2. Pathologie et manifestations externes La dégradation du béton des ouvrages résultant du phénomène d’alcali-réaction a été répertorié dans de nombreux pays. En France métropolitaine, les premières indentifications ont été décelées depuis plus d’une dizaine d’années sur des ouvrages hydrauliques, principalement des barrages, mais aussi des pièces en béton préfabriquées en usine avec étuvage. Plus récemment, des cas de ponts, culées de ponts, et aussi bâtiments ou réservoirs affectés par le phénomène ont été identifiés. Aux Antilles françaises en particulier, quelques réservoirs, stations d’épuration et constructions immobilières ont été signalées ces dernières années. En général les désordres apparaissent à des échéances variables de deux à dix ans ou plus. La pathologie et les manifestations externes se signalent par un ou plusieurs des symptômes suivants : - une fissuration, - un faïençage à mailles plus ou moins larges ou en étoile ou une fissuration orientée suivant une direction fonction de la distribution des armatures, - des exsudations blanches formées de calcite et parfois de gels translucides, - des pustules ou cratères avec des éclatements localisés en forme de petits cônes résultant de la réaction de gros granulats superficiels qui sont visibles au fond des cratères d’éclatement, - des mouvements et déformations, - des colorations ou décolorations. 3. Introduction L’alcali-réaction est une réaction chimique entre certaines formes de silice et de silicate, pouvant être présentes dans les granulats et les alcalins du béton. Elle correspond à une attaque du granulat par le milieu basique du béton et provoque la formation d’un gel de réaction (silicate alcalin), dont l’expansion engendre, sous certaines conditions, des gonflements. Comme le souligne le chapitre généralités, les trois conditions nécessaires à l’existence de l’alcali- réaction sont : - une teneur élevée en alcalins dans la phase liquide interstitielle du béton, - la présence de produits réactifs dans les granulats (minéraux réactifs), - de l’eau ou un environnement humide. La prévention de ce type de pathologie et de manifestations externes, nécessite, d’une part de repérer les granulats potentiellement réactifs et d’autre part d’établir une procédure de choix des matériaux constitutifs du béton, de façon à éviter tout risque ultérieur. 4. Le dépistage des granulats réactifs Les matériaux réactifs comme les silices amorphes ou cryptocristallines, sont les facteurs principaux qui interviennent dans les réactions. Ils sont facilement identifiables au moyen de l’analyse chimique et pétrographique. On les rencontre dans les roches et alluvions siliceuses, dans les roches carbonatées (sous forme d’inclusions) et dans les roches ou alluvions silicatées polyphasées. La liste des principales roches concernées est largement publiée dans la littérature. Le tableau n°1 [3], reproduit en annexe, donne les principales roches pouvant contenir des minéraux sensibles en milieu alcalin. L’identification de ces roches n’est pas suffisante pour permettre de caractériser un granulat comme réactif. Cette première approche, absolument nécessaire, permet tout au plus d’alerter sur l’existence ou non d’un risque. Dans l’affirmative, ce sont les essais qui permettent la décision. Ces essais existent depuis plusieurs années, essentiellement dans la littérature Nord américaine. Ils ont cependant été critiqués, car souvent lents mais également peu fiables. Ces cinq dernières années, des recherches ont été conduites en France dans le cadre de l’AFREM [5], dans le but de mettre au point des méthodes d’essais de dépistage rapides et fiables des granulats potentiellement réactifs. A l’heure actuelle en France, cinq essais normalisés de qualification des granulats sont pris en compte (voir chapitres 6.2.2 et 6.2.3). 5. Les recommandations pour la prévention des désordres dus à l’alcali- réaction [3] 5.1. Généralités 5.1.1 Préliminaires Des recommandations provisoires ont été publiées en France en janvier 1991 [2], par le ministère de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme. Elles ont été élaborées dans le cadre du Comité technique des alcali-réactions. Il s’agit d’une réponse à une circulaire ministérielle de novembre 1988, signée par le directeur des routes, afin de prendre en compte un certain nombre de cas pathologiques qui venaient de se manifester en France, concernant essentiellement des ouvrages d’art. Les recommandations de janvier 1991 étaient "provisoires", parce que l’alcali-réaction était loin d’être une science exacte. Nous disposons actuellement d’un acquis national et international, avec l’aboutissement de nombreuses recherches, qui ont permis de proposer un nouveau texte de recommandations publié en juin 1994, mais il reste encore des zones d’ombres, justifiant un certain nombre de recherches en cours, de sorte que le document actuel sera peut être appelé à évoluer. Ces deux recommandations ont été éditées par le "Comité technique des alcali-réactions", organisme constitué à l’initiative du directeur des routes, qui est à l’heure actuelle, présidé par le directeur du Laboratoire central des ponts et chaussées. Il réunit des maîtres d’ouvrage, des entrepreneurs et des producteurs de matériaux (ciments, granulats, adjuvants, béton prêt à l’emploi). 5.1.2 Les recommandations de juin 1994 Elles proposent une démarche préventive, qui s’effectue en deux temps : a) détermination d’un niveau de prévention parmi 3 cas possibles, selon la catégorie de l’ouvrage et sa classe d’exposition (voir tableaux n° 2 et 3). b) orientation vers la (ou les) solution(s) possible(s), en fonction du niveau de prévention retenu (voir tableau n° 4). L’ensemble des dispositions recommandées, peut être utilisé pour la rédaction d’un cahier des charges. On consultera utilement certains guides publiés [7] et [8]. Les ouvrages intéressés par ces recommandations sont les ouvrages neufs (à réaliser). Ce qui relève des ouvrages existants (diagnostic, pathologie et réparation) n’est pas de son domaine d’application. 5.1.3 Remarques Lors de la rédaction des recommandations "provisoires", certains membres, et en particulier les entrepreneurs se sont, au dernier moment, désolidarisés de ce document en manifestant leur désaccord sur certains niveaux de seuils recommandés. La publication en 1991 des recommandations, résulte d’une démarche nouvelle, car les documents anciens étaient essentiellement descriptifs et qualitatifs. C’était le cas notamment du bulletin CIGB qui était en préparation. Ce sont d’ailleurs ces indications quantitatives et chiffrées des seuils, qui n’ont pas fait l’unanimité. A l’heure actuelle, on ne sait pas encore établir la relation entre la réactivité chimique et les contraintes internes qui modifient le comportement des ouvrages. Les produits formés par la réaction, selon la porosité du matériau et la viscosité des gels qui se forment, peuvent avoir ou non un caractère pathogène. Des recherches fondamentales ont été engagées. Des essais de dépistage rapides et fiables des granulats réactifs sont indiqués dans le document [3] : ils résultent des travaux réalisés en France par l’Association française de recherches et d’études des matériaux (AFREM). L’aspect cinétique (développement et prévision d’évolution pour les ouvrages existants), lorsqu’on est en présence de cas pathologiques reste à traiter. S’il n’y a pas de problèmes pour le diagnostic, il en reste pour définir l’évolution ultérieure. 5.2. Les étapes de la démarche préventive Comme indiqué précédemment, la démarche préventive comprend deux étapes qui sont : - la détermination d’un niveau de prévention, - le choix de solutions techniques possibles en fonction du niveau de prévention que l’on a retenu. 5.2.1. Niveau de prévention Le tableau N°4 des niveaux de prévention définit un certain nombre de classes d’exposition à l’environnement [tableau N°3] et de catégories d’ouvrages [tableau N°2]. C’est le maître d’ouvrage qui détermine le niveau de prévention. Les ouvrages concernés par le fascicule 74 du CCTG, sont principalement classés en catégorie II dans la classification des ouvrages, en classe 2 d’exposition à l’environnement climatique, et donc un niveau de prévention B. Le tableau N°3 nous permet de définir l’appartenance d’un ouvrage en fonction de l’exposition et l’environnement. Le tableau N°2 classe les ouvrages par catégorie : - la catégorie I regroupe les ouvrages intérieurs, secondaires ou ceux dont les parties détériorées sont facilement remplaçables, - la catégorie II uploads/Finance/ 6.pdf
Documents similaires








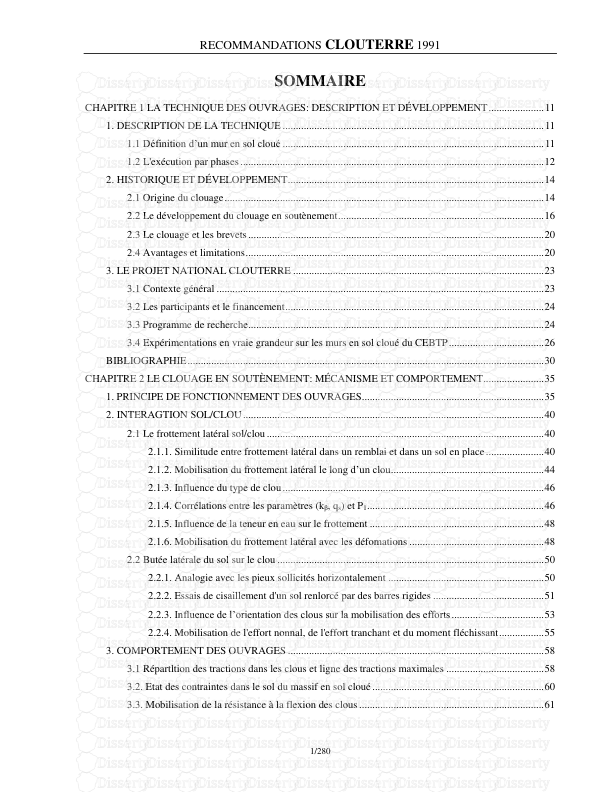

-
76
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 23, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.1097MB


