PARTIE 1 Une entreprise est une structure comprenant une ou plusieurs personnes
PARTIE 1 Une entreprise est une structure comprenant une ou plusieurs personnes et travaillant de manière organisée pour fournir des biens ou des services à des clients dans un environnement concurrentiel (le marché) ou non concurrentiel (le monopole). I . GENERALITES SUR L ENTREPRISE ET SON ENVIRONNEMENT Classification des entreprises En fonction de leur activité En fonction de leur secteur économique En fonction de leur taille et impact économique En fonction de leur statut juridique L’environnement et les variables d’influence La viabilité d’une entreprise dépend du maintien harmonieux d’une relation externe avec le monde des consommateurs et d’une relation interne entre les membres de l’entreprise; L’entreprise et son environnement L’environnement interne L’environnement interne ou microenvironnement comprend l’ensemble des facteurs qui permettent aux membres ou aux équipes d’une organisation de travailler harmonieusement. Les principales composantes de l’environnement interne sont: – les fonctions de l’organisation Fonctions principales : Achat/Approvisionnement- production- Vente Fonctions secondaires : Administration- Ressources humaines-comptabilité – les intervenants internes, qui évoluent à l’intérieur de l’entreprise (gestionnaires, employés, syndicats, actionnaires); – la culture organisationnelle (croyances, attitudes, valeurs). L’environnement externe L’environnement externe, ou macroenvironnement, est constitué de tout ce qui, à l’extérieur de l’organisation, influe sur ses objectifs et ses plans. Dans ce cas, on parlera d’environnement général (économique, politique, social) et d’environnement immédiat (consommateurs, fournisseurs, distributeurs). Flux = écoulement ou mouvement de biens, information ou d’argent •Flux financiers •Flux physiques •Flux d’information Flux financiers II. LES FLUX EN ENTREPRISE 1) DEFINITION DE LA LOGISTIQUE La logistique est une fonction « dont la finalité est la satisfaction des besoins exprimés ou latents, aux meilleures conditions économiques pour l'entreprise et pour un niveau de service déterminé... . La logistique fait appel à plusieurs métiers et savoir-faire qui concourent à la gestion et à la maîtrise des flux physiques et d'informations ainsi que des moyens » III. LA LOGISTIQUE EN ENTREPRISE 2) Aperçu sur l’historique de la logistique Le mot « logistique » a une origine très ancienne puisqu’il dérive du grec logistikos « qui concerne le calcul, le raisonnement ». Selon Platon, le terme correspond davantage au calcul pratique. Il apparaît dans la langue française pour la première fois en 1546, dans le sens de « raisonnement » et, en 1611, pour son sens relatif au calcul. Dans ce dernier cas, il désigne la partie des mathématiques qui traite des quatre opérations fondamentales. Au début du XXème siècle, lors du congrès de philosophie de 1904, la logistique est définie comme la « logique nouvelle », c’est-à-dire come la logique symbolique, mathématique ou algorithmique. La définition du mot « logistique » est donc empreinte de rationalité, d’une « rationalité en finalité » au sens de Weber (1922) c’est-à-dire qui caractérise « celui qui oriente son activité d’après les fins, moyens et conséquences subsidiaires et qui confronte en même temps rationnellement les moyens et la fin, la fin et les conséquences subsidiaires et enfin les diverses fins possibles ». Cette origine du terme va caractériser, les prémisses de la logistique d’entreprise : la volonté de minimiser les coûts des différentes opérations afin d’optimiser l’ensemble de la chaîne logistique. Progressivement, une rationalité des opérations (David et Paraponaris, 1993), ou procédurale (Fabbe-Costes, 1996), va également émerger. Celle-ci consiste en la recherche d’une optimisation globale fondée sur une réflexion intégrant l’ensemble de la chaîne logistique. L’idée qui prévaut est que la somme des optima locaux n’est pas forcément synonyme de l’atteinte de l’optimum global et qu’il convient donc de rechercher, dès le départ, une optimisation globale approximative de la chaîne. Ces deux conceptions de la logistique se concrétisent respectivement dans les sciences de l’ingénieur et dans les sciences de gestion. Les militaires, et particulièrement le général Antoine- Henri de Jomini (1837), reviennent également à la racine « logis » et considèrent la logistique comme l’ensemble des opérations ayant pour but le logement, le transport et le ravitaillement d’une armée, c’est-à-dire « l’art pratique de mouvoir les armées ». Du militaire à l’humanitaire Aucun ouvrage qui traite de la logistique ne saurait faire l’économie d’un retour sur les pratiques militaires. En la matière, deux perspectives complémentaires sont envisagées. La première consiste à rechercher dans les faits militaires (batailles, guerres…), l’importance de la logistique dans la réussite des opérations. La seconde s’intéresse aux essais de synthèse produits par les militaires dans les nombreux traités de l’art et la guerre, et s’accompagne d’une réflexion (métaphorique puis anthologique) sur les conditions d’application du militaire au management (Le Roy, 1999). Les chercheurs font preuve d’une grande détermination dans leur capacité à retrouver des exemples militaires toujours plus anciens illustrant le caractère stratégique de la logistique. Le succès d’Hannibal, dans sa conquête de la péninsule italienne après sa traversée des Alpes, met en avant l’importance, du ravitaillement des troupes alors même qu’une stratégie de harcèlement et de guérilla est conduite par les tribus celto-ligures tout au long de son périple. Jules César, Napoléon ou encore Rommel et son Afrikakorps (en romain) complètent ce tableau des grands stratèges de l’histoire et nous éclairent sur l’importance du ravitaillement et de la mobilité des troupes. Parmi les grandes batailles, c’est sans nul doute le débarquement de Normandie qui fait l’objet du plus grand nombre d’études. Jacques colin (1996) explique que l’échec de l’opération See-löwe ou le succès de l’opération Overlord a été fonction de la prise en compte ou non d’éléments logistiques (possession de chalands de débarquement, construction d’infrastructures portuaires, acheminement du carburant…). Cette importance des infrastructures et des voies de communication est formalisée dans les traités rédigés par les militaires. Le général Gil Fiévet définit ces trois principes : « la concentration des efforts est l’accumulation des moyens dans l’espace et dans le temps pour réaliser localement une supériorité décisive ; la liberté d’action est la capacité d’agir qui s’exerce en soi et doit pouvoir s’exercer malgré l’ennemi ; l’économie des forces est l’art de peser successivement sur les résistances que l’on rencontre du poids de toutes ses forces et pour cela de monter ses forces en systèmes ». Ces trois principes qui réalisent la conjugaison de la pensée et de l’action s’appuient donc sur le vouloir (concentration des forces), le pouvoir (liberté d’action) et le savoir (économie des forces), et ont respectivement comme piliers (base d’un système opérationnel) les forces morales, la logistique et le renseignement. Le général Colin, toujours au début du XXème siècle, voit alors dans la logistique et les transmissions des facteurs décisifs de la conduite des combats futurs, et défend une augmentation de la protection des voies de communication et l’exploitation au service du renseignement, des dirigeables et ballons. Cette conceptualisation de la logistique préfigure exactement son acceptation au sein des entreprises où il s’agit de piloter des flux physiques par des flux informationnels. Il s’agit d’ailleurs d’un retour aux sources pour les militaires, car si l’on pense spontanément au ravitaillement et à la mobilité des troupes lorsque l’on évoque la logistique dans l’armée, il convient de ne pas oublier que l’une des préoccupations essentielles réside dans la capacité à faire en sorte que les hommes soient efficaces au combat (qualité du ravitaillement, éléments sanitaires et hygiéniques…); LA CHAÎNE LOGISTIQUE Amont Approvisionnement Production Distribution physique Aval Fournisseurs Firme manufacturière Distributeurs Flux de marchandises Flux d'informations Flux financiers 3) Evolution de la fonction logistique Plan de production Plan d'approvisionnements Planning de distribution Gestion des demandes / prévisions Flux physiques Amont Approvisionnement Production Distribution Aval Planification Planification Planification Fournisseurs Clients LA CHAÎNE LOGISTIQUE INTEGREE Le réseau des flux d’information et des flux physiques constitue un domaine privilégié de la logistique, le Supply-Chain Management. Les acteurs de ce réseau global sont des acteurs logistiques. Tous ont en charge la transmission d’information et/ou la transmission d’un produit, d’une marchandise, ... Certains acteurs ont des activités ayant un caractère « purement logistique » tels que les entrepôts de stockage, les transports, ... L’organisation logistique peut-être locale : un entrepôt et ici il s’agira d’organiser et de gérer les approvisionnements depuis les fournisseurs, les flux internes à l’entrepôt et les flux sortant en direction des Client de l’entreprise. L’organisation logistique peut-être globale : un réseau de distribution et ici il s’agira de choisir les implantations des entrepôts, les règles d’échanges qui globalement vont faire « vivre » ce réseau. Dans l’ensemble de ces cas, une plus ou moins bonne organisation influencera l’entreprise en termes de ses : - coûts de son organisation logistique - résultats issus de cette organisation en termes de niveau de service et de taux de service. IV. RELATION CLIENT FOURNISSEUR Les relations client fournisseur peuvent être : Externe : les flux amont constitueront les liens avec le marché fournisseur de l’entreprise. Les flux avals constitueront les envois réalisés par cette entreprise vers ses marchés clients. Interne : les flux amont constitueront les liens avec les activités, les services qui fournissent les informations, la marchandise, à une activité. Les flux aval constitueront les liens avec les activités, les services « clients » de cette activité, liens matérialisés par des échanges d’informations et des échanges physique. BASES DE LA RELATION (1) Confiance (2) Besoins Solution uploads/Finance/environnement-logistique-de-l-x27-entreprise-part-1 1 .pdf
Documents similaires
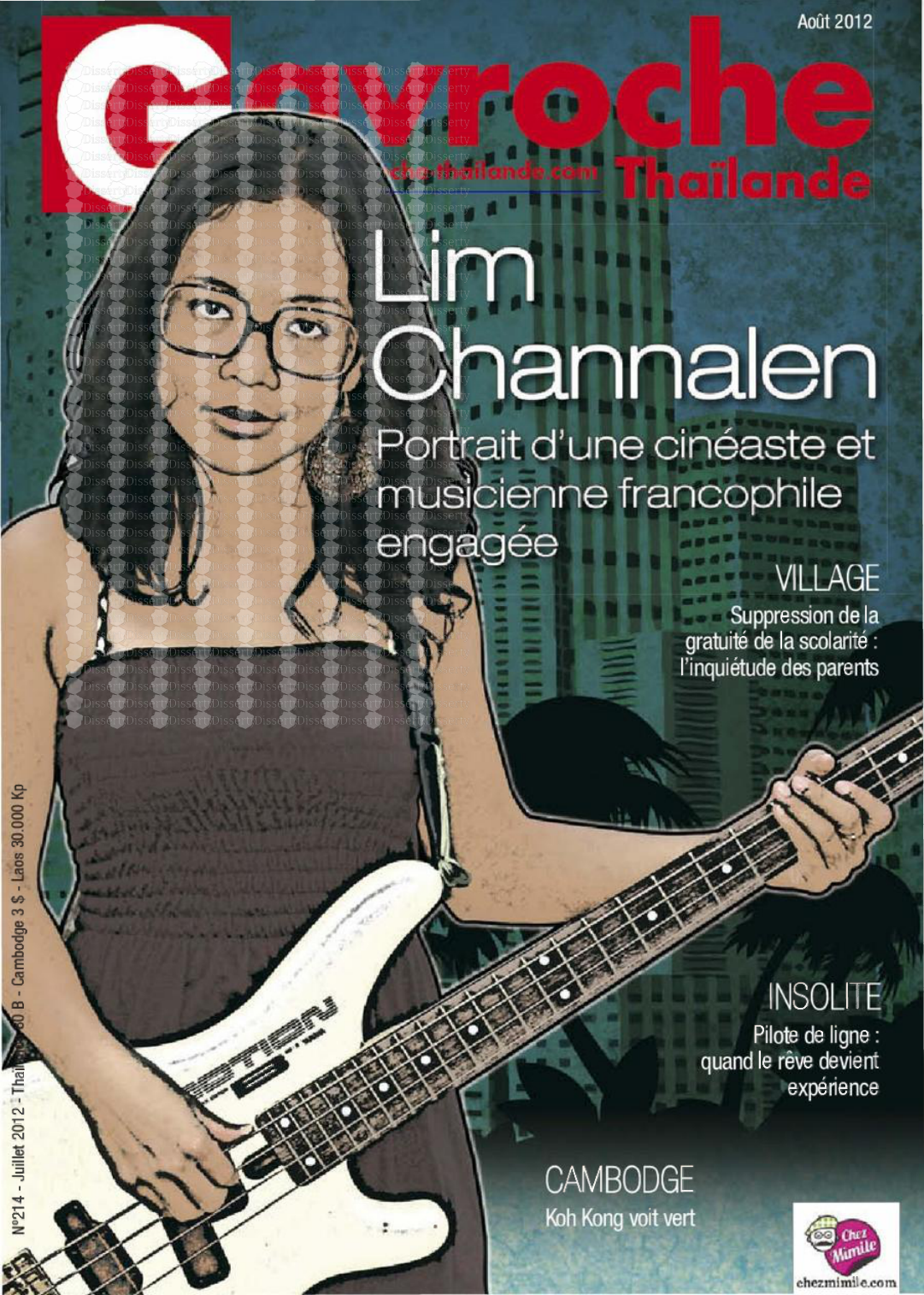






-
28
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 03, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 1.8377MB


