L a production de la pisciculture africaine au sud du Sahara est estimée à 3400
L a production de la pisciculture africaine au sud du Sahara est estimée à 34000t en 1989 (tableau 1) sur une produc- tion mondiale (poissons seuls) de 7 300 O00 t. Cette production est essentiellement constituée de tilapias (15 O 0 0 t), de Ckz- rias (10 000 t) et de carpes communes (5 000 t). Il s'agit donc d'une activité encore embryonnaire et qui cherche sa voie sur le plan du développement depuis environ un demi-siècle. L'aquaculture ne contribue encore que très marginalement à l'approvisionne- ment en protéines d'origine aquatique du continent africain où la production halieutique totale (maritime et conti- nentale) était évaluée en 1989 à 5 OOO 000 t. La part du poisson dans l'approvisionnement en protéines y est néanmoins très élevée (23,l %), légère- ment moins qu'en Asie (entre 25,2 et 29,3 %), mais loin devant l'Amérique du Nord (63 Yo) ou l'Europe occiden- tale (9,4 Yo), la moyenne mondiale étant de 16,5%. Une typologie des piscicultures africai- nes a conduit à les classer en quatre catégories, sur la base de critères socio- économiques et non du niveau d'inten- sification de la production [Il : - la pisciculture d'autoconsommation (dont le produit est destiné à l'appro- visionnement du pisciculteur et de sa famille), où les techniques mises en J. Lazard : Programme aquaculture et pêche, Cirad-Emvt. M. Legendre : Département eaux continen- tales, Orstom. J. Lazard, M. Legendre : Gamet, BP 5095, 34033 Montpellier cedex 1, France. Tirés à part: J. Lazard. La pisciculture africaine : enjeux et problèmes de recherche Jérôme Lazard, Marc Legendre œuvre, qualifiées d'extensives, correspon- dent à un faible niveau de technicité; c'est la forme de pisciculture la plus ancienne et la plus largement répandue; - la pisciculture artisanale de petite production marchande, qui se développe essentiellement en zone périurbaine et qui offre le meilleur environnement pour l'approvisionnement en intrants et la commercialisation du poisson ; - la pisciculture de type ((filière)) caractérisée par la segmentation des dif- férentes phases d'élevage, principalement en cages et en enclos; - la pisciculture industrielle, caracté- risée par des unités de production de Photo 1. L'acadja-enclos. La méthode d'élevage est dérivée de la très productive pêche- rie traditionnelle en acadjas développée dans les lagunes du Bénin. Les acadjas, sortes de récifs artificiels, sont des amas organisés de branchages installés en zones peu pro- fondes. Dans I'acadja-enclos, pour des raisons pratiques, les branchages sont rempla- cés par des bambous piqués verticalement dans le sédiment lagunaire. Ils servent de support pour le développement de périphytons puis d'épibiontes, sources de nourriture pour les tilapias. L'empoissonnement de l'enclos ainsi aménagé peut être naturel ou arti- ficiel. La production atteint 3 à 8 t/ha/an dans la lagune Ebrié (Côte-d'Ivoire), sans aucun apport d'aliment exogène (d'après Hem et ai. [71 et Hem [321) (cliché JB Amon Kothias). Plate 1. The acadja pen. The culture systern is derived frorn the traditional and very productive fishing technique used in Benin coasJal lagoons called acadja Acadjas, like artificial reefs, are made of bundles of branches set in shallow waters. In acadja pen, the bundles of branches are replaced by bamboo rods stuck vertically into the sediment. This leads to a significant increase in surface area upon which natural fish food such as micro-fauna and periphyton develop. Stocking of fish in the pen can be natural or artificial. With no artificial feed being added, the production of fish in the Ebrie lagoon reaches 3 to 8 tons per year and per ha. B Cahiers Agricultures 1994 ; 3 : 83-92 Production piscicole en Afrique subsaharienne (tonnes) (FAO, 1991 1 1989 Espèces Genres 9:ai] 14449 960 12 J 10117 9 969 Poissons d'aquaculture Principaux pays producteurs en 1989 (production > 500 t) Côte-d'Ivoire, Zaïre Nigeria Zambie Nigeria 1 O. niloticus o. spp. O. andersonii CI. anguillaris CI. gariepinus Ch. spp. Ch. nigrodigitatuç C . Carpio H. niloticus Autres poissons CI. spp. Total tous poissons 1986 Espèces Genres 2 098 625 1403) 1647 3519] 6242 1504 164 170 1. 334 487 487 1 O9 1 O9 1260 10 079 O : Oreochromis; CI: Clarias; Ch. : Chrysichthys; H. : Heterotis 1988 Espèces Genres 2 545 4 297 964 O 144 3 361 207 58 3 199 127 - 7 806 3 505 265 3 199 127 - 14 902 210 50 1 260 1 5014 ~ 130 - 3 751 - Nigeria - - 33721 1 Fish production in sub-Saharan Africa (tons) grande dimension dont l'objectif est strictement économique, voire financier, par opposition aux trois formes précé- dentes où la pisciculture constitue non seulement un outil de production, mais également un outil de développement. Dans un tel contexte, les notions d'intensif et d'extensif prennent une signification particulière. Ainsi la pis- ciculture industrielle, longtemps consi- dérée comme un moyen privilégié de concentrer géographiquement les fac- teurs de production et de réaliser des économies d'échelle, est généralement assimilée à la notion d'intensif et la pri- vatisation semble ne pouvoir passer que par son intermédiaire. Il apparaît aujourd'hui que tous les projets de ce type mis en place jusqu'à présent sur le continent africain ont échoué par rapport à leur objectif initial, à savoir produire un poisson à un coût inférieur au prix de vente. La pisciculture artisanale est, quant à elle, de type familial extensif ou semi- intensif, et généralement très dispersée géographiquement. Diverses approches menées depuis une dizaine d'années montrent que ce type d'aquaculture peut, tout en conservant sa dimension artisanale au niveau de l'exploitation, être concentré géographiquement (dans un bas-fond, une vallée irriguée par des étangs, un lac ou un tronçon de cours d'eau pour des cages ...) et induire d'importantes économies d'échelle en termes de services, tout en sauvegardant une gestion individuelle de l'exploita- tion. Cette forme d'organisation permet en outre de mettre en œuvre des tech- niques d'élevage intensives et peut ser- vir de support et de véhicule à la néces- saire privatisation des outils de produc- tion, le paysan ou le pêcheur devenu pisciculteur étant l'opérateur privé par excellence. Les techniques extensives de production piscicole, recouvrant la gestion des petits borages, des mares, des écosystèmes .,aquacoles tels que les étangs ou les ";entlos-acadjas 4 ' (photo I), apparaissent en définitive comme celles requérant un niveau intensif de connaissances et posant le plys de problèmes de repro- ductibilité. A l'opposé, les techniques . qualifiées d'intensives (alevinage con- trôlé, apport normalisé d'aliments de composition standardisée) apparaissent comme les plus simples à mettre en œuvre par les pisciculteurs, à condition de bénéficier d'un encadrement techni- que qualifié. Dans les deux cas, la tech- nicité constitue la condition de base à une bonne mise en œuvre des différents modèles d'élevage. C'est dans ce contexte et face à ces enjeux que se développe, en Afrique subsaharienne, une recherche en aqua- culture dont les principaux programmes et résultats sont décrits ici. Les programmes de recherche aquacole : conditions de mise en œuvre en Afrique Le continent africain a une longue his- toire de recherche en aquaculture, car de nombreux pays y ont entrepris des travaux dans ce domaine dès avant les indépendances. Parmi les nombreuses stations de recherche construites sut le continent, très peu ont pu poursuivre leurs travaux sans interruption. La sta- tion de recherche piscicole de Bouaké (Côte-d'Ivoire) créée en 1957 (devenue Centre piscicole de l'institut des savanes-Idessa) fait partie de ces excep- tions. Les autres stations ont été le siège de recherches plus ou moins ponctuel- les et ciblées à l'occasion de projets de développement incluant un volet de recherche d'accompagnement. Tel est le cas, par exemple, de l'important travail mené sur Clarias gariepinus à la station de la Landjia (République centrafri- caine) par les chercheurs de l'université Agronomique de Wageningen dans le cadre d'un projet de développement mis en œuvre par la FAO. Pardèlement, des recherches plus fondamentales .~ Cahiers Agricultures 1994 ; 3 : 83-92 étaient menées sur cette espèce aux Pays-Bas et, du reste, une production de Clarias fut lancée dans ce pays, dans des eaux réchauffées. La station de recherche aquacole du Centre de recherches océanologiques d'Abidjan (CRO) en Côte-d'Ivoire, créée à la fin des années 70, a connu un développe- ment croissant de ses activités au ser- vice du développement de l'aquaculture lagunaire dans ce pays. Parmi les autres stations en activité, à des degrés divers, on peut citer la station de recherche de Foumban au Cameroun et la station de la Djoumouna au Congo. Quoi qu'il en soit, force est de cons- tater qu'en Afrique subsaharienne, à quelques exceptions près, peu de cen- tres de recherche aquacole sont réelle- ment opérationnels, capables d'alimen- ter le développement en véritables inno- vations scientifiques ettou techniques. Le problème de la pérennité de cette recherche est le problème majeur qui se pose aujourd'hui en Afrique: elle coûte cher et les chercheurs sont peu nombreux. Autre problème: quel type de recherche mener en Afrique? Une recherche fondamentale, une recherche appliquée, ou un simple transfert de technologie ? La recherche fondamentale ne peut guère se concevoir hors du cadre de laboratoires bien équipés et de programmes s'inscrivant dans uploads/Geographie/ 2021-cahier-de-l-x27-agriculture-aquaculture-enjeux-et-pb-de-recherche 1 .pdf
Documents similaires

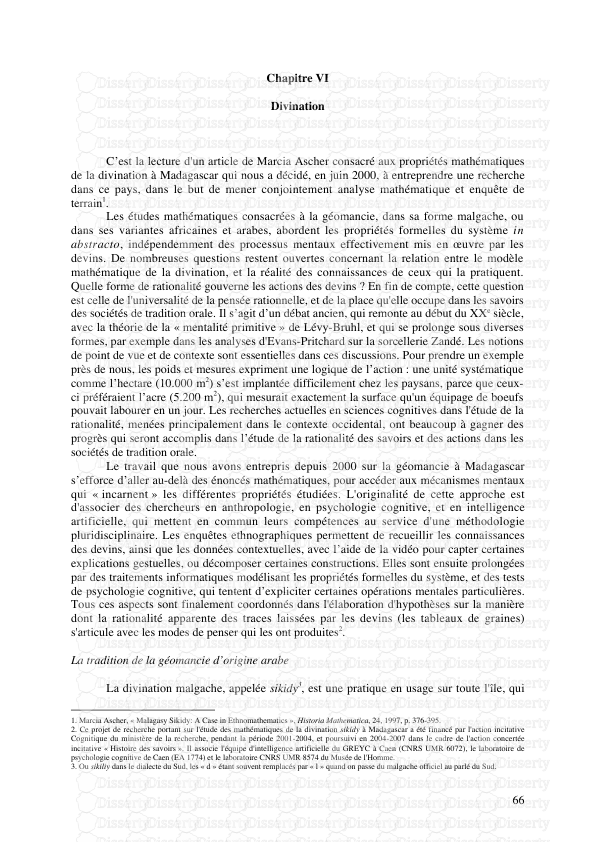








-
88
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 01, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 1.7176MB


