1 Droit Commercial et de Sociétés Prof (Mr.Slassi) / Réalisé par une étudiante
1 Droit Commercial et de Sociétés Prof (Mr.Slassi) / Réalisé par une étudiante du groupe A Introduction : Branche du droit privé relative aux opérations juridiques faites par les commerçants soit entre eux, soit avec leurs clients, le droit commercial est constitué de l’ensemble des règles juridiques applicables aux transactions commerciales. Il offre le cadre juridique à l’intérieur duquel se nouent et évoluent les rapports entre les professionnels du commerce. Ce droit est principalement destiné à régir les rapports des personnes qui accomplissent, en leur nom et pour leur compte, des «actes de commerce», ie, les commerçants. Objectif: assurer un minimum d’ordre, de sécurité et d’honnêteté entre les professionnels du commerce. Ce qui peut se révéler d’une importance primordiale dans le monde des affaires. Histoire : La première législation écrite de caractère commercial correspond à certaines dispositions du code de Hammourabi ; on y trouve des règles sur le contrat des sociétés, prêt à intérêt, de dépôt… Le droit grec, de même que le droit romain, comporte des règles sur les sociétés, les banques et les assurances maritimes. En droit romain, le terme commercium est employé pour désigner tous les rapports juridiques que les commerçants ont entre eux relativement à l’utilisation des biens. On distingue, donc, les choses in commercio et extra commercio. Au début du 13ème siècle, on voit émerger le droit commercial. Sa première caractéristique c’est d’avoir une connotation internationale. 2 Au 16ème siècle, le roi Charles 9 créa en 1563 des juridictions commerciales. En 1673 et 1681, sur l’initiative de Colbert, le roi Louis 14 publia de grandes ordonnances sur le commerce terrestre et maritime qui furent les premières législations globales soumettant les commerçants à un régime autonome. En 1791, avec la décadence des corporations et la demande de suppression des monopoles, la loi Le Chapelier proclama la liberté du commerce et d’industrie. Napoléon Bonaparte adopta en 1808 le premier code de commerce français. Au 20ème siècle, on assiste à un déclin du libéralisme économique qui avait triomphé au 19ème siècle; on constate un véritable interventionnisme des pouvoirs publics. Le début du 21ème siècle verra une véritable poussée des principes du libéralisme économique qui semble aujourd’hui sous le contrôle de l’État suite aux effets de la crise économique de 2008. Histoire du commerce du Maroc La période antéislamique: L’historien grec Hérodote (vers 484 à 425 av. J.C) décrivait à son époque le commerce muet de l’or avec les peuplades des rivages de l’Atlantique. Les carthaginois franchissait le détroit de Gibraltar, débarquaient leurs marchandises sur le rivage, remontaient à bord, puis allumaient de grands feux pour faire connaitre leur arrivée. Les indigènes eux arrivaient alors, ne touchaient à rien, plaçaient une certaine quantité d’or et s’écartaient. Par la suite, les carthaginois ne reprenaient l’or que lorsque les berbères en avaient mis une quantité qui leur semblait couvrir le prix de la marchandise. «Ni les uns, ni les autres ne sont malhonnêtes» écrivait Hérodote. Les carthaginois agissaient à partir de comptoirs, à la fois escales, entrepôt et marchés qu’ils possédaient sur les côtes de la Méditerranée et de l’Atlantique. Ils rassemblaient les plumes d’autruches, l’ivoire, l’or apportés du Soudan, des produits en tout genre et des esclaves. De là, ils répandaient leurs marchandises: verroterie, vases, objets en bronze ou en fer. La période postislamique: Le droit islamique qui va régler toutes les relations juridiques: ne faisant pas de distinction entre activité civile et activité commerciale car toutes les activités humaines sont classées dans la même rubrique des «muâmalates». Le Maroc, étant aux portes de l’Europe, a joué un rôle d’intermédiaire important entre l’Afrique et le nord de la Méditerranée. Avec l’Europe: Au Moyen-âge, des relations commerciales vont voir le jour avec les Almoravides: À cette période, les Européens fréquentaient déjà les marchés marocains. Sebta étaient le principal 3 port commercial du pays. Des relations intenses vont se nouer entre le Maroc et les pays du sud de l’Europe et les échanges s’effectuent essentiellement via les ports méditerranéens de Tanger, Sebta, Melillia. Les importations marocaines se constituaient de produits textiles bruts ou travaillés (drap, toile, coton, fil, etc…). Du Levant (Liban, Syrie...) arrivaient les métaux et le bois de construction. L’exportation concernait les cuirs, maroquins, cotonnades, tapis, blé, cire, chevaux, corail, or et esclave. En 1415, le port de Sebta est pris par les portugais et le circuit commercial va connaitre une désorganisation au point d’être réorienté vers l’Atlantique. Le commerce «triangulaire» voit le jour. Les produits marocains sont échangés contre l’or de Guinée qui prend la direction de Lisbonne. Le commerce marocain passera désormais par les ports atlantiques. Sous les Saadiens, le Maroc va connaitre un renforcement des relations commerciales avec les nations chrétiennes. Les sécheresses et les épidémies amèneront les commerçants marocains à se tourner plus vers l’extérieur, essentiellement vers l’Europe et le Soudan. Plus tard, les relations avec l’Europe vont se compliquer et les rapports commerciaux vont être commandés par des impératifs sécuritaires et religieux si bien que sous l’ère du Sultan Alaouite Ismail, l’achat au français d’armes et de munitions était permis mais leur fournir des céréales et des chevaux étaient considérés comme des actes illicites. Louis XIV ripostera à cette politique du makhzen marocain en interdisant le commerce avec le Maroc par une célèbre ordonnance datant du 24 juillet 1687. Les anglais et les hollandais profitent de l’occasion pour se substituer à la France comme partenaire commercial du Maroc et le fournissent en denrées et marchandises dont il avait besoin. C’est une époque qui se caractérisera par l’esprit du lucre et de l’opportunité économique. Tendance qui triomphera petit à petit sur l’esprit de croisade. C’est ainsi que le Maroc deviendra un intermédiaire privilégié entre l’Europe et l’Afrique Noire. Avec l’Afrique: Le commerce se développera particulièrement avec le Soudan. Fès et Marrakech deviennent des places d’échanges et le point de départ des caravanes vers le grand sud. Le commerce avec l’Afrique sera un commerce de troc. Les commerçants marocains fournissaient les soudanais en marchandises importée d’Europe contre du sucre essentiellement. À partir du 18ème et du 19ème siècle, la philosophie juridique européenne commence à influencer le Maroc qui jusque là était régi par le doit islamique: introduction de concepts juridiques nouveaux dans les différents traités et conventions (ex: le principe de la liberté du commerce et de l’industrie). À partir du 20ème siècle, le droit islamique n’organise plus les relations commerciales non pas qu’il existe des incompatibilités entre ce droit et la réalité du commerce mais cela est dû principalement aux conséquences politiques et économiques de la colonisation française qui va déployer tous les moyens possibles et imaginables pour étendre son hégémonie sur les peuples de la région et les imprégner de sa culture, y compris juridique pour faciliter ses objectifs impérialistes. 4 Définition du droit commercial: Quel rapport avec les autres branches de droit ? Le droit commercial se présente donc comme une discipline particulière qui englobe des matières relevant d’autres branches de droit, comme : Le droit public: qui concerne le droit commercial car l’intervention du pouvoir public dans la vie économique peut être plus ou moins intense à travers notamment les aides de l’Etat. Le droit fiscal: de même que le droit comptable concerne le droit commercial, car ceux qui exercent une activité économique sont soumis à une règle fiscale et comptable. Le droit du travail: concerne, lui aussi, le droit commercial car les salariés ont une place particulière dans l’activité commerciale. Le droit pénal: concerne, à son tour, le droit commercial car le droit pénal des affaires a pour pénalité de sanctionner les différentes infractions commises dans le monde des affaires. Conceptions du droit commercial: Deux conceptions envisageables: objective et subjective: Conception subjective: analyse le droit commercial comme un droit des commerçants plus généralement des professions commerciales indépendamment des actes passés. C’est le droit des professionnels (exercice public, habituel et continu d’une activité commerciale). Elle ne prend en considération que les sujets: acteurs de la vie commerciale. La matière n’est applicable qu’à ceux qui ont la qualité de commerçant (règles particulières et juridictions spécialisées). Conception objective: ignore la qualité des acteurs et ne s’intéresse qu’aux seuls opérations juridiques. Elle fait prévaloir les actes sur les personnes. C’est celle qui analyse le droit commercial sous l’angle de son objet. Le droit commercial est donc réduit au droit des actes de commerce. Droit applicable aux activités de distribution et à la plupart des activités de production, tantôt comme le droit qui applique les techniques du droit civil aux faits économiques. Droit des affaires: branche de droit privé consacré à l’étude des activités commerciales indépendamment de la qualité de ceux qui exercent ces activités qu’elle soit commerçants ou non commerçants. Droit économique dont la définition varie selon les auteurs: Droit des interventions de la puissance publique dans l’économie privée. Droit de l’entreprise: le centre principal est l’entreprise. 5 L’inspiration de cette conception réside dans l’idée qu’on ne puisse pas qualifier les actes en fonction de la qualité des commerçants mais au contraire l’égalité entre les sujets de droit, uploads/Geographie/ droit-commercial-et-de-societes.pdf
Documents similaires



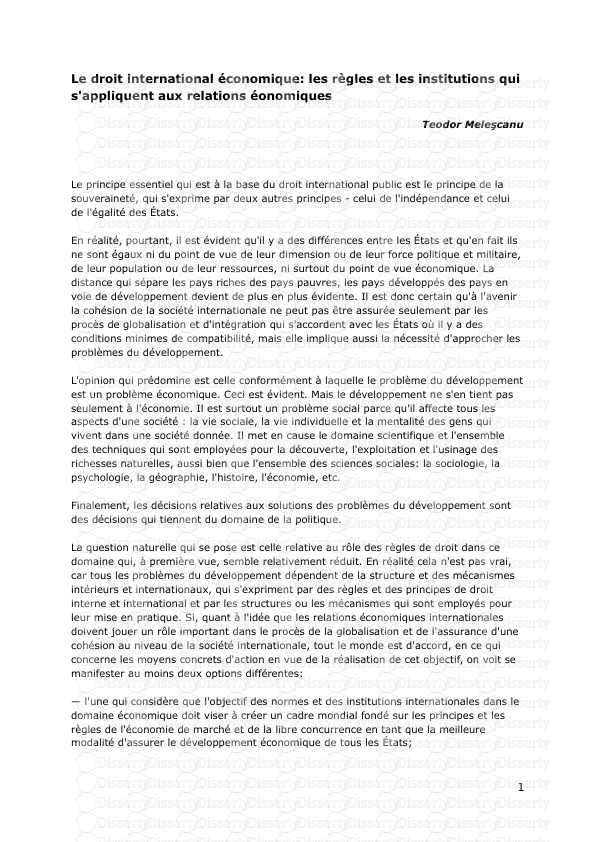






-
91
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 21, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.7766MB


