Revue belge de philologie et d'histoire Roland Barthes ou la multiplication des
Revue belge de philologie et d'histoire Roland Barthes ou la multiplication des paysages de l’Est Ottmar Ette Citer ce document / Cite this document : Ette Ottmar. Roland Barthes ou la multiplication des paysages de l’Est. In: Revue belge de philologie et d'histoire, tome 94, fasc. 3, 2016. Langues et littératures modernes – Moderne Taal- en Letterkunde. pp. 583-595; doi : https://doi.org/10.3406/rbph.2016.8886 https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_2016_num_94_3_8886 Fichier pdf généré le 31/10/2018 Résumé Dans la géographie théorique de Barthes, l’Est joue un rôle essentiel. Qu’il s’agisse de l’Est européen (l’Allemagne d’après-guerre ou la Roumanie communiste) ou de l’Est asiatique (le Japon et la Chine), il s’agit toujours pour Barthes de sortir des sentiers battus, de penser pour le meilleur et pour le pire un vivre ensemble, à la fois social, politique et esthétique. Roland Barthes of de vermenigvuldiging van landschappen uit het Oosten. In de theoretische geografie van Barthes speelt het Oosten een belangrijke rol. Of het nu Oost- Europa betreft (het na-oorlogse Duitsland of communistisch Roemenië) of Oost-Azië (Japan en China), het gaat er Barthes steeds om platgetreden paden te verlaten, een samen-leven te bedenken voor goede en slechte dagen, in sociale, politieke en estethische zin. Abstract Barthes : Multiplication of Eastern Landscapes. In Barthes’ theoretical geography the East has an important role. Whether it be eastern Europe (Germany after the second world war or communist Romania) or eastern Asia (Japan or China), he wants to get off the beaten tracks, imagine a communal life for better or for worse, in a social, political and esthetic sense. Roland Barthes ou la multiplication des paysages de l’Est (1) Ottmar Ette Université de Potsdam 1. Cartographies hexagonales Si on voulait reporter sur une rose des vents les mouvements de voyage, de pensée et d’écriture de Roland Barthes, deux points cardinaux domineraient alors : l’Est et le Sud. Pour comprendre tous les voyages de Roland Barthes, il n’y a pas de texte plus riche en strates et plus porteur d’avenir que l’ensemble des microtextes, publié, la première fois en 1944, sous le titre En Grèce (2). Le premier paysage de la théorie de Roland Barthes ne dispose d’aucun centre, d’aucune perspective centrale et n’a pas de position d’observation définie. Car, non seulement le voyageur, mais aussi les îles mêmes voyagent et sont en constant mouvement. Le premier texte livre en ce sens la clé de l’ensemble des textes : « En Grèce, il y a tant d’îles qu’on ne sait si chacune est le centre ou le bord d’un archipel. C’est aussi le pays des îles voyageuses : on croit retrouver plus loin celle qu’on vient de quitter. » (Barthes : 2002, I, p. 68) Tout dans ce monde insulaire est marqué par de constants déplacements. Les voyages à venir du sémiologue français se développeront dans un archipel de cette nature. Les îles de son écriture sont, d’une part, séparées par des discontinuités qui correspondent entre elles grâce à de longs déplacements, des vols ou d’autres passages et, d’autre part, également reliées entre elles. Chacune de ces îles constitue une île-monde, avec sa logique interne, son histoire particulière, ses formes et normes propres, mais fait aussi partie d’un monde insulaire archipélique ou transarchipélique, dans lequel tous les éléments sont reliés entre eux. Tout est vectoriel et relationnel, se dérobe à toute localisation définitive, puisque les îles elles-mêmes sont en mouvement et que leurs coordonnées se modifient constamment. Ce paysage fractal (3) de la théorie ne peut plus être centré ou fixé par rapport à un sujet. Nous avons affaire à un mobile artistique, dans lequel, non seulement les parties et les objets différents, (1) Texte traduit par Sylvie Mutet. (2) J’avais souligné l’importance de ce texte fondamental pour la pensée et l’écriture de Barthes tout d’abord dans Roland Barthes. Eine intellektuelle Biographie et pour les implications épistémologiques, dans « Zeichenreiche. Insel-Texte und Text-Inseln bei Roland Barthes und Yoko Tawada ». Les références complètes figurent dans la bibliographie finale. (3) Le concept de fractale est utilisé dans le sens que lui a donné son « inventeur » : MANDELBROT, Benoît B. : 1991, Die fraktale Geometrie der Natur, traduit de l’anglais par Dr. Reinhilt Zähle und Dr. Ulrich Zähle. (Basel / Boston / Berlin : Birkhäuser Verlag). Revue Belge de Philologie et d’Histoire / Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 94, 2016, p. 583-595 O. Ette 584 se modifient constamment, mais aussi les positions du sujet. Le jeune Barthes élabore donc, dans les années quarante, de façon anticipatrice, un modèle de pensée et d’écriture qu’il développera et ne fera aboutir, au point de vue épistémologique et pour la théorie des signes et de la culture, que dans les années cinquante, soixante et soixante-dix. Ainsi le sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet, où ce texte a paru la première fois est devenu le lieu d’une écriture qui a tenu Barthes en haleine toute sa vie durant. Le « Sanatorium des étudiants de France » se trouve dans les Alpes près de Grenoble et ainsi tout à fait à l’est de la France. L’Est peut représenter pour Barthes, en raison de sa maladie, un espace d’exil douloureux, un éloignement provisoire d’une carrière universitaire à laquelle il aspirait. Mais l’Est est en France surtout le lieu de l’écriture, auquel le sémiologue français dédie à plusieurs reprises –comme par exemple dans son autobiographie expérimentale Roland Barthes par Roland Barthes– d’importants passages. La montagne magique de Barthes se situe à l’est de la France. 2. Cartographies européennes Sous le titre « Rencontre en Forêt-Noire », Barthes rapporte pour les lecteurs français de France-Observateur une rencontre entre écrivains français et allemands, qui a eu lieu à Bad-Griesbach du 8 au 12 janvier 1955, et qui s’inscrit dans un contexte politique soucieux de transformer, aux niveaux les plus divers, les relations franco-allemandes en un vivre ensemble empreint de respect mutuel et d’amitié. Cette rencontre, organisée par la revue Documents –importante revue pour les relations franco-allemandes– et coordonnée par René Wintzen, renouaient avec les célèbres rencontres franco-allemandes d’écrivains qui dans l’entre-deux-guerres avaient sensiblement ouvert la voie pour une vie en commun, une convivence à la fin de la guerre. Le rôle hors- norme de l’écrivain, pour la construction d’une Europe à venir sous le signe de la convivence, montre ce que des projets littéraires peuvent provoquer (Kraume : 2010). Barthes sait que la rencontre de Bad-Griesbach se situe dans cette tradition. Pour le côté allemand, des auteurs comme Alfred Andersch, Heinrich Böll, Walter Jens ou Wolfgang Köppen y participèrent ; pour le côté français, on trouvait, à côté de Roland Barthes, par exemple, Jean Cayrol, Bernard Dort ou Alain Robbe-Grillet, réunis autour du thème « Le roman et son public ». Barthes restera après cette rencontre en contact avec certains participants français pour de créatifs échanges. Dans son rapport, Barthes liste d’abord les écrivains allemands et se demande à chaque fois ce que « nous », représentants de la France pouvions apprendre à Bad-Griesbach de ces auteurs. Ainsi Walter Höllerer « nous » a parlé des nouveaux mythes de la société allemande d’après-guerre, Walter Jens d’une différenciation entre deux types de romans et « nous » avons entendu avec plaisir les remarques de Paul Schallück sur les bibliothèques qui se trouvaient dans les usines allemandes. Mais « nous » avons surtout pu apprendre que les « craintes, embarras et espoirs de la Littérature étaient exactement les mêmes de chaque côté du Rhin » (Barthes : 2002, I, p. 537). Lors de tous ces échanges sur des thèmes ciblés, le plus important a été de « connaître des visages, des styles d’être et de parler, une manière d’affronter Roland Barthes ou la multiplication des paysages de l’Est 585 la Littérature » (Ibidem), en quelque sorte de ressentir la triple « contradiction entre amitié, langage et idée » (Ibidem). Ce texte qui semble tout d’abord un texte journalistique est, à la fois, typique et atypique pour Barthes. Atypique dans le sens où cet article est plutôt un rapport, qui ne propose pas de nouvelles catégories ou, même, de néologismes qui serviraient à une meilleure compréhension des rapports franco-allemands ; typique cependant par la présence constante de la question du « Comment vivre ensemble », à laquelle Barthes devait plus tard dédier son premier cours au Collège de France (Barthes : 2002a). L’Est (dans ce cas l’ouest de l’Allemagne) correspond ici à la nécessité de développer de nouvelles formes et normes pour une future convivence franco-allemande et européenne. En Forêt-Noire, dans le Sud-ouest non pas de la France mais de l’Allemagne, et donc dans cet article paru le 27 janvier 1955 de France-Observateur, apparaît selon une perspective française un Est lourdement chargé de conflits, qui symbolise les affrontements guerriers accumulés sur plusieurs siècles. Alors que les écrivains français qui venaient tous de Paris étaient liés, malgré des discordes internes, par une « Littérature institutionnalisée depuis des siècles », parmi les écrivains allemands venus à cette rencontre de villes très différentes, on ne put entendre aucune contradiction, même si « le poids d’une parole solitaire, rompue de la tradition par un cataclysme uploads/Geographie/ ette-ottmar-roland-barthes-ou-la-multiplication-des-paysages-de-l-x27-est-in-revue-belge-de-philologie-et-d-x27-histoire-tome.pdf
Documents similaires







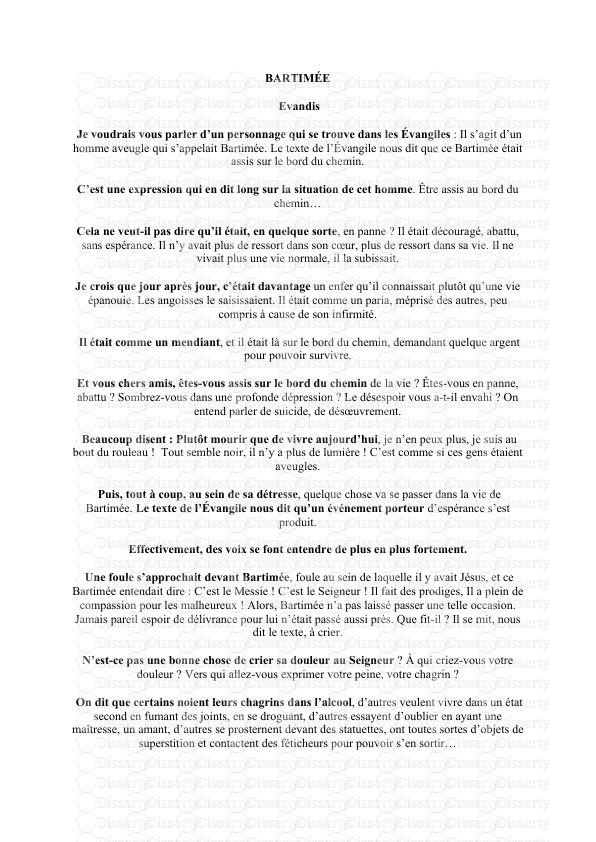


-
97
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 08, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2127MB


