« DES CIELS COULEUR DE SOMMEIL » : LE PAYSAGE DANS LES PREMIERS ROMANS DE MIRBE
« DES CIELS COULEUR DE SOMMEIL » : LE PAYSAGE DANS LES PREMIERS ROMANS DE MIRBEAU Une écriture qui tend à dévoiler le mystère du réel passe, presque tout naturellement, par une interrogation du paysage, car c’est peut-être dans la saisie scripturale de cet élément que se joue la difficulté initiale de la transcription du réel ; elle constitue pour ainsi dire le seuil d’une poétique du roman qui, pour le premier Mirbeau, prend la forme d’un imaginaire fortement ancré dans la terre. Dans ces romans —Le Calvaire (1886), L’Abbé Jules (1888), Sébastien Roch (1890), la terre, devenue nature, articule une approche du réel, doublée du dessein explicite du romancier d’en dévoiler le mystère : « Certes, j’étais, je le suis toujours, sensible à la beauté de la forme mais, sous la forme, si belle qu’elle fut je cherchais l’idée substantielle, l’explication de mes inquiétudes, de mes ignorances, de mes révoltes en germe. Je cherchais la raison évidente de la vie, et le pourquoi de la nature » (SR, 276). La nature — dans son versant paysager— constitue donc, le substrat de l’œuvre mirbellienne et s’érige en fondement esthétique de l’artiste, qui fait passer dans ses romans la doctrine naturaliste par le philtre de la subjectivité. Les problèmes que pose la représentation de la nature se font particulièrement évidents dans la description des paysages au deuxième degré — la nature dans les tableaux —, motif que développe Dans le ciel, roman qui répond à certaines des questions posées dans sa trilogie autobiographique et dans lequel Mirbeau (1848-1917) lance le mot d’ordre de sa poétique : Voir, sentir, comprendre, poétique qui montre bien la particularité du naturalisme mirbellien et qui décide, en quelque sorte, de « l’échec » du roman, dans la mesure où elle cible le désir de l’auteur plutôt qu’un objet. Ceci se traduit par des personnages désespérément appropriés à saisir l’invisible, l’impalpable, l’irrévélé, le mystère. Le personnage de Lucien du roman Dans le ciel (1892-1893) est révélateur de cet échec, car le peintre, « représentant » mieux doté en théorie que l’écrivain, s’obstine inutilement à poursuivre un but inaccessible : « Eh bien ! c’est cet invisible passage [de la lumière] que le peintre, pour arriver à une harmonie approximative, et nécessaire, doit voir et reconstituer sur sa toile » (DC, 91-92). Le passage d’une tonalité lumineuse à une autre ou l’aboi du chien, pour le peintre, l’odeur de la terre ou le lent écoulement des nuages, pour le romancier, illustrent très exactement ce vertige de l’abîme (DC, 26) que suppose la transcription du réel. Mais si le cumul des parties n’aboutit pas à la description de l’ensemble, la nature reste tout de même une source d’émotions que le romancier tente de transmettre à son lecteur : « C’est que la nature, pour qui sait la voir et la comprendre est une étrange magicienne, perpétuelle créatrice de rêve, une infatigable renouveuleuse d’idéal. Tout est en elle, car elle est la Beauté en dehors de quoi nous ne pouvons rien concevoir, la source interne où nous pouvons puiser, à pleine âme, les fortes émotions1 ». 1 In Correspondance de Camille Pissarro, t. 2 (1886-1890), Éditions Valhermeil, 1986, Paris, p. 199. En ce qui concerne le paysage au premier degré, celui des romans de Mirbeau est fortement lié à la terre, au terroir, s’en tenant à la réduction traditionnelle du paysage à la campagne, campagne aussi bien sauvage que cultivée. Au moment de la contemplation d’un paysage, la ville est toujours derrière l’observateur, qui plaque parfois le modèle architectural urbain sur un paysage, dont la perception se voit ainsi transformée par l’expérience de la ville qui demeure, ce nonobstant, un vide lourd de significations. Le paysage urbain est donc pratiquement invisible, constitué uniquement de quelques rues et de quelques ruelles, où déambulent les personnages, et de façades plantées comme des décors de la dissimulation et de l’hypocrisie. Cette absence n’est pas simple nostalgie ruraliste, mais plutôt la forme vide d’un arrachement de la sensibilité, de la connaissance ou de l’identité des personnages. Étant donné que Mirbeau aime surtout les paysages qui surgissent, la ville, présentée tabulairement, comme un tassement ou agrégat de maisons, n’est donc jamais concernée : Paris est presque invisible dans Le Calvaire ou Dans le ciel, de même qu’aucun renseignement n’est fourni à propos des bourgades des Roch ou de la petite ville où Jules Dervelle exerce son ministère. Censée jouer un rôle important dans la formation de certains personnages, la capitale n’est désignée qu’en creux, comme pour mieux figurer le silence douloureux du passage de l’enfance à la maturité ; elle n’est évoquée qu’en tant que renversement de la nature (C, 45). J’essaierai donc d’aborder ici, dans un premier temps, les caractéristiques du paysage campagnard, où se côtoient, et parfois se fondent, une fausse nature (cultivée) et une nature libre (forêts, bois, landes, plages), paysage où sont néanmoins intégrées les bourgades de l’enfance (Saint-Michel, Viantais, Pervenchères), car leurs dimensions, contrairement à la grande ville, leur permettent de s’insérer dans un ensemble rural plus vaste. Récurrents, ces paysages agrestes vont donc se déployer sous deux grandes modalités en forte interaction : paysages perçus et paysages imaginés, tous deux sous-tendus par une réflexion sur le mode de transposition dans la peinture soutenue par les personnages peintres de ces premiers romans. Signalons tout d’abord que le paysage mirbellien apparaît souvent dans le cadre perceptif formel de l’embrasure d’une fenêtre, de la vitre d’une calèche ou d’un train. Je n’insisterai pas sur le rapport du paysage au regard, longuement étudié, ni sur les conventions qui en font un genre codifié et un stéréotype culturel, j’aborderai plutôt les modalités d’une composition où se répètent similitudes de plans et lignes de force, que le paysage soit fixe (saisi par un observateur immobile), ou qu’il soit traversé (saisi par un observateur qui se déplace). Mais que l’observateur soit fixe ou qu’il se déplace, c’est toujours le regard du spectateur qui fait émerger le paysage et le présente sous la couleur sentimentale du moment de l’observation : « Un paysage — peut-on lire dans Dans le ciel — c’est un état de ton esprit, comme la colère, comme l’amour, comme le désespoir... » (DC, 92). Le rendu panoramique est donc soumis aux avatars du temps et du moment du regard. Les paysages perçus sont généralement ceux d’une immensité (plaine, mer, lande) saisie dans un regard panoramique, qui y opère une sorte de quadrillage géométrique : bien sûr des lignes verticales (arbres, taillis, clochers, pie), des lignes courbes (ondulations des rivières, routes, coteaux), des ovales (peupliers), des cercles (pommiers), des points (oiseaux, hommes, habitat rural dans le lointain), mais surtout une division symétrique : une route, une allée, une rivière posent d’emblée un rapport de latéralité renforçant la focalisation de l’observateur, dont les approches ne sauraient être que fragmentaires et juxtaposées (tantôt... tantôt ; par endroits... par endroits). Mais ouverts ou partiellement fermés quand le regard bute sur un élément qui s’élève comme une frontière, une démarcation, une limite (souvent des forêts), le dernier élément désigné dans ces paysages est souvent le ciel, élément qui accorde des valeurs changeantes à l’espace contemplé et lui offre un prolongement symbolique dans son rendu dioramique. Espace de mouvements et de transformations (les nuages y passent, bougent, se transforment, il est incessamment traversé de vols d’oiseaux), le ciel ferme, pour ainsi dire, les paysages comme un écran sur lequel se projetteraient, et le regard des personnages et leurs actes. À ce titre, il semblerait qu’il n’est plus un simple élément du paysage, mais qu’il le réverbère, ce que le niveau rhétorique du texte se charge de souligner : « Malgré lui, l’impure obsession de la femme revenait, s’associait à sa honte, et, avec un involontaire tressaillement de ses muscles, avec une vibration suprême de ses moelles, il la retrouvait en lui, autour de lui, jusque dans l’opacité de l’ombre, jusque dans le symbolisme errant du ciel, où les nuages évoquaient d’impossibles nudités, d’impossibles enlacements, une multitude de figures onaniques et tordues, semblables aux gravures démesurément agrandies d’un livre obscène, qu’il avait eu jadis, au collège » (AJ, 94). Le ciel comme au-delà vertical du paysage retrouve son homologue horizontal dans une « terrible ligne d’horizon » (C, 72), derrière laquelle disparaît toute chose, un horizon qui s’élargit, qui recule au fur et à mesure que l’on avance, que l’on ne peut ni franchir, ni conquérir. En rapport avec l’ailleurs (le ciel) ou avec l’infini (l’horizon), le paysage est bien souvent le lieu de l’absolu, d’où l’homme est exclu, ou bien où il n’est métonymiquement présent que par des objets (chaloupe, habitat) : « […] je fus posté en sentinelle, tout près de la route, à l’entrée d’un boqueteau, d’où je découvrais la plaine, immense et rase comme une mer. De-ci, de-là, des petits bois émergeaient de l’océan de terre, semblables à des îles, des clochers de village, des fermes estompées par la brume, prenaient l’aspect de voiles lointaines. […] Le cœur serré, j’interrogeais l’horizon […] je ne voyais rien, uploads/Geographie/ lola-bermudez-quot-des-ciels-couleur-de-sommeil-quot-le-paysage-dans-les-premiers-romans-de-mirbeau.pdf
Documents similaires







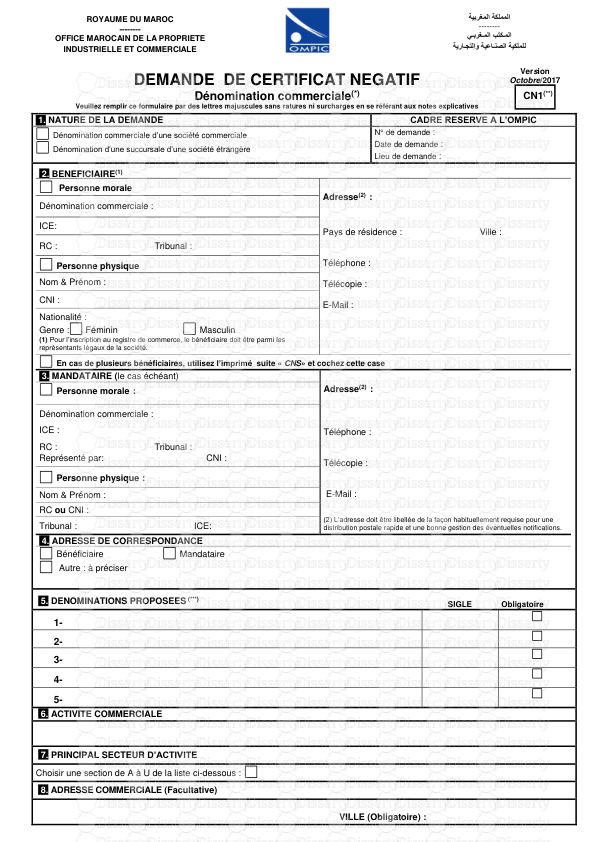


-
45
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 12, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1347MB


