7/10/2020 Migrations utopiques et révolutions silencieuses néorurales depuis le
7/10/2020 Migrations utopiques et révolutions silencieuses néorurales depuis les années 1960 https://journals.openedition.org/chrhc/5597 1/14 Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique 133 | 2016 Partir en communauté DOSSIER Migrations utopiques et révolutions silencieuses néorurales depuis les années 1960 Cʃʖʊʇʔʋʐʇ Rʑʗʘʋʶʔʇ p. 127-146 https://doi.org/10.4000/chrhc.5597 Résumé À partir des années 1960, suivant les mouvements contre-culturels partis des États-Unis avant de gagner l’Europe, des vagues successives de populations fuient les villes pour retourner à la terre dans les espaces désertifiés du territoire français disqualifiés par la société capitaliste, industrielle et urbaine, afin d’y vivre totalement ou partiellement d’une activité agricole. Ces « néoruraux », venus contrecarrer un exode rural plus que séculaire, sont les initiateurs d’un mouvement migratoire continu de la ville vers la campagne, qui connaît aujourd’hui, sous un double visage (« pirate » et « citoyen »), une ampleur numérique et géographique renouvelée. En stimulant l’arrivée d’autres catégories de populations néorurales au sens large, ils entraînent un « retournement » du territoire qui rend attractifs des espaces isolés et éloignés jadis répulsifs, réduisant ainsi la « diagonale du vide ». Depuis les années 1990, au terme d’un long et difficile processus d’intégration au sein de la population locale, ils ont accompli, avec les éléments les plus actifs de celle-ci, une véritable « révolution silencieuse » multidimensionnelle en matière de développement local, donnant naissance à de nouvelles campagnes, innovantes, socialement et culturellement recomposées. Entrées d’index Mots-clés: partir, communauté, migration, utopie, néoruraux, agriculture, écologie, autarcie, intégration Keywords: partir, communauté, migration, utopie, néoruraux, agriculture, écologie, autarcie, intégration Géographie: France 7/10/2020 Migrations utopiques et révolutions silencieuses néorurales depuis les années 1960 https://journals.openedition.org/chrhc/5597 2/14 Chronologie: XXe siècle Schlagwortindex: partir, communauté, migration, utopie, néoruraux, agriculture, écologie, autarcie, intégration Palabras claves: partir, communauté, migration, utopie, néoruraux, agriculture, écologie, autarcie, intégration Texte intégral Des arrivées en vagues successives bien différenciées mais animées de préoccupations communes Précédées, au début des années soixante, par quelques précurseurs isolés qui contestent les dégâts causés par la société capitaliste et urbaine sur l’être humain et sur la nature, tel Pierre Rabhi, arrivé en Ardèche en 1961, l’implantation néorurale1 s’effectue surtout après Mai 68. Elle se décompose en cinq vagues successives, aux profils et projets différenciés2. 1 La première est composée des « hippies » ou « vrais marginaux », arrivés parfois un peu avant Mai 68 (1967 à Rochebesse en Ardèche et Le Courtal en Ariège), mais essentiellement après (1969-1973). Elle marque le plus les populations et les médias, par son refus global du système et sa recherche d’une autarcie maximale. C’est le temps des communautés, culminant en France entre 300 et 500 de 1971 à 1973, soit 5 000 à 10 000 communards l’hiver, et 30 000 à 50 000 l’été, période d’intense circulation3.Elles s’implantent de manière sélective dans les angles morts du développement accéléré des Trente Glorieuses, c’est-à-dire essentiellement les zones de moyenne montagne du sud de la France : bordure sud-est du Massif central où se trouve la zone de plus forte densité néorurale (notamment en Cévennes), Pyrénées4 et Alpes-de-Haute-Provence autour de Forcalquier. Cependant, certaines parties des Vosges, du Jura et des Alpes, ainsi que de Bretagne, sont aussi concernées. L’Ardèche, département le plus précocement et massivement concerné, compte une quinzaine de communautés, libertaires, révolutionnaires, mystiques ou hippies, situées surtout au sud-ouest du département, dans la zone des pentes (Cévennes, Boutières) et beaucoup moins dans celles de plateau (Montagne, Bas-Vivarais) ou dans le Haut-Vivarais. Cette première vague, qui stimule les suivantes, est motivée, selon les cas, par le refus des contraintes imposées par la société libérale, industrielle et urbaine, par le militantisme écologiste et antinucléaire ou encore par le combat révolutionnaire. Elle porte un projet de refondation de la société et de l’économie capitalistes par l’exemplarité, nourri de l’opposition aux guerres coloniales et des revendications politiques déçues au lendemain de Mai 68. 2 La grande majorité des néoruraux5 appartient à la deuxième vague, celle des « néoruraux » proprement dits, arrivée entre 1975 et 1985 et qui inclut aussi une partie de ceux de la première vague en reconversion, ainsi que des enfants de paysans revenus sur l’exploitation de leurs parents dans le sillage des néoruraux post-soixante-huitards. Plutôt que bâtir les fondements d’une société et d’un homme nouveaux, ses membres recherchent un revenu, une certaine intégration sociale et un mode de vie plus sain et convivial, proche de la nature. Ce « déplacement de l’utopie6 », de la première à la deuxième vague, observé en 1979 par les sociologues Bertrand Hervieu et Danièle Léger, correspond à la fin de la croissance économique ainsi qu’à la naissance de l’écologie politique, symbolisée en 1974 par la candidature de René Dumont à l’élection présidentielle. Il véhicule une nouvelle représentation du sens de la vie, qui remplace la croyance dans le progrès sans fin générateur de bonheur pour l’humanité et se diffuse alors par capillarité dans une partie de plus en plus large du corps social. 3 Ces deux premières vagues ouvrent la voie aux deux suivantes, qui s’en différencient cependant par leur composition sociale et leurs motivations. En effet, à un moment où 4 7/10/2020 Migrations utopiques et révolutions silencieuses néorurales depuis les années 1960 https://journals.openedition.org/chrhc/5597 3/14 l’urbanité a gagné la campagne, elles optent, par choix ou par défaut, pour celle-ci, non plus en raison du genre de vie qu’elle autorise mais du cadre de vie qu’elle offre. Cette différence ne crée toutefois pas de cloisonnements. En effet, les néoruraux de la troisièmevague (1985-1995), venus exercer leur profession à la campagne, partagent souvent des affinités culturelles avec leurs devanciers qui, par ailleurs, utilisent leurs réseaux pour venir en aide à ceux de la quatrième vague (1995-2005), espérant vivre moins durement en milieu rural leur grande précarité économique. Enfin, les années autour de 2005 voient arriver une cinquième vague, mouvement de fond transcendant les catégories sociales, qui représente 30 % des installations agricoles, soit deux fois plus qu’il y a dix ans. Son visage est double. D’abord, celui des « nouveaux autarciques »7 appartenant à la mouvance libertaire, radicale, altermondialiste et écologiste et qui inclut tous les « nouveaux mouvements sociaux ». Ses membres s’installent, de manière subie ou choisie, hors de tout cadre réglementaire, dans des tipis, yourtes ou cabanes8. Ils renouent ainsi avec une démarche politique porteuse d’un projet de société proche de l’utopie communautaire post-soixante-huitarde. Confrontés à la politique de « décabanisation » (destruction des cabanes) des pouvoirs publics, ils sont souvent en conflit avec les édiles et diversement accueillis par les habitants, selon une ligne de clivage qui ne recoupe pas forcément la distinction entre néoruraux et autochtones, même si les premiers les soutiennent majoritairement9. Parallèlement à ce « retour à la terre » sur le mode « pirate », grossit un courant « civique ». Celui-ci rassemble des citoyens autour de la transition écologique et s’illustre chez les néopaysans qui donnent à leurs gestes une portée politique, en montrant qu’il est possible de changer de vie afin de se mettre en accord avec ses valeurs et de reconquérir du pouvoir sur sa vie (empowerment) tout en transformant sa ferme en enjeux d’intérêt général (emploi, aménagement du territoire)10. 5 Au-delà du caractère nécessairement simplificateur de cette typologie, la migration néorurale s’est donc complexifiée depuis les années 1960, sur les plans spatial et social. En effet, elle concerne un nombre croissant de communes et de profils répertoriés de manière imagée par les nouveaux habitants : 6 « archéos » ou « paléos » (autochtones) ; « néolithiques » (néoruraux post-1968) ; « néo-néos » (3e et 4e vagues) ; « alters » ou « réfugiés de la décroissance » et acteurs de la transition écologique (5e et dernière vague)11. À l’instar de leurs aînés, les néoruraux de la cinquième vague fuient la ville et son mode de vie « hors sol », veulent prendre ou reprendre en main leur vie, penser et agir par eux-mêmes (cf. Do it de Jerry Rubin, 1973) au lieu d’obéir aux injonctions venues d’en haut. Ils veulent aussi mettre en cohérence leurs valeurs avec leurs actes, retrouver un sens à leur existence (nourrir les gens avec des produits sains) et une créativité au travail. Ils affichent une sensibilité aux valeurs écologiques et féministes, ainsi qu’un intérêt pour le développement personnel et spirituel. Avec eux, ils partagent le même projet de changer le monde par le bas, expression du discrédit porté sur la capacité de l’action collective à transformer radicalement le monde, depuis les désillusions révolutionnaires de Mai 68. Néanmoins, aujourd’hui, leur volonté de s’engager autrement est, du moins pour ce qui est du courant civique majoritaire, moins idéologique que celle des post-soixante-huitards et davantage centrée sur des « utopies concrètes » d’échelle locale ou micro-locale (permaculture, agroécologie, circuits courts, systèmes d’échanges locaux)12. Leur rapport à l’écologie met en avant le souhait de se sentir utile en produisant d’une manière respectueuse pour la terre et les hommes (63 % des néopaysans non issus du milieu agricole s’orientent vers l’agriculture biologique et 58 % vers les circuits courts) et de recréer une agriculture (les 13 000 installations en 2015 étant loin de uploads/Geographie/ migrations-utopiques-et-revolutions-silencieuses-neorurales-depuis-les-annees-1960 1 .pdf
Documents similaires








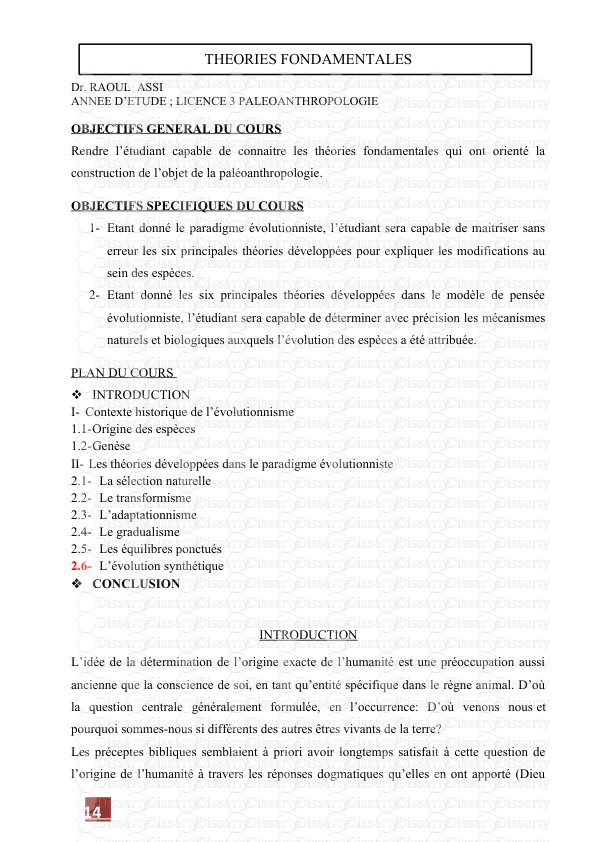

-
56
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 06, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.5007MB


