T42 + T45 : Eléments de correction des exercices proposés en TD. TD1 : Granulom
T42 + T45 : Eléments de correction des exercices proposés en TD. TD1 : Granulométrie Pas de correction supplémentaire proposée : exercice intégralement traité en TD TD2 : Sédimentation marine Exercice proposé : Les caractéristiques d’un exemple de « série rythmique » Exercice intégralement traité en TD. Ci-dessous : la rédaction de la correction Eléments de réflexion : 1. La vaste extension géographique des alternances calcaires-marnes, ainsi que le fait de pouvoir suivre les strates sur de grandes distances exclut une origine gravitaire pour ce type de dépôt. 2. Les fluctuations des teneurs en CaCO3 sont progressives. Cela signifie que la limite strate calcaire – strate marneuse ne correspond pas à une modification brutale, mais plutôt à des changements progressifs. Dans les carottages des sédiments océaniques récents, de telles fluctuations progressives sont bien connues et trois causes sont alors envisagées : différences dans la productivité primaire, dilution de la teneur en CaCO3 par une phase détritique plus importante, ou encore dissolution sélective des organismes calcaires. 3. Les strates calcaires et les strates marneuses ne sont génétiquement liées. Leurs épaisseurs évoluent différemment au cours du temps. La figure d montre en particulier, outre une rupture en milieu de série se situant au même interbanc, des évolutions indépendantes de part et d’autre de cette coupure. Ces observations excluent l’hypothèse d’un dépôt unitaire d’un couple strate calcaire-strate marneuse, par exemple sous l’effet d’un courant de turbidité. 4. L’absence de granoclassement confirme que ces dépôts ne résultent pas d’un dépôt de type turbide. Le fait de trouver des lamines plaide en faveur d’une isotropie qui existait déjà au moment des dépôts. 5. La répartition différente des restes d’organismes planctoniques et benthiques indique que le passage d’une strate calcaire à une strate marneuse reflète une variation du paléoenvironnement océanique. Par ailleurs, le bon état de préservation de ces organismes exclut tout phénomène de dissolution près de l’interface eau-sédiment. 6. Strates calcaires et marneuses sont très nettement séparables par les rapports isotopiques du carbone et de l’oxygène. Cela prouve que l’alternance lithologique est étroitement calquée sur une rythmicité ayant affecté le milieu de dépôt. Parmi les facteurs capables d’agir sur les rapports isotopiques, les principaux sont la température des eaux, la salinité et la circulation océanique. 7. Les analyses des minéraux argileux indiquent que la nature de ces minéraux, ainsi que leurs proportions réciproques, varient de façon oscillante parallèlement au contenu carbonaté. Par leur assemblage à caractère essentiellement détritique (illite, kaolinite, chlorite), il est possible d’exclure une origine diagénétique pour ces minéraux. Des variations de sources d’apport qui déterminent la nature et la proportion des minéraux argileux est vraisemblable. Une autre différence significative est la présence, dans la fraction argileuse, de quartz dans les strates calcaires et son absence dans les strates marneuses. On est donc conduit à envisager des pulsations climatiques qui règlent la qualité et la quantité des minéraux détritiques fins en provenance des continents adjacents. 8. L’étude sur la répartition des ammonites entre les strates calcaires et marneuses conclut à des variations sous la dépendance du facteur climatique. Cependant, cette étude souligne l’importance d’autres facteurs tels que les variations du niveau marin, qui peuvent également être sous le contrôle de la tectonique et qui conditionnent l’augmentation ou la diminution des niches écologiques au niveau des mers épicontinentales et conduisent à des compétitions écologiques entre les divers taxons. La fréquente répétition de ces alternances plaide en défaveur de l’origine tectonique. 9. La durée de 20 000 ans correspond à la durée de la précession pour les paramètres orbitaux de la Terre (cycle de Milankovitch) Synthèse possible : Toutes les données acquises convergent vers une origine climatique pour les variations qui induisent des compositions différentes, mais progressives et répétitives, des strates calcaires et marneuses. L’origine de ces variations climatiques, dont la périodicité serait proche de 20 000 ans, pourrait être mise en rapport avec des cycles astronomiques et en particulier la précession des équinoxes. On voit bien que le passage d’une strate calcaire à une strate marneuse, bien que marquée sur le terrain, traduit des seuils de composition progressifs et accentués par la diagenèse. CM3 : Mise en place des roches sédimentaires Exercice proposé en fin de cours : voir TD 3 : exercice n° 3 TD3 : Milieux anciens de sédimentation Exercice n° 1 : Coupe d’une série récifale Le récif montre un cœur calcaire d’origine lagunaire entouré de faciès construits. Sur les flancs du récif, on trouve des brèches issues de la destruction du récif construit. Exercice n° 2 : Faciès géochimique des calcaires 1. Oxfordien Ardennes: oolitique 2. Frasnien rouge de Givet: récifal 3. Lutétien Banc royal : à Foraminifères benthiques 4. Beauce : lacustre Exercice n° 3 : Altération d’un granite 1°) Bilan géochimique : Bilan Gain : + Perte : - Bilan global Horizons comparés 4-3 3-2 2-1 4-1 SIO2 - 8 - 11.3 - 24.6 - 43.9 Al2O3 + 5.8 + 5.7 + 11.7 + 23.2 Fe2O3 + 4.5 0 - 1.3 + 3.2 MgO 0 - 0.2 - 1.9 - 2.5 CaO - 0.3 - 0.6 - 1.6 - 2.5 Na2O - 1.0 - 2.4 - 6.2 - 9.0 K2O - 1.3 - 3.2 - 4.5 - 9.3 TiO 0 0 0 0 H2O (perte au feu) + 4.8 + 5 + 9.6 + 19.6 2°) Comportement des différents éléments : Une partie de la silice, les éléments alcalins (Na, K) et calco-alcalins (Ca, Mg) sont entraînés. L’évolution du fer et de l’aluminium montrent des phénomènes de concentration à partir d’apports extérieurs. La roche devient plus hydratée. 3°) Synthèse sur l’altération : Les éléments libérés proviennent de l’hydrolyse des silicates, principalement des plagioclases (Na, Ca), de l’orthose (K), de la biotite (K, Fe). Le quartz apparaît peu altéré. Le fer et l’aluminium, libérés par hydrolyse, sont retenus dans les nouveaux minéraux dont l’abondance augmente. Une partie de l’aluminium forme, en association avec de la silice, de la kaolinite. L’excès d’aluminium, dans les niveaux les plus altérés, donne naissance à un hydroxyde : la gibbsite. Le fer est également piégé sous forme d’hydroxyde hydraté : la goethite. Exercice n° 4 : Les effets de l’écoulement d’un cours d’eau. 1°) Nature des formations et phénomènes géodynamiques : Rive convexe : présence d’une grande quantité d’alluvions, aussi bien anciennes qu’actuelles Phénomène géodynamique : sédimentation Rive concave : pas d’alluvions anciennes et très peu d’alluvions récentes Phénomène géodynamique : érosion 2°) Hypothèse : Hypothèse : vitesse du courant et turbulence de l’eau différente entre les deux rives. 3°) Mesures possibles pour vérifier l’hypothèse : Mesure des vitesses des courants sur rive convexe et rive concave (faible côté convexe, forte côté concave) Mesure de la profondeur de la vallée creusée par le cours d’eau (faible côté convexe, forte côté concave) Exercice n° 5 : Reconstitution d’événements géologiques. - dépôt du calcaire inférieur dans les eaux d’un lac - comblement du lac ou assèchement du lac - dissolution du sommet du calcaire : érosion différentielle - dépôt de sables transportés par le vent + installation d’un sol - dépôt d’un calcaire et de sable marin (bord de plage) - émersion - installation du sol actuel et de la végétation Exercice n° 6 : Les séries secondaires du Bassin Parisien. 1°) Colonne stratigraphique au 10 000 e des séries secondaires et l’échelle des temps absolus Il s’agit d’effectuer le report à l’échelle du 10 000e, sur une verticale, de la coupe prise en exemple. On veillera à utiliser les mêmes figurés et à suggérer, par le dessin, la dureté respective des différentes formations. (Exemple de colonne montré en TD) 2°) Milieux de sédimentation successifs évoqués par les lithofaciès du Trias Niveau 1 : le milieu est continental, les grès à plantes l’indiquent. Les conglomérats indiquent un régime hydrographique puissant de type torrentiel. Les teintes vives indiquent un climat de type désertique. Des zones lacustres voire lagunaires saumâtres sont vraisemblables étant donné la faune rencontrée. Niveau 2 : Le milieu est marin, côtier et peu profond. Niveau 3 : Le milieu est lagunaire et caractérisé par le dépôt d’évaporites. Le régime marin est ensuite restauré ; des faciès récifaux indiquent un milieu agité, en eaux chaudes peu profondes. Niveau 4 : Le milieu est marin, peu profond, ouvert sur la haute mer, l’abondance des formes fossiles l’indique. Niveau 5 : Le milieu est de nouveau continental. Les végétaux flottés abondants forment des lignites. Niveau 6 : Le milieu est lagunaire avec dépôts d’évaporites. Il est parfois continental, les grès à végétaux l’indiquent. Niveau 7 : Le milieu est marin, peu profond, littoral. 3°) Changement paléogéographique important dans le Bassin de Paris à partir du Rhétien La sédimentation, quoique toujours peu profonde, est désormais franchement marine à partir du Rhétien. 4°) Les lithofaciès du Lias ne sont pas considérés comme des stratotypes. Comme les lithofaciès restent toujours caractéristiques de milieux peu profonds et comme rien ne permet d’affirmer la continuité de sédimentation, on ne peut considérer les lithofaciès du Lias comme des stratotypes : les faciès du Lias sont très variés et sujets à des variations latérales uploads/Geographie/ tdcorrection.pdf
Documents similaires
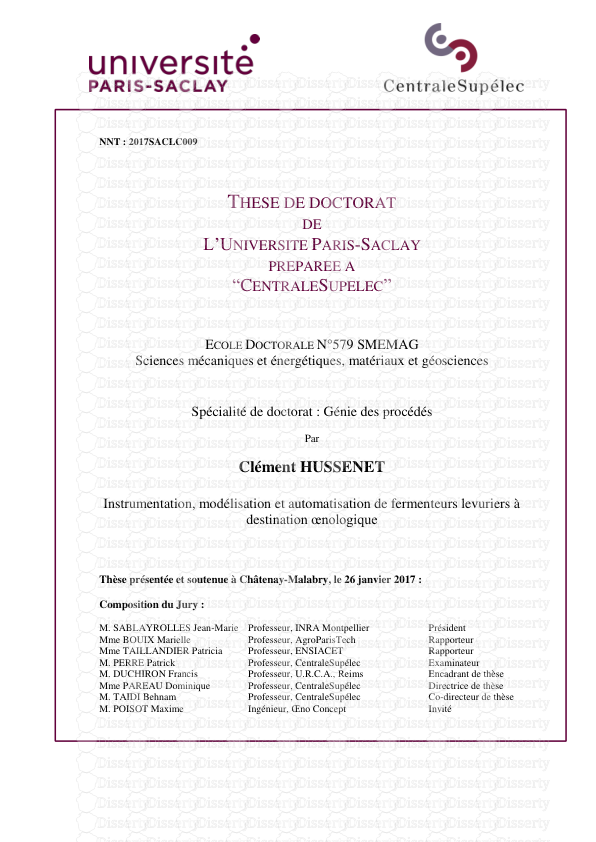









-
35
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 09, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 1.6070MB


