REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUP
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHESCIENTIFIQUE N° D'ORDRE: SERIE: FACULTÉ DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR DÉPARTEMENT DE CHIMIE INDUSTRIELLE THÈSE En vue de l'obtention DU DOCTORAT EN SCIENCES EN GENIE DES PROCEDES Par ARRIS Sihem Epouse CHEBIRA - Jury - Mr A.H. MENIAI Professeur, Université de Constantine Président Mr. M. BENCHEIKH – Professeur, Université de Constantine Rapporteur LEHOCINE Mr M. OMARI Professeur, Université de Biskra Examinateur Mr. D. BARKAT Professeur, Université de Biskra Examinateur Mr M. BOUHELASSA M.C, Université de Constantine Examinateur ………/………./2008 Etude Expérimentale de l’Elimination des Polluants Organiques et Inorganiques par Adsorption sur des Sous Produits de Céréales Dédicace Après de longues années ce modeste manuscrit voit enfin le jour. Je le dédie à l’âme de mon père, et à deux personnes qui m’ont très chers ; ma mère qui n’a jamais cesser de me soutenir et de m’encourager et mon autre moitié ; mon mari qui est toujours à mes côtés qui a su enrichir ce qui était en moi et qui a fait naître et nourrir de nouvelles valeurs de la vie de mon moi profond. Et je ne pourrai oublier les deux prunelles de mes yeux, mes adorables filles rayhana et raouh qui savaient toujours m’épanouir avec leurs petits sourires. Et enfin je le dédie à toute la famille ARRIS et CHEBIRA, et que ce manuscrit soit utile pour tous ceux qui en auront besoin. Remerciements Avant tout, je dois remercier Dieu le tout puissant qui m‘a donné l‘envie et la force pour mener à terme ce travail. ; Je tiens à remercier très sincèrement le Professeur BENCHEIKH LEHOCINE M. de l‘université Mentouri de Constantine, mon encadreur et directeur de thèse. Ce fut un grand plaisir de travailler avec lui, durant la préparation du Magister puis du Doctorat. Professionnellement, j‘ai beaucoup appris avec lui tout au long de ces années d‘études, où à maintes reprises son expérience et ses conseils m‘ont été d‘une grande utilité et d‘un apport inestimable pour ma formation post graduée. Je lui serai reconnaissante de la confiance qu‘il m‘a témoignée. Je tiens aussi à remercier le Professeur A-.H. MENIAI, mon enseignant pour m‘avoir fait un grand honneur en acceptant de présider le jury. Je le remercie aussi pour les discussions scientifiques que j‘ai eu la chance d‘avoir avec lui, à maintes occasions. Je remercie aussi Messieurs les Professeurs M. OMARI (U.Biskra et D. BARKAT (U.Biskra, pour m‘avoir fait honneur et plaisir en acceptant d‘examiner ce travail. Je tiens à remercier Dr BOUHELASSA, maître de conférence à l‘université Mentouri de Constantine, mon enseignant durant les années d‘étude pour l‘honneur qu‘il m‘a fait en acceptant d‘examiner ce travail ; Je ne saurais oublier toutes les autres personnes qui, plus ou moins directement, ont contribué aussi bien à la réussite de ce travail SOMMAIRE LISTE DES FIGURES LISTE DES TABLEAUX NOMENCLATURE INTRODUCTION GENERALE 1 CHAPITRE 1 : LA POLLUTION ET LES PRINCIPAUX TYPES DE POLLUANTS 1.1 Introduction 4 1.2 La pollution des eaux 4 1.3 La pollution naturelle 5 1.4 La pollution industrielle 6 1.5 Les principaux types de polluants 6 1.5.1 Les métaux lourds 7 1.5.1.1 Généralités 7 1.5.1.2 Source d’émission 7 1.5.1.3 Les rejets des métaux lourds dans l’eau 8 1.5.1.4 La toxicité par les métaux lourds 8 1.5.1.4.a Le cuivre 10 1.5.1.4.b Le zinc 13 1.5.1.4.c Le cadmium 16 1.5.2 Les phénols 20 1.5.2.1 Définition 20 1.5.2.2 Propriétés physiques 20 1.5.2.3 Spectroscopie UV Visible 21 1.5.2.4 L’oxydation 22 1.5.2.5 L’acidité 22 1.5.2.6 Basicité 23 1.5.2.7 Les risques de pollution de l’environnement 24 1.5.2.8 Dégradation, produits de décomposition 24 1.5.2.9 Toxicité par le phénol 25 1.6 Discussion des différentes méthodes d’épuration des eaux 25 CHAPITRE 2 : ETUDE DU MECANISME DE RETENTION À L’INTERFACE SOLIDE LIQUIDE 2.1 Introduction 26 2.2 Origine des charges de surface 26 2.3 Théorie de la double couche et potentiel zêta 26 2.3.1 Définition de la double couche 26 2.3.2 Historique des modèles de la double couche électrique 27 2.3.3 Principe de la théorie de la double couche 27 2.4 L’Adsorption 30 2.4.1 Types d’adsorption 30 2.4.2 Les modèles d’adsorption 31 2.4.2.a Isotherme de Langmuir 32 2.4.2.b Equation de Gibbs 34 2.4.2.c Isotherme de Freundlich 34 2.4.3.d Isotherme de Temkin 35 2.4.2.e Isotherme BET ( Brunauer-Emmett-Teller) 36 2.4.3 Utilisation industrielle de l’adsorption 37 2.4.4 Les adsorbants 38 CHAPITRE 3 : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 40 CHAPITRE 4 : METHODOLOGIE EXPERIMENTALE 4.1 Introduction 49 4.2 Matériaux et produits chimiques 49 4.2.1 Les supports 49 4.2.2 Les solutions 49 4.2.2.1 Le phénol 49 4.2.2.2 Les métaux lourds 50 4.3 Méthode d’analyse des polluants 50 4.3.1 Loi de beer-lamber 51 4.3.2 Validité de la loi de beer-lamber 52 4.3.3 L’UV 52 4.3.4 L’absorption atomique 56 4.4 Protocole suivi et détermination des concentrations 59 4.4.1 Pour le phénol 59 4.4.2 Pour les cations métalliques 59 CHAPITRE 5 : LES TECHNIQUES DE CARACTERISATION 5.1 Introduction 61 5.2 Les méthodes quantitatives 61 5.2.1 L’analyse élémentaire 61 5.2.1.1 Dosage du carbone et de l’hydrogène 62 5.2.1.2 Dosage de l’azote (méthode de Dumas 1831) [78] 62 5.2.2 Résultats de l’analyse élémentaire 62 5.2.3 La mesure de la surface spécifique (BET) 63 5.2.3.1 Définition 63 5.2.3.2 Principe 63 5.2.3.3 Calcul de surface spécifique 64 5.2.3.4 Réalisation d'une mesure 65 5.2.4 Les résultats de la BET 67 5.3 Les méthodes qualitatives 67 5.3.1 Le microscope électronique à balayage (MEB) 67 5.3.1.1 Définition 67 5.3.1.2 Principe 67 5.3.1.3 Préparation de l’échantillon 68 5.3.1.4 La métallisation 68 5.3.2 Résultats obtenus par le microscope électronique à balayage 69 5.4 Méthodes spectroscopiques 76 5.4.1 La spectroscopie Infra rouge (IR) 77 5.4.1.1 Définition 77 5.4.1.2 Principe 77 5.4.1.3 Préparation de l’échantillon 78 5.4.2 Résultats obtenus par IR 78 5.4.3 Rayon X 80 5.4.3.1 Définition 80 5.4.3.2 Principe 81 5.4.3.3 Acquisition et traitement du signal 81 5.4.3 Résultats obtenus par rayon X 81 CHAPITRE 6 : RESULTATS ET DISCCUSSION 6.1 Introduction 84 6.2 Le phénol 84 6.2.1 L’effet du temps de contact 85 6.2.2 Etude de la cinétique 86 6.2.2.1 Modèle de la cinétique du pseudo premier ordre (modèle Lagrangien) 86 6.2.2.2 Modèle de la cinétique du deuxième ordre 87 6.2.2.3 Modèle de la diffusion intra particule 88 6.2.2.4 Modèle d’Elovich 90 6.2.3 L’effet du pH 91 6.2.4 Effet de la concentration initiale 94 6.2.5 Etude de l’équilibre d’adsorption 96 6.2.5.1 L’isotherme de Temkin 98 6.2.5.2 L’isotherme de Brunauer, Emmett et Teller 99 6.2.6 L’effet de la granulométrie 100 6.2.7 L’effet du rapport solide/liquide 102 6.2.8 La comparaison avec d’autres supports 103 6.3. Les cations métalliques 104 6.3.1 Effet du temps de contact 104 6.3.2 Etude de la cinétique 107 6.3.2.1 La cinétique du Cuivre 107 6.3.2.2 La cinétique du Zinc 109 6.3.2.3 La cinétique du Cadmium 111 6.3.3 L’effet du pH 114 6.3.4 Effet de la concentration initiale 117 6.3.5 L’isotherme d’adsorption 119 6.3.6 Effet du diamètre des grains 123 6.3.7 Effet du rapport solide liquide 125 6.3.8 Comparaison avec d’autres supports 127 6.3.9 Etude de la désorption 129 6.3.10 Etude de la sélectivité 130 6.3.11 Analyse du support 131 6.3.12 Conclusion 132 CONCLUSION GENERALE 133 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 135 ANNEXES 145 ANNEXE 1 La courbe d’étalonnage du phénol 145 ANNEXE 2 La courbe d’étalonnage du Cuivre 146 ANNEXE3 La courbe d’étalonnage du Zinc 147 ANNEXE 4 La courbe d’étalonnage du Cadmium 148 ANNEXE 5 La forme linéaire du modèle de Langmuir du phénol 149 ANNEXE 6 La forme linéaire du modèle de Freundlich du phénol 150 ANNEXE 7 La fiche de sécurité technique du phénol 151 ANNEXE 8 La fiche de sécurité technique du Cuivre 156 ANNEXE 9 La fiche de sécurité technique du Zinc 159 ANNEXE 10 La fiche de sécurité technique du Cadmium 162 INTRODUCTION GENERALE INTRODUCTION GENERALE Près de 97% de l'eau planétaire se trouve dans les mers et les océans [1]. Cette eau est trop salée pour pouvoir être consommée. En effet, l'homme ne boit et n'utilise que de l'eau douce, c à d non salée. L'eau douce, c'est l'eau des glaciers et des banquises. Une eau malheureusement inutilisable à l'état naturel parce que gelée. C'est aussi l'eau des fleuves, des rivières, des lacs et des nappes souterraines. C'est cette eau que l'homme utilise pour boire et s'alimenter. Mais sa quantité disponible ne représente qu‘un millionième de l‘eau sur terre. Un peu plus des trois-quarts de la réserve d'eau douce de la planète est retenue dans les glaces des régions polaires. Reste donc un tout petit quart avec lequel l'humanité doit satisfaire tous ses besoins en eau. L'eau de la planète se répartit approximativement de la manière suivante [2] [3] : Eau salée : 97,2 % Eaux souterraines : 0,63 % Glaces polaires: 2,15 % Eaux de surface (lacs, fleuves, rivières) : 0,02 % Eau atmosphérique : 0,001 % Si seuls les produits naturels étaient véhiculés par nos eaux, si divers soient-ils, ils restaient dans le cycle de la vie et tout le mécanisme d‘autoépuration s‘effectuait normalement. Mais les choses ont bien changé aujourd‘hui où notre civilisation technique déverse dans nos précieuses eaux des produits artificiels de toutes sortes, allant des gasoils aux détergents, du uploads/Industriel/ arris.pdf
Documents similaires





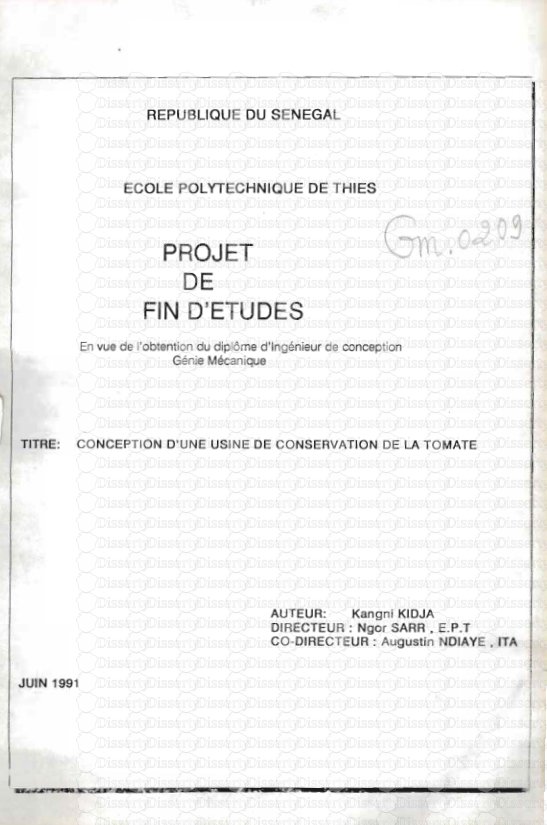




-
65
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 17, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 2.1293MB


