ANAL YSE ET CALCUL DE COÛTS Bibliographie : Contrôle de gestion, manuel et appl
ANAL YSE ET CALCUL DE COÛTS Bibliographie : Contrôle de gestion, manuel et applications Langlois, Bringer et Bonnier Ed ''foucher'' PARTIE 1 : Contrôle de gestion → calcul des coûts Chapitre 1 : Les méthodes traditionnelles de calcul de coûts SECTION 1 L'utilité des calculs de coûts : – car c'est nécessaire à la prise de décisions – valorisation des stocks et des productions immobilisées. Quand entreprise fabrique des équipements pour elle même il faut valoriser cette production avec la méthode de calcul de coûts. Les méthodes de calcul de coûts se distinguent car il y a des natures de charges différentes. CHARGES DIRECTES INDIRECTES Variables 1 2 Fixes 3 4 Charges directes : on peut les affecter aux éléments de coûts. Charges indirectes : elles sont communes à plusieurs activités, elles concernent simultanément plusieurs objets de coûts. On fait un tableau de répartition des charges indirectes pour ventiler les charges. Charges variables : elles varient en fonction des quantités produites et vendues. On distingue 2 grandes catégories de méthodes : – les coûts complet : on tient compte de toutes les charges incorporables permettant de calculer des coûts de revient et les résultats. Utile pour fixer les prix à long terme car ça doit couvrir les charges. On peut analyser tous les coûts, sur les conditions d'exploitation de l'entreprise à tous les niveaux. – les coûts partiels : c'est plus simple et plus rapide. Ils servent à calculer des marges. C'est moins précis car on tient compte que d'une partie des charges. SECTION 2 : Méthode des coûts partiels Analyse et calcul de coûts _ S3 1 I/ Les coûts variables (1+2) Cette méthode est utile car on sait qu'une partie des charges varient et l'autre est fixe donc on peut faire des simulations et donc des prévisions. C'est avec cette méthode qu'on détermine le seuil de rentabilité. II/ Les coûts directs (1+3) En pratique, les deux méthodes sont très proches, car la plupart des charges variables sont directes et une partie des charges fixes sont indirectes. Ceci dit, il y a une petite différence : → plus faciles identifier les charges directes que les charges variables. => Méthode simple. III/ La méthode des coûts spécifiques (1+2+3) Amélioration de la méthode des coûts variables. Si équipement qui sert que pour la production d'un seul produit alors la dotation aux amortissements de ce produit sont des charges fixes et directes. C'est un compromis entre les couts variables et les couts complets. Détermination de la marge sur coûts spécifiques. Cette méthode : – sert à apprécier la contribution du produit ou de l'activité à la couverture des charges communes (charges fixes indirectes) ; – est un critère de maintien ou d'abandon du produit. → Seuil de rentabilité par produit : Analyse et calcul de coûts _ S3 2 Taux de MSCV du produit Charges fixes spécifiques Chapitre 2 : Imputation rationnelle des charges fixes. Neutraliser l'influence du niveau d'activité sur les coûts. On empêche que les couts soient impactés par des volumes d'activité différents. Cette méthode a été utilisée en période de crise. Pendant la crise il y a des capacités industrielles et commerciales qui sont inutilisées et avec la méthode on ne prend pas en compte les facteurs de production qui ne sont pas utilisés. D'abord, la comptabilité de gestion a servi à déterminer la politique de prix avec la méthode des coûts complets. Ensuite, le secteur industriel s'est développé et il devint nécessaire de maitriser, de contrôler les coûts de production. Le personnel de production est évalué en fonction des coûts de production. Il faut que le personnel de production soit productif, il doit minimiser ses facteurs de production. Le problème : les coûts de production sont influencés par le niveau, le volume d'activité sans qu'il y ait de différence dans l'efficacité du personnel de production. → on veut se débarrasser de l'impact de l'activité sur les coûts = méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. SECTION 1 : L'influence de l'activité sur les coûts Coût de revient unitaire : I/ Sur les coûts variables En pratique ce cout variable unitaire est constant et il est d'abord décroissant puis croissant. Schéma 1 du polycopié. /!\ Facteurs de rendement croissant : – baisse du cout d'achat des matières premières avec le volume ; – travail en série plus longue : réduction des temps morts dus aux lancements de production ; – montée en cadence du personnel dont les tâches répétitives s'automatisent progressivement. Plus facile de rationaliser le travail du personnel sur des quantités plus importantes. Au delà de l'optimum, le cout variable unitaire recommence à augmenter, facteurs de rendement décroissant : – cours plus élevés sur personnel (heures supplémentaires, main d'œuvre temporaire) ; Analyse et calcul de coûts _ S3 3 (CVU x Q) + CF Q – fatigue du personnel si on le sollicite trop et donc baisse de la productivité ; – encombrement des ateliers … II/ Sur les coûts fixes unitaires cf schéma 2 Le cout fixe unitaire CF / Q, est de la forme a/x qui est représentée par une branche d'hyperbole. => Le cout fixe unitaire diminue avec la quantité produite. Exemple 1 : (cf polycopié) Un atelier dont on a relevé le niveau des charges en fonction du degré d'activité exprimé en heures-machines : Heures-machines 800 900 700 Charges variables 8000 9000 7000 Charges fixes 16000 16000 16000 Charges totales 24000 25000 23000 Cout de l'unité d'œuvre 30 27,78 32,86 => le cout de l'unité d'œuvre qui est imputé au produit diminue avec le niveau d'activité et donc le résultat par produit augmente. => Pour comparer l'efficacité de l'entreprise sur différentes périodes pour lesquelles le niveau d'activité varie, il faut neutraliser le phénomène d'absorption des charges fixes. La méthode de l'IRCF (Imputation Rationnelle des Charges Fixes) joue ce rôle. Cette méthode est apparue avec la crise économique → les entreprises sont en sous régime il y a des capacités non employées. On isole le cout de la sous- activité. Cette méthode est utile quand : – activité saisonnière, – on calcule mensuellement les coûts, – il y a une importance des charges fixes. Les charges fixes sont de plus en plus importantes car les entreprises possèdent de plus en plus de matériel sophistiqué et donc amortissement importants et il faut financer ces investissements … SECTION 2 : La mise en œuvre. I/ L'activité normale L'activité normale correspond aux conditions les plus fréquentes d'activité. A partir de cette activité est calculé le coefficient d'imputation rationnelle, Cir. Analyse et calcul de coûts _ S3 4 Activité réelle Cir = Ce coefficient sert à pondérer les charges fixes. Charges fixes imputées = charges fixes réelles * Cir Ce procédé revient à transformer des charges fixes en des charges variables. Exemple 1 (suite): Le niveau de l'activité normale se situe à 800 heures-machines. Donc l'IRCF a permi de filtrer les effets de l'activité. Ainsi, en l'absence d'autres causes de variation, le coût de l'unité d'œuvre est constant. De leur côté, les coûts réels ne changent pas. Les différences entre les deux sont : – en cas de suractivité (900), un boni de suractivité = CFI – CFR = 18000 – 16000 = +2000 – en cas de sous-activité (ex : 700), un coût de chômage = 14000-16000 = -2000 Le boni de suractivité est à ajouter au résultat rationnel pour retrouver le résultat réel. Le coût de chômage est à soustraire. Analyse et calcul de coûts _ S3 5 Activité normale II/ Comparaison coût réel et coût rationnel (1) coûts de chômage (2) boni de suractivité III/ Le tableau de répartition des charges indirectes et l'IRCF Hormis dans les petites entreprises, le taux d'activité n'est pas identique dans tous les centres d'analyse, d'où l'utilisation de plusieurs coefficients d'imputation. A) La démarche Au niveau de chaque centre, il faut : – Procéder à la répartition primaire en distinguant les charges variables et les charges fixes ; – Calculer les charges fixes imputées avec le Cir de chaque centre ; – Répartition secondaire des charges variables et des charges fixes imputées ; – Calculer les coûts des unités d'œuvre dans les centres principaux. B) Exemple 2 cf polycopié Remarque : L’IRCF peut servir à la valorisation des stocks en cas de sous- activité. En effet, les stocks de produits finis sont évalués au coût de production et selon le PCG (art 321-21), le coût de production incorpore les charges variables et les charges fixes correspondant à la capacité normale. En revanche, en cas de suractivité, l'IRCF n'est pas utilisée pour estimer les stocks dont la valeur est plafonnée au coût complet (principe de prudence). Analyse et calcul de coûts _ S3 6 Coût réel Coût rationnel 16000 24000 800 Activité Coûts 1 2 CHAPITRE 3 : La comptabilité par activités ou méthode ABC C'est une nouvelle approche de calcul des coûts pour : – mieux maîtriser les frais généraux, – expliquer l'évolution des coûts (et pas seulement répartir les charges). Environ 20% des entreprises françaises pratiqueraient la méthode ABC (étude uploads/Industriel/ calcul-de-couts-s3.pdf
Documents similaires
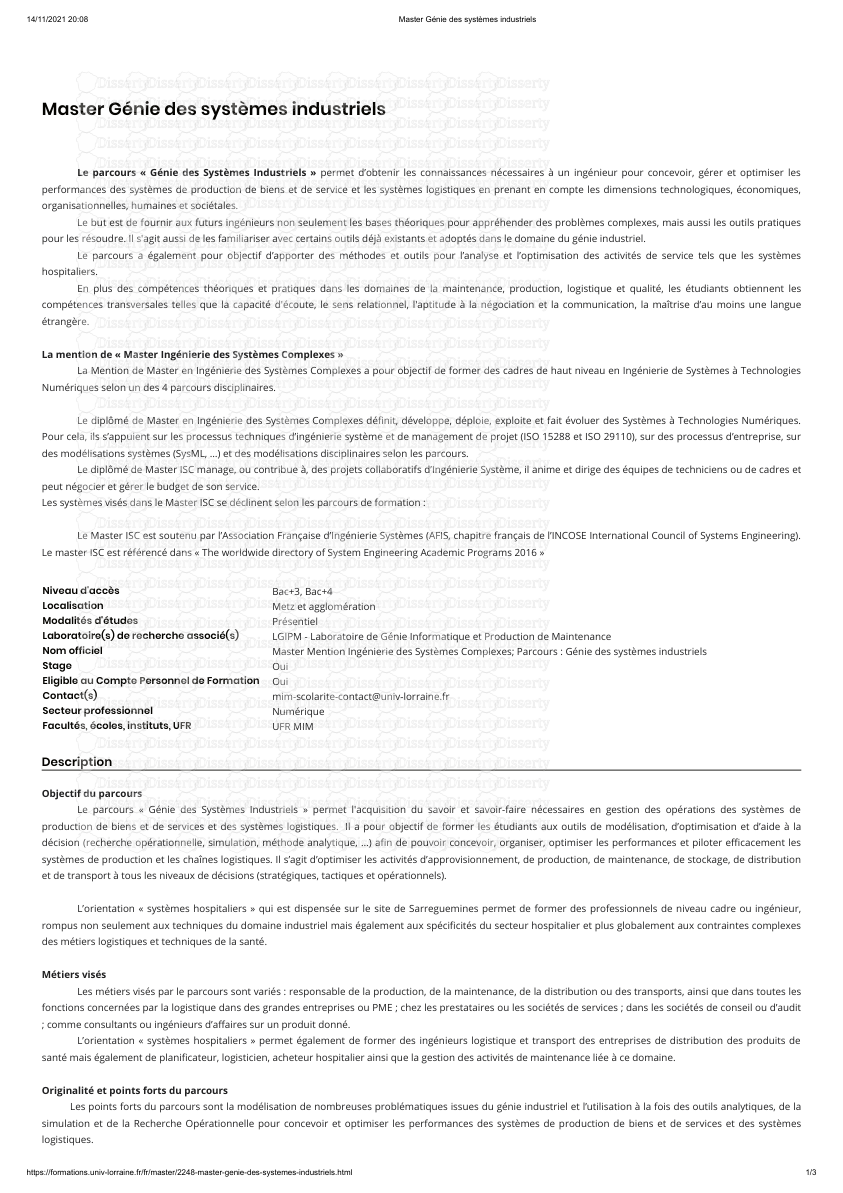









-
102
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 28, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2143MB


