1 Gestion de la qualité des aliments Pendant des millénaires .et encore mainten
1 Gestion de la qualité des aliments Pendant des millénaires .et encore maintenant dans de nombreux pays, le but des agriculteurs et éleveurs était de produire le plus possible, en cas de pénurie ou de famine, on vise la qualité, mais en Europe et en Amérique du nord, l’agriculture a si bien ‘’réussit’’ que l’offre est sura- bondante, on produit trop, producteurs et transformateurs visent donc la qualité, exigée par les consommateurs. I. Les Composantes de la Qualité Des aliments : Intuitivement, la qualité correspond pour nous à ‘’la valeur’’ d’une chose. Mais ici la qualité est l’aptitude d’un produit à satisfaire ses utilisateurs ‘’définition AFNOR’’. Définition ISO complète: Ensemble des propriétés et caractéristiques d’un produit ou d’un service qui lui confère l’aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites de tous les utilisateurs. L’utilisateur final d’un aliment, le consommateur, en attend plusieurs ‘’satisfactions’’, on a donc plusieurs composantes de la qualité alimentaire. Je vous en propose huit : 4+4. Sécurité, Santé, Saveur, et Service : les quatres 4S. Hygiénique, nutritionnelle, organoleptique et d’usage S1 - Sécurité : qualité hygiénique : On veut des dangers en moins. On ne veut pas que l’aliment apporte ‘’du mauvais’’, nous rende malade. Qu’est ce qui peut rendre malade dans un aliment ? Microbes (ex : salmonelles, virus de l’hépatite) ou leur toxine, produits toxiques (ex : métaux lourds, pesticides), composants nor- maux en excès (ex : sel, lipide), composants normaux inadaptés a un consommateur parti- culier (ex : intolérant au lactose, allergique aux arachides). La maîtrise de la sécurité de l’ali- ment, de la qualité hygiénique fait l’objet de l’ensemble des cours de l’hygiène (ex : HACCP et l’hygiène en IAA). S2 - Santé : qualité nutritionnelle : On veut des nutriments en plus, on veut que l’aliment apporte « du bon », qu’il soit diététique, qu’il maintienne et améliore notre santé. Il s’agit d’abord des nutriments majeurs (lipides, protides, glucides), et mineurs (vitamines et minéraux). Des demandes nouvelles surgissent concernant des non nutriments utiles (fibres, AG oméga 3, polyphénols, oligo éléments), ou supposés bénéfiques (pro biotiques, aliments « fonctionnels »). En fait l’équilibre nutritionnel vient du régime, donc de tous les aliments consommés sur une longue période. 2 La qualité nutritionnelle d’un seul aliment ne veut donc pas dire grand-chose. Il n’y a pas d’aliment idéal, l’idéal étant de varier les aliments. Les deux premières composantes de la qualité, sécurité et santé, sont invisible. Le consommateur doit faire confiance au vendeur, et le vendeur lui-même faire confiance au pro- ducteur : c’est pourquoi les distributeurs imposent des normes de qualité sanitaire. C’est aussi pourquoi la loi intervient pour assurer la protection des consommateurs : la qualité hygié- nique des aliments est une obligation pour l’IAA. Le consommateur peut ‘’voir’’ lui-même les deux composantes suivantes, saveur et service. S3 - Saveur : qualité organoleptique ou hédonique : On veut ‘’se faire plaisir’’, on veut satisfaire ses cinq sens (et pas seulement le goût !). Cette qualité conditionne souvent les deux premières : on s’intoxique parfois parce qu’on aime (ex: alcool), on déséquilibre sa ration par excès ou manque de goût (ex : excès de lipides et boissons sucrées (USA), carences chez les vieillards). La qualité organoleptique a une com- posante sensorielle majeure, mesurable par analyse sensorielle (objectivée par un jury), mais a aussi une composante psychologique et sociale (le rêve, expliquée plus loin). S4 - Service : qualité d’usage : On veut que ce soit commode, Un aliment sain, complet et délicieux ne sera pas vendu s’il est trop cher, introuvable, difficile à préparer et impossible à conserver (ex : certains fruits exotiques). On veut donc des aliments - qui se conservent longtemps avant la vente et après achat, et après ouverture (ex : lait UHT). - qui soient faciles à utiliser: stockage, ouverture/fermeture, préparation. Aujourd’hui, une grande part de la valeur ajoutée aux aliments par les IAA porte sur cette valeur d’usage et de service (ex : emballages sophistiqués, plats tout-prêts). - qui soient abordable : à la fois pas trop chères et disponibles, en vente ‘’partout’’. Le prix est un facteur de choix déterminant pour certaines personnes (petits revenus), mais donne aussi une image de la qualité. Il y a confusion entre « c’est mieux, donc c’est normal que ce soit plus cher », et « c’est plus cher donc surement meilleur ». Les consommateurs se référent souvent au rapport qualité/prix. On peut ajouter à ces ‘’quatre S’’ quatre autres qualités moins apparentes et moins concrètes, mais essentielles aussi pour le consommateur, et qui mobilisent beaucoup de moyen de la part des IAA : les 2 R, Régularité et Rêve et T&E Techno et Tique. 3 R1 - Régularité des autres qualités au cours du temps : On ne veut pas de surprise, la qualité ‘’ne paye’’ que si elle n’est pas reproductible (ex : un jus qui n’est bon que dans une bouteille sur deux ne correspond pas à l’attente du con- sommateur). Le contrôle qualité, l’assurance qualité, s’attachent à cette régularité pour donner un produit constant. On ne veut pas de surprise, même bonne ! Le consommateur y perd ce qui faisait le charme des aliments : leur variabilité. R2 - Rêve : On veut s’évader, certains consommateurs recherchent le naturel (produits ‘’bio’’), le tradi- tionnel (ex : publicité avec une ‘’mamie’’ ou un tableau du 16eme siècle, attrait du rural), c’est ce qu’on appelle des caractéristiques transférées ou l’imaginaire et le symbolique vont faire rêver le consommateur (ex : la confiture de ma grand-mère est forcément meilleure). Cette qualité transférée est renforcée par la publicité, le style du point de vente (animation’’ en grande surface, décoration du magasin), mais aussi par la proximité (réseau, famille, bouche à oreille). Cette qualité de rêve renforce nettement les qualités organoleptiques (c’est meilleur dans un emballage ‘’flatteur’’ ou autours d’un repas de fête). T1 - Technologie : Aptitude à la transformation et à la distribution, le consommateur n’est pas le seul utilisateur de l’aliment, or la qualité est la satisfaction de tous les utilisateurs : les transformateurs, artisans et industriels, et les distributeurs, magasins et grandes surfaces, attendent eux aussi des caractéristiques précises des produits. Il s’agit des qualités technologiques : aptitude à la transformation et à la distribution (ex : qualité boulangère d’une farine, rétention d’eau d’une viande pour la salaison, aptitude au rangement dans un camion, durée de conservation d’un yaourt en grande surface). E1 - Ethique : On veut être ‘’un mec bien’’, aptitude à satisfaire les exigences morales des consomma- teurs avec la prise en compte explicite des besoins ‘’des autres’’, ces autres peuvent être par exemple : - les générations futures (production durable, ‘’bio’’). - les producteurs locaux (circuits courts). - les producteurs des pays pauvres (commerce équitable) - les animaux et leur bien-être (œufs de poules marqués 1 ou 3). Au total 8 aspects de la qualité : 4S+2R+TE 4 II. Les signes de la qualité : L’entreprise qui produit de la ‘’qualité’’ veut que ce soit reconnu officiellement (attesté), et veut le faire savoir (aux consommateurs). En grande surface, l’acheteur consacre en moyenne une seconde au choix d’un aliment : la qualité doit donc ‘’sauter aux yeux’’. L’entreprise peut pour cela utiliser sa propre marque commerciale ou une garantie officielle comme le label rouge, la certification de conformité, ou l’appellation d’origine contrôlée (vous connaissez déjà un exemple de garantie officielle de qualité hygiénique, l’estampille de salubrité apposée sur les carcasses sortant d’un abattoir). 1. Marque commerciale : L’entreprise peut pratiquer une ‘’politique de marque’’, en se construisant une ‘’image de marque’’ qui le distingue de ses concurrentes (Danone, Nestlé etc…). Son seul nom de marque commerciale, (exigence pour l’enregistrement : l’antériorité), apposé sur le produit, donne confiance au consommateur. Les grandes entreprises veillent sur leur image de marque, la conforte par la communication et la publicité, et des efforts permanents de qualité et de régularité. Le capital que constitue la marque impose à l’entreprise de maintenir la qualité de ses produits. Les plus grosses entreprises utilisent la confiance inspirée par leur marque pour conforter toutes les marques de leur groupe (ex : Nestlé). Plus largement, un groupe d’entreprises trop petites pour avoir une politique de marque isolée peut déposer une marque collective, pour se faire connaitre et favoriser la promotion. Apriori, pas d’exigence officielle de qualité, la marque collective est juste une ‘’étiquette’’. Beaucoup d’entreprise, plus récente ou plus petite, ne dispose pas de ce capital d’une marque reconnue. Elles vont donc utiliser des ‘’marques’’ collectives plus largement reconnues, Les garanties officielles de qualité (les grandes entreprises aussi d’ailleurs). Les appellations d’origine, les Labels, les certifications, l’agriculture biologique. AOC : Appellation d’origine contrôlée : L’AOC est un nom de lieu, servant à désigner un produit qui vient de ce lieu, et dont les qualités sont dues essentiellement au milieu géographique (facteurs naturels et humains). Les AOC sont délivrées par l’INAO, institut national des appellations d’origine. Le produit AOC est donc lié à un terroir (climat, sol traditions), et doit avoir une originalité liée au lieu uploads/Industriel/ cours-l3-alimentation-nutrition-et-pathologie-gestion-de-la-qualite-des-aliments-belhadj-m.pdf
Documents similaires



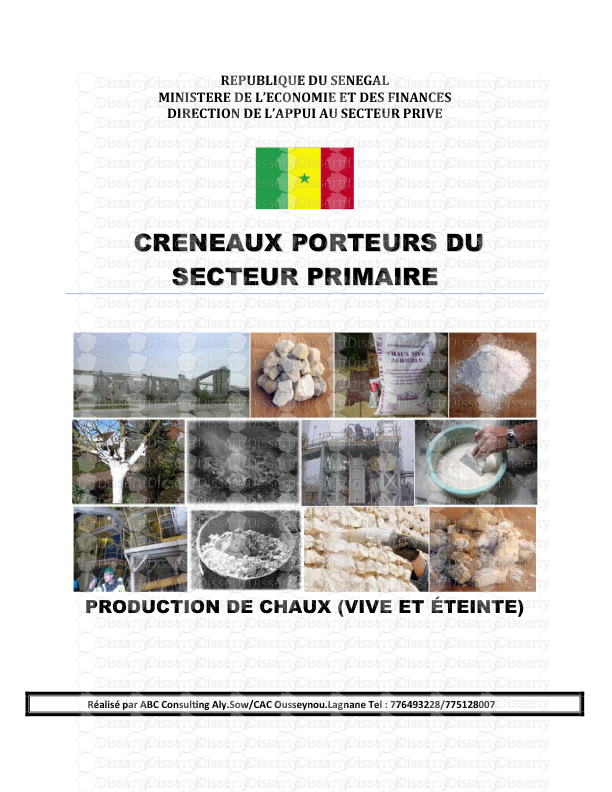






-
53
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 13, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1437MB


