I. CA RA CT ÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 1) L’entreprise est radicalem
I. CA RA CT ÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 1) L’entreprise est radicalement séparée de la famille : - Dans la société traditionnelle on s’apparente à la famille. Avant la banque, l’atelier, la ferme, … restaient des « affaires de famille ». (ex. : Rothschild, …) La famille est une cellule de production de richesses - Dans la société industrielle c’est différent. Les membres de la famille la quittent pour aller travailler dans les industries. La famille est une cellule d’exploitation et de consommation de richesses. 2) La division du travail est basée sur la technologie : - Dans la société traditionnelle l’homme domine l’outil, la machine. Cela dépend de l’habilité, de l’expérience ; et au plus on est vieux au plus on a d’expérience, ce sont donc les plus expérimentés qui gèrent la production de richesses. - Dans la société industrielle c’est en quelque sorte la machine qui gouverne, elle impose son rythme et donc le déroulement du travail et de la production. Les jeunes prennent la place des anciens dans le processus de production de richesses, car ce travail demande une capacité d’adaptation à la machine. Ce n’est donc plus avec l’âge que l’on progresse. 3) Accumulation de capitaux nécessaire : - Dans la société traditionnelle l’outil de travail est bon marché, il ne coûte qu’une journée de labeur ou on peut même le construire soi-même. - Dans la société industrielle la mécanisation rend les outils de travail très chers. L’aspect financier devient de plus en plus présent. Il y a une importance de capital humain ET de capital financier. 4) Calcul économique rigoureux indispensable : - Dans la société traditionnelle les calculs économiques restent assez sommaires, on gère sa fortune soi-même. - Dans la société industrielle, du fait de l’accumulation de capitaux, il faut rendre des comptes aux actionnaires, à la banque, … Le SURNY Sébastien [ECGE 11 BA] (2007-2008) Page 1 HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE – ECGE 1121 [P. SERVAIS] ANNÉE ACADÉMIQUE 2007-2008 prix de la mécanisation entraîne un calcul économique rigoureux. On gère plus d’argent. 5) Concentration de la main d’œuvre sur l e lieu de travail : - Cela permet une économie de temps (pas de déplacements) et d’énergie. - Économiquement, c’est également plus avantageux, mais socialement cela va conduire à une prise de conscience collective (l’intérêt des ouvriers varie de celui des patrons). Karl Marx va se pencher sur cette prise de conscience et met en place la « lutte des classes ». - Cette concentration de la main d’œuvre pose la question de la propriété des moyens de production : les ouvriers se disent que leur machine leur appartient (contrairement au patron). - 3 réponses, conséquences : Communisme (Russie) Libéralisme (Amérique du Nord) Économie mixte, marché libre où l’état joue un rôle régulateur (Europe) Cette série de modifications importantes renvoient à la caractéristique principale de la société industrielle : LE CHANGEMENT. II. LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ET LE CHANGEMENT 1) Substitution d’inventions mécaniques aux talents humains : - La machine prend en charge des tâches difficiles et éprouvantes pour l’homme. 2) Substitution de l’énergie inanimée à la force humaine et animale : - Se fait très lentement. Amélioration de la productivité et simplification du processus. - Elle soulage l’homme et démultiplie l’efficacité de l’homme dans la société. 3) Amélioration sensible de l’extraction et du travail des matières premières : - On rentabilise les matières premières à fond, car la productivité est de plus en plus forte. - Le rendement et les bénéfices augmentent et les avantages qui s’en suivent pour la société sont considérables. SURNY Sébastien [ECGE 11 BA] (2007-2008) Page 2 4) Accroissement de la taille de l’unité de production : - Dans la société traditionnelle l’unité de production était la famille. - Dans la société industrielle tout le monde fait partie de l’unité de production. - Les machines et les ouvriers sont rassemblés en un seul endroit. Amélioration de la productivité, et moins coûteuse. 5) Nouvelle définition des fonctions et des responsabilités des différents participants à l’opération productive : - EMPLOYEUR - TRAVAILLEUR - Il y a une perte de contact entre l’employeur et le travailleur, l’écart est de plus en plus important. - Dans la société traditionnelle l’entreprise familiale est composée de quelques personnes seulement, donc même s’il y a un patron et un employé, une relation humaine existe. - Dans la société industrielle les employés des grandes entreprises ne verront peut-être jamais leur patron. Cela implique un désengagement progressif de la part des deux parties. Chacun a tendance à en faire le moins possible pour l’autre. III. DES MOUVEMENTS À AMPLITUDES MULTIPLES 1) Mouvements saisonniers : - Héritage de la société traditionnelle = fluctuation des prix des biens alimentaires en fonction de la saison. Cela s’apaise dans la deuxième moitié du 20e siècle. - C’est le seul mouvement directement perceptible par l’être humain, sans nécessité de calculs particuliers. 2) Mouvements de court et de moyen terme : - Kitchin : Mouvement économique caractéristique de la deuxième industrialisation d’une durée d’environ 4 ans avec les caractéristiques habituelles d’un cycle (hausse-plateau [stagnation]-baisse), mais qui se déroule plus vite qu’au 19e siècle. À un lien étroit avec les stocks des entreprises, les stocks ne se vident plus l’économie ralentit licenciements quand l’économie reprend on relance la machine. - Juglar : Cycle de 8 à 10 ans, comme c’était souvent le cas au 19e siècle, toujours en fonction des stocks. SURNY Sébastien [ECGE 11 BA] (2007-2008) Page 3 - Labrousse : Cycle de 10 à 15 ans, essentiellement dans la deuxième moitié du 18e siècle. Il s’agit d’un cycle de transition entre une société dotée d’un rythme économique traditionnel et une société industrielle. Ce cycle a probablement été élaboré suite à la crise à la veille de la Révolution française (1789). - Kuznets : Entre moyen et long terme, cycle d’environ 15-20 ans. Il s’agit d’un mouvement de transition entre moyen et long terme et qui se superpose au Kitchin et Juglar. On ne sait pas repérer les déterminants de ce cycle. 3) Mouvements de long terme : - Ces mouvements se superposent, s’accumulent l’un à l’autre, mais on ne peut pas identifier leurs moteurs. - Kondratieff : Cycle d’environ 60 ans, composé de 2 phases : décroissance de 30 ans et croissance de 30 ans. - Simiand : Existe depuis le 13e siècle, composé aussi de 2 phases de 30 ans. - Trend séculaire : Cycle de ± 100 ans. Méthode utilisée pour constater un mouvement de long terme. Mouvements provoqués par des révolutions démographiques, des évolutions climatiques, … Conclusion : Il est important pour les économistes de savoir se situer par rapport à ces rythmes pour le long terme, même si on ne sait pas pourquoi ces mouvements surviennent, on sait que s’ils sont à la baisse, tous les autres aussi sont à la baisse. Il faut notamment analyser ces mouvements pour prendre des décisions économiques et/ou politiques. IV. DES INDICES (INDICATEURS) Le changement se manifeste pat l’évolution des structures, par des mouvements rythmiques, mais également par la variation des indicateurs. 1) Prix de gros : - C’est un indicateur idéal de l’évolution des entreprises. Il s’agit du prix auquel les entreprises vendent aux détaillants. - S’il est à la hausse, la demande sera plus importante, sa situation concurrentielle est bonne et cela engendre aussi une croissance (dans la société), car ils demandent des employés. 2) Prix de détail : SURNY Sébastien [ECGE 11 BA] (2007-2008) Page 4 - C’est un indicateur de l’évolution du commerce, de l’évolution du pouvoir d’achat et du niveau de vie. - Il s’agit du prix que nous payons en magasin. 3) Prix de travail (salaire) : Il permet de mesurer : - L’évolution du niveau de vie de la population. - Les charges que ce facteur de travail fait reposer sur l’entreprise. - Sur le plan social, le rapport de force entre différents facteurs de production (facteur travail et capital). - Depuis 2 siècles il augmente sans interruption, mais le nombre de travailleurs lui, diminue. 4) Productions : - C’est un indicateur à la fois essentiel et peu significatif. - Il est essentiel, car c’est en produisant que l’on crée de la richesse ( quasi en hausse permanente depuis 2 siècles). - Il est peu significatif, car la production est généralement estimée à sa valeur monétaire. Or, au plus il y a d’unités productives, au plus la valeur diminue. Entre richesse et valeur il y a des nuances. 5) Produit national brut (PNB = agrégat) : - Cet indicateur fait son apparition dans les années 30 (40-50 ?). - Il s’agit de l’ensemble des biens et services produits sur un territoire donné, pour une période donnée et exprimé en unité monétaire courante. - Il permet de voir l’évolution de l’économie dans son ensemble. !!! Une hausse du PNB devrait correspondre à une augmentation des richesses produites, mais il ne prend en compte que les activités officiellement uploads/Industriel/ ecge11ba-histoire-economique-et-sociale-cours-servais-2007-2008.pdf
Documents similaires





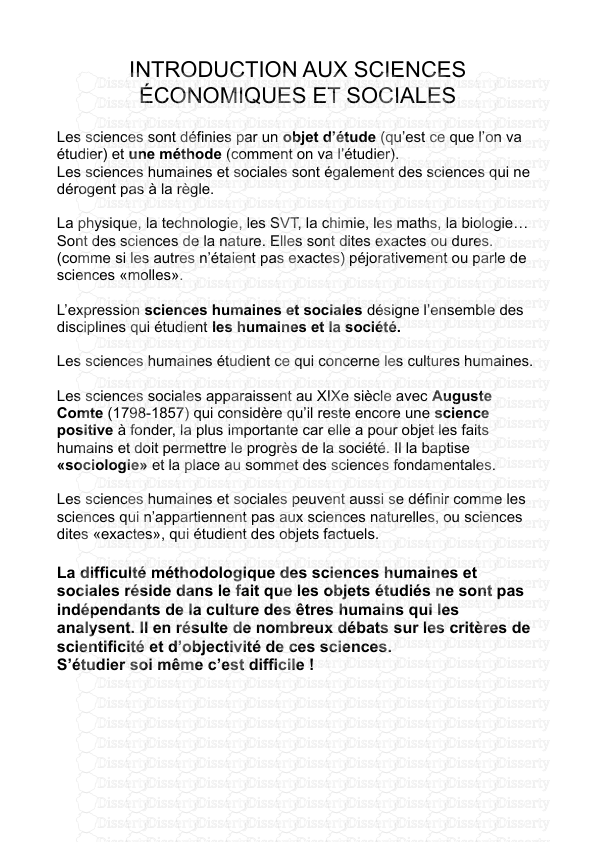




-
65
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 23, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2445MB


