De la même auteure chez Gallimard Jeunesse : On s’est juste embrassés La Décisi
De la même auteure chez Gallimard Jeunesse : On s’est juste embrassés La Décision Double faute Demandez-leur la lune Les Douze Travaux d’Hercule Isabelle Pandazopoulos Trois filles en colère Les articles p. 134 et p. 194 sont reproduits avec l’aimable autorisation du journal Le Monde. © Le Monde, août 1967 et 6 juin 1967 Le poème de Yannis Ristos p. 140 à 142, « Lettre à Joliot-Curie », est tiré de L’Amertume et la Pierre / Poètes au camps de Makronissos / 1947-1951, traduction de Pascal Neveu. © Ypsilon Éditeur, 2013 L’article p. 288 est reproduit avec l’aimable autorisation du journal La Croix. © La Croix, Pierrette Martin, le 3 mai 1968 Gallimard Jeunesse 5, rue Gaston Gallimard, 75007 Paris www.gallimard-jeunesse.fr © Éditions Gallimard Jeunesse, 2017, pour le texte © Éditions Gallimard Jeunesse, 2020, pour la présente édition À Antoine, à ton goût viscéral pour la liberté για τον πατερα μου für meine Mutter PARIS Famille LAVAGAULEYNE Suzanne Lavagauleyne, née en 1949 à Berlin. Maxime Lavagauleyne, père de Suzanne. Riche banquier. Ilse Lavagauleyne, née Mühlmeister, mère de Suzanne. Dieter Mühlmeister, né en 1945, fils de Ilse et demi-frère de Suzanne. Père inconnu ? Fanchette, intendante, attachée à la famille Lavagauleyne depuis toujours. BERLIN Famille MÜHLMEISTER Magda Mühlmeister, née en 1949 à Berlin. Karl Mühlmeister, frère de Ilse, peintre, père de Magda. Sybille Mühlmeister, décoratrice, mère de Magda. Hans, Lotte et Heidi, frère et sœurs de Magda. ATHÈNES Famille ROUNARIS Cléomèna Rounaris, née en 1949, à Nauplie dans la clandestinité. Stavroula Rounaris, mère de Cléomèna, résistante commu niste à l’occupant nazi. Yanis Rounaris, père de Cléomèna, résistant communiste à l’occupant nazi, instituteur, prisonnier politique. Mitso Rounaris, frère de Cléomèna. C’est le hasard qui a mis entre mes mains les lettres qui composent ce livre. Elles se trouvaient au fond d’une valise, une vieille valise toute cabos sée que j’ai achetée pour trois sous chez un bro canteur. Il y avait avec ces lettres quelques articles de journaux glissés dans des enveloppes, des tracts, un plan de Berlin, une carte de Grèce et des pages écrites sur des feuilles arrachées à des cahiers d’écolier. Cette correspondance forme un ensemble qui débute en août 1966 pour s’achever en novembre 1968. Je me suis contentée de la ranger par ordre chronologique, glissant ici et là quelques notes per sonnelles quand cela me semblait utile. J’ai par ailleurs laissé toutes les archives qui s’ajoutaient à ces lettres, telles qu’elles étaient, rendant compte d’une vérité historique forcément subjective. ÉPOQUE 1 AOÛT À DÉCEMBRE 1966 13 Lettre 1 De Suzanne à Magda Paris, 26 août 1966 Ma chère Magda, Trois jours que tu es partie ! Trois jours, ce qui fait exactement soixante-douze heures, soit quatre mille trois cent vingt minutes, soit deux cent cinquante-neuf mille deux cents secondes ! Sachant que chaque seconde pèse mille ans, tu peux imaginer dans quel état je suis. Aussi fripée et rabougrie que les pommes du Morvan que Fanchette nous rapporte et qui lui font l’an née. Ne lève pas les yeux au ciel, je n’exagère rien, il faut que tu me croies, je suis désespérée. Et je refuse d’être raisonnable. Ou convenable. Je suis infiniment triste et je ne vois pas pour quoi je devrais le cacher. Oui, tu as raison, j’en fais trop ; et dans ces circonstances cruelles, je ne me prive de rien : depuis ton départ, je n’ai cessé de pleurer. Et de gémir, de bouder, de crier à l’injustice ! J’en veux à la terre entière. J’ai croisé Françoise et Monique aujourd’hui, elles marchaient bras dessus bras dessous dans 14 les jardins du Luxembourg, dans cette même allée que nous empruntions toutes les deux pour nous rendre au lycée. Dieu merci, elles ne m’ont pas vue ! Je n’aurais pas eu la force de leur cacher la fureur qui m’a envahie en les voyant si complices ! À quelles extrémités me voilà réduite, être jalouse de ces deux crétines ?! La rentrée approche et la seule idée qui m’apaise un peu, c’est que c’est la dernière. L’an prochain, j’entre à la fac et je compte secrète ment que tu m’y rejoindras ! On trouvera une excuse, les études à Berlin, ce doit être moins bien. Forcément. Je nous vois déjà à la Sorbonne ! Et ne me réponds pas avec ton air sérieux que tu ne peux rien me promettre ! J’ai maudit la dignité et le courage que tu affi chais devant la porte de la maison au moment des adieux. Tu n’as même pas versé une larme, bien droite, avec ta petite valise posée à tes pieds. Tu avais la même à ton arrivée à Paris, il y a cinq ans. Un vieux truc informe, tout rata tiné et poussiéreux, aussi raide que ton père qui te tenait fermement par le haut du bras comme s’il avait craint jusqu’au dernier moment que tu refuses de le suivre. C’est dire s’il te connaît mal ! Moi, j’aurais préféré qu’on nous arrache l’une à l’autre par la force, qu’on te traîne sur le sol, que tu pousses des cris à la mesure de la dou leur que tu éprouvais de quitter cette maison, cette ville et ce pays qui étaient devenus un peu les tiens aussi, n’est-ce pas ? 15 N’est-ce pas ? Tu n’as pas dit un mot, tu ne m’as même pas regardée. Alors, je n’en suis plus si sûre main tenant que tu n’es plus là. Peut-être te sens-tu enfin libérée ? Oh, dis-moi que je te manque et que tu ne vas pas m’oublier... Non, non, dis- moi la vérité, surtout n’arrange pas tes lettres. Tenons notre promesse, on se racontera tout dans les moindres détails pour ne pas se perdre. Un peu comme nous faisions chaque soir quand j’allais te rejoindre dans ton lit, l’une contre l’autre, à rire et à se dire n’importe quoi jusqu’à sombrer dans le sommeil. Enfin, moi je m’endormais. Pendant ce temps, tu comptais les moutons… Maintenant que tu as retrouvé Berlin, est-ce que tu dors mieux ? Tes cauchemars ont cessé ? Je vous ai regardés vous éloigner, oncle Karl et toi, du petit balcon de la chambre de Dieter. Il était là aussi, mon frère, mais il ne m’a pas dit un mot. Il avait les deux mains serrées sur la ram barde en fer forgé, si fort que je voyais ses veines comme prêtes à éclater. Il te ressemble, à garder tout ce qu’il ressent à l’intérieur. Je l’observais de biais, il m’a presque fait peur. J’ai murmuré que tu allais nous manquer. Il m’a jeté ce regard méprisant qu’il me réserve toujours. Ton départ lui fait mal, vous êtes si proches tous les deux, mais je n’imaginais pas que c’était à ce point-là. Oncle Karl allait d’un pas pressé. Tu peinais à le suivre, tu marchais tête baissée. Oh, ma 16 douce, me diras-tu quelles étaient tes pensées ? Ton père est impressionnant. Pour tout te dire, je le trouve très laid avec son corps difforme à devoir faire tant d’efforts pour avancer ! Je sais, ce que je dis n’est pas chrétien, mais ton père a des manières de bête. Il est si silencieux. Il a le regard si sombre. Ne mens pas, je sais qu’il t’a fait peur aussi. D’un coup, tu es devenue trop sérieuse et tu t’es mise à parler à voix basse. Comme on fait dans la maison d’un mort. Et tu vois, ta valise était lourde. Elle te faisait pencher sur le côté et il n’a pas eu l’air de s’en apercevoir. D’autant qu’il n’a pas voulu prendre ce taxi que maman proposait de lui payer. Je ne supporte pas que tu retournes à une vie misé rable et qu’il refuse notre aide sous je ne sais quel prétexte... Ses principes sans doute. C’est ridicule ! A-t-il pensé à ta fierté ? Que peut-il comprendre de la vie à laquelle tu t’étais habi tuée ? Rien, il n’en imagine rien, j’en suis abso lument certaine. Dans quel endroit sinistre envisage-t-il de vous loger ? Je te connais, tu ne sais pas te plaindre, tu ne m’en diras rien mais je saurai deviner. Je n’aime pas ton père. Ce mépris qui suinte du moindre de ses gestes... Mais qu’est-ce qu’il nous reproche ? J’ai déjà posé la question à maman mais elle détourne les yeux avec ce léger signe de la main qui efface jusqu’au sentiment d’exister. À peine avais-tu disparu au coin de la rue que déjà l’ambiance à la maison n’était plus la même. J’ai d’abord cru que c’était ma soudaine solitude 17 qui rendait l’air irrespirable. Mais je me suis vite rendu compte que c’est toi qui nous faisais tenir ensemble. Maman ne quitte pratiquement plus sa chambre. Aujourd’hui, elle ne s’est même pas habillée. Elle est apparue au repas, dans son long peignoir de satin rose et gris, n’a rien dit, n’a regardé personne et elle a critiqué tout ce que Fanchette posait sur la table. Dès que papa ouvrait la uploads/Industriel/ trois-filles-en-colere-isabelle-pandazopoulos-gallimard.pdf
Documents similaires
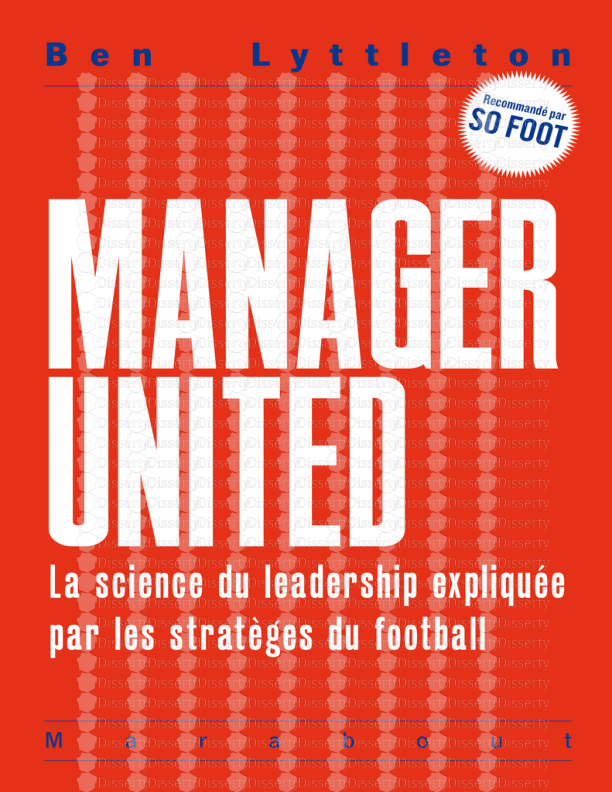

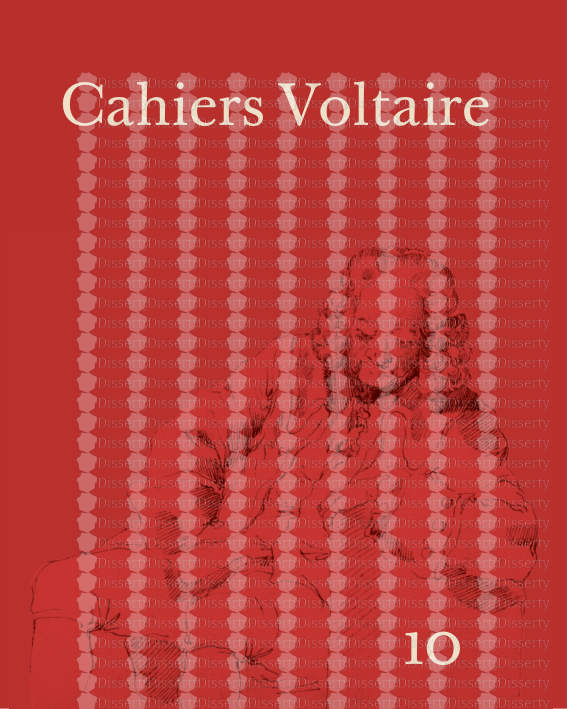







-
108
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 25, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 1.4565MB


