LA D I F F U S I O N DE LA L I T T É R A T U R E H I S P A N O - A M É R I C A
LA D I F F U S I O N DE LA L I T T É R A T U R E H I S P A N O - A M É R I C A I N E EN F R A N C E AU XXe SIÈCLE P U B L I C A T I O N S D E LA F A C U L T É D E S L E T T R E S E T S C I E N C E S H U M A I N E S DE P A R I S - S O R B O N N E Série « Recherches », tome 68 SYLVIA MOLLOY LA DIFFUSION DE LA LITTÉRATURE HISPANO-AMERICAINE, en France au XXe siècle O U V R A G E P U B L I É AVEC L E CONCOURS D U C . N . R . S . P R E S S E S UNIVERSITAIRES DE FRANCE 108, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS 1972 Dépôt légal. — Ire édition : 1er trimestre 1972 @ 1972, Presses Universitaires de France Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'ar- ticle 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute repré- sentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'au- teur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1 " de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. A la mémoire de mon père. Que soient ici remerciés : Monsieur le professeur Etiemble, qui me donna la première idée de cette étude et qui voulut bien diriger mes recherches, Monsieur le professeur Michel Berveiller, à qui je dois des conseils aussi généreux qu'efficaces, Madame Maria Luisa Bastos, dont les lectures intelligentes et attentives contribuèrent à donner une forme définitive à ce texte, l'Université de l'Etat de New York à Buffalo, l'Université de Princeton, et l'American Philo- sophical Society, dont l'aide libérale me permit de réviser et de compléter mon travail en France. Mesdames Valery Larbaud et Adelina del Carril de Güiraldes me permirent, de leur vivant, l'accès aux archives Larbaud et Güiraldes. Je rappelle ici leur générosité, ainsi que celle de tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, m'aidèrent à mener cet ouvrage à bon terme. AVANT-PROPOS A la fin du mois de juin 1966, lorsque je songeais à la forme définitive qu'allait prendre cet avant-propos, une révolution éclata en Argentine. Quand je dis qu'elle éclata j'exagère, car elle se déroula dans le calme le plus absolu, sans barricades, sans morts, sans coups de crosse, et surtout sans surprise : les révolutions, au cas où nous en douterions encore, étaient entrées dans le domaine de nos plus chères habitudes. Par pudeur, j'évitai de faire le compte de toutes celles qui s'étaient succédé, en Argentine et dans toute l'Amérique dite latine, depuis ces « cris » d'Ypiranga, du 25 mai et de l'abbé Hidalgo, qui nous persuadèrent que nous étions prêts pour la grande aventure et suffisamment responsables pour y faire face. Par pudeur, j'évitai donc les chiffres, mais je ne pus m'empêcher d'évoquer, de façon générale, cette longue suite de tâtonnements dont semble faite l'histoire de nos pays. Ce fut dans cet état de fâcheuse auto-commisération — « être Américain est déjà, en soi, quelque chose de pathétique », disait déjà Alfonso Reyes — que je me disposai à présenter une thèse sur la diffusion de la littérature hispano-américaine en France. Quelle idée, me demandai-je encore une fois, peut se faire un Français de cette littérature-là ? Inutile de lui demander un jugement qui porte exclu- sivement sur cet ensemble d'ouvrages — restreint mais somme toute assez digne — qui la composent. En abordant, en découvrant une littérature nouvelle — j'entends d'un autre pays, voire d'un autre continent — le lecteur l'embellit, la modifie, la corrige déjà dans son esprit. Il n'est pas d'asepsie en lecture : entre le lecleur et son livre viennent se placer l'idée qu'il a du monde dont le livre est sorti et même l'idée qu'il a déjà de ce livre. C'est un combat plus qu'un dialogue, tous deux, livre et lecteur, demandant dans celle première rencontre la soumission de l'autre : le lecleur veut que le livre le confirme dans ses soupçons ; le livre voudrait imposer au lecteur une réalité nouvelle. J'essaie d'arrêter une image de l'Amérique latine, celle que peut avoir le lecteur français moyen. Ce lecteur ne voit certainement pas là ce qu'il voit depuis bientôt deux siècles chez les Américains du Nord : une nouveauté mondiale qui croît et se développe de façon cohérente. Il voit par contre, comme dit Oclavio Paz, « des survivances et des fragments d'un tout défait », les fragments de l'ordre impérial qui ne fut pas remplacé par un ordre nou- veau. Il y voit, ce lecteur, un continent qui peut se vanter d'avoir plusieurs noms dont aucun, à strictement parler, ne correspond exactement à la réalité ; un ensemble de pays ayant reçu, à des époques diverses, des courants de colonisation divers qui résolurent, chacun à sa manière, les problèmes que pouvaient poser des colonisés à leur tour fort différents et dont certains avaient atteint un niveau de civilisation non dédaignable ; des pays ayant subi, par la suite, l'influence d'une immigration variée au point d'aboutir « à celle chose brutale qui s'appelle une expérience raciale, plutôt une violence raciale », comme disait Gabriela Mistral; des pays qu'on peut grouper en un tout, en raison de quelques problèmes — certes non les moindres — qu'ils ont en commun, mais qu'on est obligé de séparer dès qu'il s'agit de certains autres ; des pays qui parlent tous la même langue, oui, pourvu qu'on écarte la quasi-moitié du continent qui parle portugais, ce qui remet tout en question ; des pays qui proposent simultanément, en un raccourci saisissant, les stades de civilisation les plus disparates ; des pays qui continuent souvent — par les contacts difficiles, par les énormes distances, par des difficultés de tout ordre, par aboulie aussi bien que par orgueil — à s'ignorer entre eux ; des pays enfin qui, forts de celle vocation d'avenir qu'on a bien voulu leur attribuer, ne savent pas toujours rendre le présent viable sur le plan politique et social. Tout ceci est pour le moins déconcertant, confus. Combien plus cohérente l'image que se plut à forger jadis l'Europe, pieusement entretenue par Chateaubriand, par Hugo, par Mérimée et par Gustave Ayr-riard ! Car le mythe exotique, « la fantaisie d'Amérique » au dire d'Alfonso Reyes, a une place, et certes non la moindre, dans l'image finale que se fait le lecteur français du monde latino-américain. En fait de littérature et de nationalité, on peut dire en France du verbe être ce qu'il échappa à cet abbé ami de Barrès de dire de Dieu : on emploie le mot si souvent qu'on ne sait plus trop bien l'idée qu'on met là-dessous. La Jeune Parque est un poème français, Proust est un écrivain français; le verbe êlre sert tout au plus à signaler l'équation, et son plein sens n'est rappelé qu'en des moments de crise. Il en est tout autrement pour l'Amérique latine. Nous ne sommes pas loin de l'époque où la littérature latino-américaine s'efforçait tout simplement d'être. Vinrent ensuite les théoriciens qui lui demandèrent par surcroît d'être latino-américaine : exigence d'autant plus dure à satisfaire que les maîtres, après avoir arrêté leur devise, se perdaient dans la naïveté et dans les grands mots. Indifférente à ces chicanes et à ces consignes, qui ne touchent que les plus faibles, la littérature suivit son chemin à sa guise : en se faisant, elle devenait, elle est devenue, cela va de soi, latino-américaine. Le lecteur français, lui, n'accepte pas toujours que cette littérature soit naturellement et non essentiellement latino-américaine. Sitôt les liens coupés qui l'unissaient à l'Espagne et au Portugal, elle se doit, paraît-il, de fournir ces preuves de son existence qu'on ne cesse de lui réclamer. Des preuves dont la nature est connue d'avance au lecteur français : soyez latino- américaine revient à dire donnez-nous ce que nous attendons de vous. Car on connaît l'histoire : l'Europe inventa l'Amérique et celle-ci lui échappa des mains; demander à sa littérature d'être américaine c'est lui demander de se conformer à celle vision originelle qu'elle avait de ce monde nouveau et que la réalité s'est chargée de détruire. Peut-être (sans doute même) ces obstacles — images préconçues, diffi- cultés d'un contact direct, manque de renseignements — se posent-ils en toute découverte lilléraire, mais ils uploads/Industriel/ sylvia-molloy-la-difusion-de-la-litterature-hispano-americaine-en-france-au-xx-siecle.pdf
Documents similaires






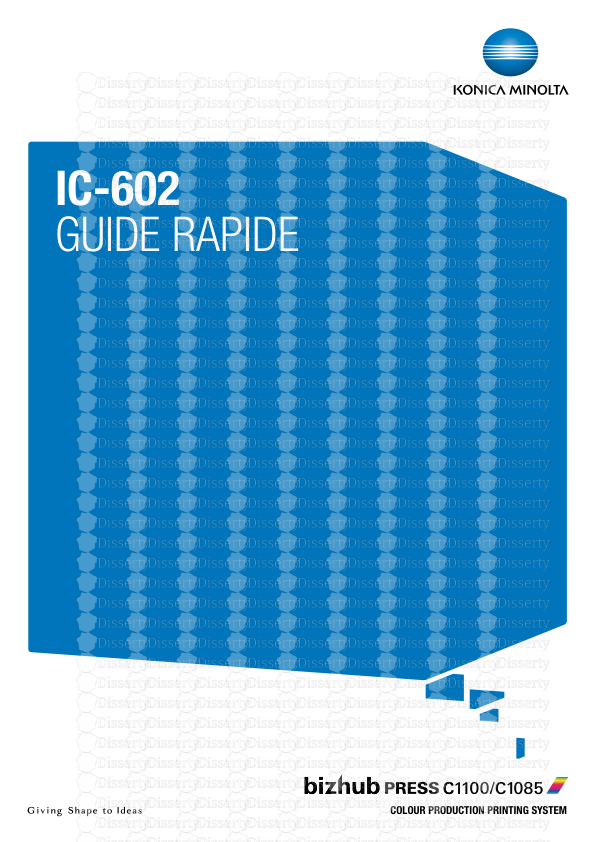



-
43
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 07, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 6.0434MB


