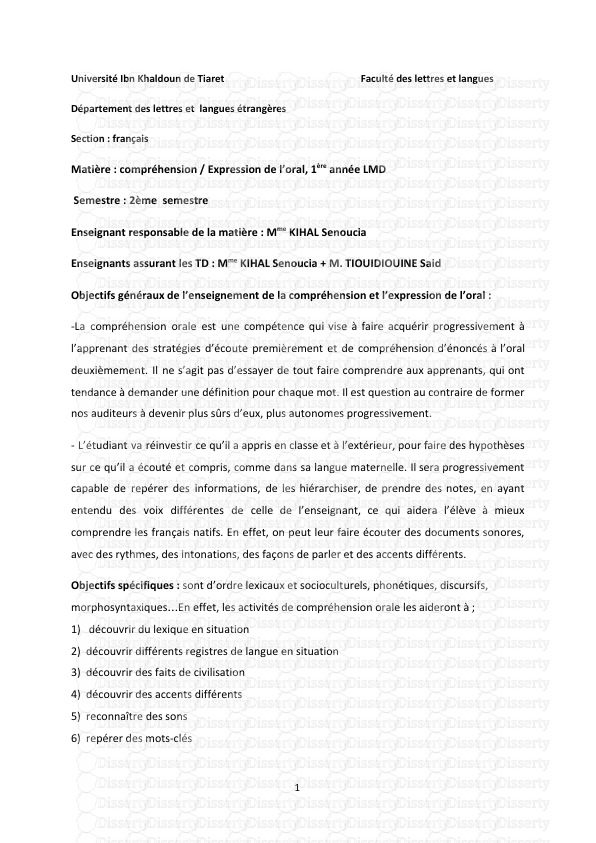Université Ibn Khaldoun de Tiaret Faculté des lettres et langues Département de
Université Ibn Khaldoun de Tiaret Faculté des lettres et langues Département des lettres et langues étrangères Section : français Matière : compréhension / Expression de l’oral, 1ère année LMD Semestre : 2ème semestre Enseignant responsable de la matière : Mme KIHAL Senoucia Enseignants assurant les TD : Mme KIHAL Senoucia + M. TIOUIDIOUINE Said Objectifs généraux de l’enseignement de la compréhension et l’expression de l’oral : -La compréhension orale est une compétence qui vise à faire acquérir progressivement à l’apprenant des stratégies d’écoute premièrement et de compréhension d’énoncés à l’oral deuxièmement. Il ne s’agit pas d’essayer de tout faire comprendre aux apprenants, qui ont tendance à demander une définition pour chaque mot. Il est question au contraire de former nos auditeurs à devenir plus sûrs d’eux, plus autonomes progressivement. - L’étudiant va réinvestir ce qu’il a appris en classe et à l’extérieur, pour faire des hypothèses sur ce qu’il a écouté et compris, comme dans sa langue maternelle. Il sera progressivement capable de repérer des informations, de les hiérarchiser, de prendre des notes, en ayant entendu des voix différentes de celle de l’enseignant, ce qui aidera l’élève à mieux comprendre les français natifs. En effet, on peut leur faire écouter des documents sonores, avec des rythmes, des intonations, des façons de parler et des accents différents. Objectifs spécifiques : sont d’ordre lexicaux et socioculturels, phonétiques, discursifs, morphosyntaxiques…En effet, les activités de compréhension orale les aideront à ; 1) découvrir du lexique en situation 2) découvrir différents registres de langue en situation 3) découvrir des faits de civilisation 4) découvrir des accents différents 5) reconnaître des sons 6) repérer des mots-clés 1 7) comprendre globalement 8) comprendre en détails 9) reconnaître des structures grammaticales en contexte 10) prendre des notes… Liens utiles : 1. www.lepointdufle.net 2. www.cle-inter.com 3. www.fle.hachette-livre.fr 4. www.didierfle.com Leçon n°1 Les types de communications orales sans échange Caractéristiques générales Il s’agit en fait de diffuser des messages à l’attention d’auditeurs : -absents et éloignés (radio, télévision) ; -présents et proches (théâtre, cours magistral, conférence, discours). Nous n’envisagerons pas ici en détail la situation de communication d’un individu à une foule. Cette situation fait intervenir des facteurs assez complexes de psychologie des foules. Néanmoins, les qualités d’un orateur ou d’un tribun doivent se retrouver au niveau de la communication à des petits groupes. Il s’agit : 1. de caractériser le public, destinataire du message : -nombre de personnes : -composition (appartenance sociale, âge, sexe, etc.) -circonstances de rassemblement du groupe (l’orateur aura plus de mal à soutenir l’attention d’un groupe constitué par force que celle d’un groupe spontané) ; -code commun et valeurs communes (il faut parler le langage du destinataire). 2. de préciser la nature et les conditions de la communication : -nature du message (information simple, exposé documentaire, communication scientifique, discours de circonstance, exposé d’opinion) ; 2 -condition de la communication (lieu, moyens matériels mis à la disposition, temps imparti, public). 3. de montrer des qualités : -de voix, de diction, de modulation, de débit ; -de présence (et particulièrement de veiller à son comportement corporel et gestuel) ; -d’adaptation au destinataire et aux circonstances (donc d’être capable d’improvisation) ; -de maitrise de soi et de son sujet. Ainsi, la communication orale se caractérise par l’importance des éléments conatifs qu’elle met en jeu :le destinataire ne doit jamais être négligé ,voire oublié au profit du message .Il faut donc s’imposer au groupe ,par l’intérêt du message certes, mais surtout par le mode de présentation . Nous examinerons plus particulièrement la technique de l’exposé Le style de l’exposé oral Il se caractérise par une sorte de compromis entre la langue parlée et la langue écrite. Par son contenu, sa structure et la nature de sa préparation, l’exposé s’apparente à la communication écrite, il suppose en effet : -une présentation sérieuse, la réunion et la mise au point d’une documentation, l’élaboration d’un plan ; -une recherche de la correction du vocabulaire et de la syntaxe, la suppression des négligences de style, des formes trop familières voire vulgaires de la langue parlée courante. Mais dans sa réalisation, l’exposé s’apparente bien à la communication orale : 1. Il est dit, mais non lu : la lecture d’un exposé ne peut être suivie de l’auditoire : -parce que les informations apportées par un texte écrit sont beaucoup trop nombreuses alors que les informations apportées par un texte parlé sont délayées dans les redondances, les répétitions, les pauses et, par là même ; beaucoup plus accessibles ; -parce que la lecture « efface la personnalité de l’orateur, qui ne regarde plus son public et se coupe du groupe ; -parce que la lecture exclut les modes de communication non verbaux indispensables pour maintenir le contact : regards, gestes, expression corporelle. -Il comprend certains éléments expressifs propres à la langue parlée : intonation, accents, pauses, etc. En somme, le caractère « écrit de l’exposé doit être corrigé par le souci apporte à rétablir sa nature orale. Conseils pratiques -choisir un sujet ; 3 -rassembler une documentation ; -définir les limites du sujet ; -établir un plan ; -ne pas rédiger l’exposé, établir, en style télégraphique, le plan détaillé de l’exposé ; écrire ce plan sur des feuilles de grand format (21/27) dont on ne remplira que le recto (le verso sera barré d’une grande croix) et que l’on numérotera. Les moments où l’on prévoit de recourir à des documents (citations, graphiques, photographies, documents sonores, etc.) seront marqués sur ce plan (d’une encre différente ) ; -préparer la documentation : marquer d’un repère au crayon les citations, classer les documents à part dans l’ordre où ils seront utilisés, prévoir le mode de présentation de ces documents ; -s’assurer que l’exposé ne dépassera pas le temps imparti. Leçon n°2 Au moment de l’exposé : Inscrire au tableau le plan non détaillé, puis conduire l’exposé en s’aidant du plan détaillé : 1. Introduire le sujet ; susciter l’intérêt en soulignant l’importance ou l’originalité du thème ; montrer qu’il concerne l’auditoire ; intéresser le groupe à la façon dont vous avez abordé le problème. 2. Mener l’exposé en soulignant les articulations du plan. 3. Utiliser avec intelligence la documentation ; en particulier : veiller à ce qu’elle ne distraie point du contenu de l’exposé (ainsi tel exposé sur l’impressionnisme n’est plus écouté à partir du moment où l’on fait circuler des reproductions). 4. Conclure en récapitulant ce qu’on se proposait de faire et en exprimant l’intérêt qu’on a trouvé au travail. En cours d’exposé : -être vivant, concret, convaincu ; -écrire au tableau les mots rares ou inconnus ; -tracer croquis, schémas ou graphiques sans cesser de parler, en expliquant ce qu’on fait ; -contrôler l’auditoire, son comportement, ses réactions ; y adapter son débit, ses intonations, ses attitudes ; -si possible, favoriser le feed-back surtout en fin d’exposé. Le plan 4 Le plan est capital pour la réussite de l’exposé .Du plan dépendent la réception et la compréhension des informations et des idées exprimées. Les différentes parties du plan doivent s’enchaîner : -de façon logique ; -de manière à opérer une progression dans le développement du sujet. La façon la plus claire et la plus suggestive de bâtir un plan est de partir d’une question ou de l’énoncé d’un problème. A partir de cette question ou de l’énoncé de ce problème, le plan sera construit sur les réponses apportées, réponses qui s’enchaîneront logiquement et conduiront à un approfondissement progressif de la question. Le schéma de base de l’exposé « problématique »se présente ainsi : 1. Description et analyse des éléments du problème. 2. Détermination des critères suivant lesquels la solution doit être choisie. 3. Explication et évaluation de la (des)solutions(s). Il est certain que la formulation de la question définit le cadre et les limites de l’exposé. En fait, il n’existe pas de plan type puisque le meilleur plan est celui qui s’adapte parfaitement : -au sujet choisit et au problème posé, -à la façon de considérer le sujet c’est-à-dire au point de vue personnel adopté par l’auteur de l’exposé. L’essentiel est donc de définir au départ ce sujet et ce point de vue (ce sera le rôle de l’introduction), et de ménager l’équilibre des parties ainsi que la progression de l’exposé. Exemple Soit un exposé sur le sujet suivant : La corrida .Le plan dépend du point de vue adopté. 1. Point de vue historique : Le plan sera chronologique ; l’exposé retracera les origines de la corrida et ses fonctions .Il étudiera l’aspect actuel de la corrida en référence au passé, aux traditions, au folklore, aux influences diverses. 2. Point de vue technique : 5 Le plan sera tout autre. Les différents éléments de la corrida seront passés en revue. Il sera difficile de construire un plan progressif, mais on pourra par exemple, passer de l’animal (élevage et préparation des taureaux), à l’homme (les écoles de toreros), de la technique proprement dite à l’art de la tauromachie (passes). 3. Point de vue sociologique : Partant de rappels historiques nécessaires, l’exposé conduira à l’analyse de la uploads/Ingenierie_Lourd/ 1ere-annee-licence-ceo-cours-et-td.pdf
Documents similaires










-
56
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 16, 2021
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2445MB