Guy Le Gaufey La feinte mystique « La Fable mystique, xvie-xviie siècles » est
Guy Le Gaufey La feinte mystique « La Fable mystique, xvie-xviie siècles » est un titre ambigu dans la mesure où il conjoint la forme la plus usuelle du référent historique (xvie-xviie siècles), et un substantif inhabituel, cette « Fable » si peu fiable aux yeux de l’historien, qui n’est guère homme de tradition orale. Au regard de l’assertion d’existence que comporte la plupart des titres, celui-là sonne faux, délibérément : quelque chose a existé (aux xvie-xviie siècles, donc), mais c’était (c’est ?) une « fable ». Le lecteur découvre vite au fil du livre que ce positionnement de l’adjectif « mystique » entre ce qui atteste indirectement l’existence (le repérage temporel) et ce qui suspecte cette même existence (« Fable ») est l’essentiel de la thèse de Michel de Certeau quant au sujet qu’il avance : la mystique aux xvie et xviie siècles, certes, mais « entre centre et absence ». Et puisque notre auteur nous avertit dès le départ qu’un tel sujet ne peut être qu'« encadré », prenons d’abord la précaution de bien lire le cadre de son travail, dans sa matérialité livresque, soit : le début de l’introduction (p. 9-11) — qui fait « ouverture » au sens musical du terme — et « l’ouverture à une poétique du corps » qui, contrairement à son appellation, est placée en guise de conclusion, et fonctionne en « da capo ». Isolées typographiquement, ces deux brefs textes se présentent comme hétérogènes au reste de l’ouvrage ; mais c’est bien à ces fragments extrêmes que le lecteur a tendance à revenir une fois sa lecture achevée, en questionnant par un effet de boucle les emplacements où l’auteur de ce travail sur l’énonciation a tenté la mise en scène de son propos. Curiosité : l’auteur résistera-t-il au livre qu’il a enfanté ? D’où entend-il parler de ceux qui parlent… de Lui ? Comme l’objet qu’elles visent, ces questions restent sur les marges de l’entreprise, et une critique doctement universitaire — que le livre appelle aussi — pourra ne même pas les rencontrer. En auteur avisé, M. de Certeau n’aura écrit son début d’introduction qu’après avoir écrit la majeure partie de son travail. Quoiqu’il en soit, il est frappant de rapprocher le paragraphe 2 du chapitre VI (« Le « je », préface de la Science expérimentale (J.J. Surin) ») et les trois premières pages du livre. Si M. de Certeau cite longuement le texte-préface de J.-J. Surin, c’est pour y décortiquer le mode d’apparition de la première personne grammaticale qui leste l’énonciation. Enquête d’autant plus justifiée que le mystique entreprenant de parler « hors- institution », mais au nom de la même Vérité révélée que celle défendue par les institutions religieuses, il importe toujours qu’il situe ce « je » d’où l’énonciation va sourdre (cf. à ce sujet tout le chapitre 5-2 : « Un préalable : le « volo » de Maître Eckhart à Mme Guyon »). Surin, fort habilement, ne s’autorise à dire qu’au nom d’une « expérience » qui le place à la fois dans la tradition chrétienne et hors chronologie. M. de Certeau insiste à juste titre sur ce positionnement singulier. Mais, en se livrant au même exercice que Surin, qu’écrit-il en ce qui le concerne ? Ce livre se présente au nom d’une incompétence : il est exilé de ce qu’il traite. L’écriture que je dédie aux discours mystiques de (ou sur) la présence (de Dieu) a pour statut de ne pas en être. Plus avant dans son livre, M. de Certeau nous donne sa traduction d’un passage des Demeures (I, 1) de sainte Thérèse : « Vous devez comprendre — écrivait-elle en s’adressant à ses novices pour leur décrire le cœur de ce château qu’est l’âme — qu’il y a une grande différence entre y être et y être. » Gageons qu’il existe aussi une belle différence entre « ne pas en être » et « ne pas en être ». Plus encore : si ce livre en effet est bien « exilé de ce qu’il traite », et si ce qu’il traite, ce sont les textes mêmes de l’exil (La Fable dixit), quelle est donc cette figure de rhétorique de l’exil redoublé, de l’exil de l’exil ? Il ne cesse de s’écrire, précise M. de Certeau à propos de son travail, en voyages dans un pays dont je suis éloigné. A préciser le lieu de sa production, je voudrais éviter d’abord à ce récit de voyage le « prestige » (impudique et obscène dans son cas) d’être pris pour un discours accrédité par une présence, autorisé à parler en son nom, en somme supposé savoir ce qu’il en est. Mais quand l’Unique revient (avec sa majuscule), il est présenté comme hantant « nos lieux » : Ces auteurs anciens introduisent dans notre actualité le langage d’une « nostalgie » relative à cet autre pays… Ils articulent ainsi une étrangeté de notre propre place, et donc un désir de partir au pays. Les mystiques, en somme, nous parlent au présent, écrit celui qui va parler d’eux. Je reviendrai par la suite sur ce bouclage qui s’instaure ici avec le fonctionnement référentiel, et même déictique, dans le langage : je vous parle d’eux, eux qui parlent de Lui, Lui qui est absent, absent pour je qui vous parle… C’est là le « tour rhétorique » de M. de Certeau dans son introduction. Il écrit encore, à propos des mystiques et en se référant au Kafka de Devant la Loi : A mon tour, semblable à l’homme de la campagne chez Kafka, je leur ai demandé d’entrer. Délicate ambiguïté du français qui confond dans l'« hôte » celui qui arrive, l’invité, et celui qui reçoit chez lui, le maître de céans. « Puis-je entrer ? » dit une voix ; « Mais entrez donc ! » répond l’autre (sur le ton qu’on voudra). Au passage, sur le seuil, le verbe « entrer » a su porter deux demandes : celle du pénitent-voyageur, celle de l’impénitent-sédentaire. Or, en un tour de main constant, M. de Certeau fait pivoter ces deux figures dès que l’occasion se présente : qualifier de « piétinement » sa recherche et son travail, c’est invoquer à la fois la marche et l’immobilité, le pied qui frappe et la piété suspendue : l’irritation de ce qui n’aboutit pas. Que penser de cette « clarté » qui « serait peut-être l’éclat même d’un désir venu d’ailleurs » ? Réponse : « Elle ne se donne ni au travail ni à l’âge. Elle est testamentaire : c’est un baiser de la mort. » Quelle perspective ! Mais, avec un peu de patience, nous voici rassérénés en arrivant à la page… 230 où l’on peut lire : …] les discours mystiques postulent, pour être lus, une demande qu’ils ne peuvent satisfaire ; ils font de la déception du lecteur le mode sur lequel le texte doit être pratiqué. Cette tension introduit déjà un style « mystique » dans la pratique (productrice et liseuse) du texte. Alors ? Michel de Certeau mystique ? Certes, il n’est pas, selon son propre dire, « supposé savoir ce qu’il en est » (de la présence, cf. supra). Mais c’est le cri du mystique de base ! (Si du moins, nous, nous en croyons La Fable.) Pour articuler cette plainte, il suffit en effet de désigner dans l’autre avant tout la présence — qui par définition fuit — et dès lors ce « toi », à force de se répéter dans sa dérobade, accède à la majuscule : Toi. Puissance de l’oraison. Nous voici donc, en tout cas, introduit avant même le paragraphe 1 de l’introduction dans un « tour mystique » (selon une expression de la page 208). La scène est dressée : la face cachée des choses va pouvoir nous être montrée, leur « présence » n’en restera pas moins obnubilante, et secrète. Courrons donc au final, à cette « Ouverture à une poétique du corps » qui clôt ce premier tome de La Fable : elle a un bien curieux statut si on ne la lit pas en regard du début de l’introduction. Ce poème de Catherine Pozzi est chez lui, certes, après Thérèse, Surin, Diègo, etc. (sans oublier, discrètement posé, Yves Bonnefoy et sa poésie hauturière de la nostalgie de l’Un) ; mais le commentaire sur ce poème n’est pas du registre de la longue étude qui précède. En cette conclusion, l’analyse du texte mystique, du texte qui dit l’absence, fait place — via la poésie — à sa célébration ; l’analyse cède le pas à une finalité qui n’est plus de savoir. P. Valéry notait qu’il est des paroles « qui nous intiment de devenir bien plus qu’elles ne nous incitent à comprendre » : la conclusion-ouverture est de ce bord-là, tout comme ses premières pages. Aux mystiques, écrivait-il alors, « j’ai demandé d’entrer ». Il conclut maintenant (p. 411) : « Il [le désir] n’habite nulle part. Il est habité » : nomade-sédentaire. Dieu n’y est uploads/Litterature/ 25-la-feinte-mystique-pdf.pdf
Documents similaires

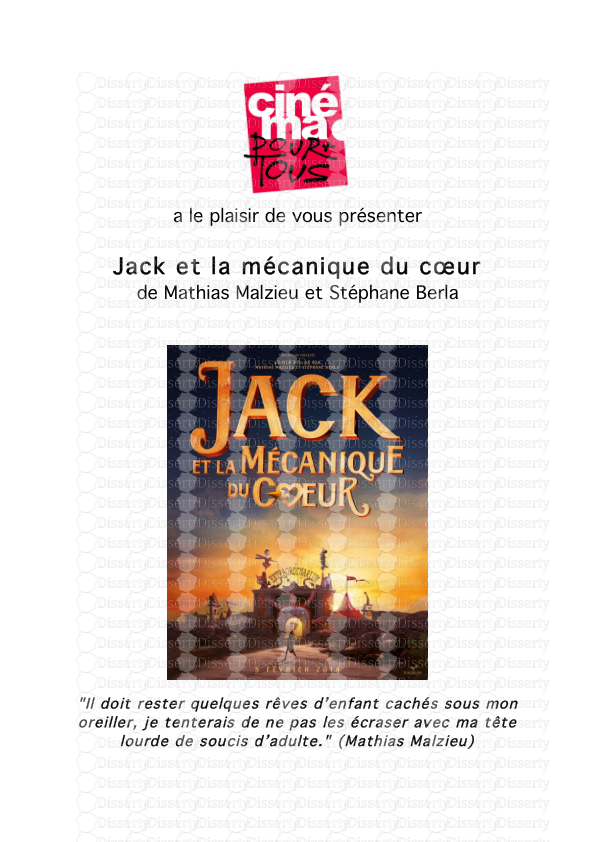








-
89
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 14, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1091MB


