209 Fattah Adrar Doctorant, Université de Béjaia Abstract: Starting from this q
209 Fattah Adrar Doctorant, Université de Béjaia Abstract: Starting from this questioning: why aren’t we able to read for Assia Djebar as we do it with other authors of her generation as Mammeri, Dib, Feraoun, etc.? Our interest focuses on one of the aspects witch makes the singularity of this writer: the non likeness of the work writhe the horizon of generic and socio-historical expectation. Reading process is there fore snapped, thematic goes beyond the expectation of causal and chronological story. Writing frees the frontiers and operates a mixture of forms. Then, reading becomes a deconstruction/reconstruction game of a textual puzzle. Keywords: Genre, Romance, Autobiography, Assia Djebar, Writing, Algerian literature. اﻟ ﻣﻠﺧص : اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣن اﻹﺷﻛﺎل ﻟﻣﺎ ذ ا ﻻ ﻧﻘرأ أﺳﯾﺎ ﺟﺑﺎر ﻛﻣﺎ ﻧﻘرأ ﺑﻘﯾﺔ اﻷدﺑﺎء ﻣن ﺟﯾﻠﮭﺎ ﻛﻣﺣﻣد دﯾب أو ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري أو ﻣوﻟود ﻓرﻋون ارﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﻧدرس ﻓﻲ ھدا اﻟﻣﻘﺎل ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ آﻻ وھﻲ ﻋدم ﺗواﻓق اﻟﻧص اﻷدﺑﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ وﻋد ﻧﺎﺗ ﺑﮫ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻷدﺑﯾﺔ ﻣن ﺣﯾ ث اﻟﺻﻧ ف اﻷدﺑﻲ ﻣن ﺟﮭﺔ ﻛذﻟك ﻣن ﺣﯾت ﻣﺿﻣون اﻟﻧص وﻋﻼ ﺗﮫﻗ ﺑﺎﻟﺳﺎﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ .و ﻋﻠﯾﺔ ﻓﺎن ﻋﻘد اﻟﻘراءة ﻗد ﻓﺳﺦ إن . ﻣﺿﻣون اﻟﻧص ﯾﺿرب ﻋرض اﻟﺣﺎﺋط ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺟزاﺋري ﺑﺣﯾث ﯾﻣزج ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻹﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧص ﻟﯾﺗﺳن ﻟﮫ ﻓﮭم اﻟﻣﺿ ﻣون . اﻟ ﻛﻠﻣﺎت اﻟ ﺣﯾﺔﺎﻣﻔﺗ : ﺻﻧف أدﺑﻲ اﻟ رواﯾﺔ اﻟ ، ﺳﯾرة اﻟ ذاﺗﯾﺔ اﻷ ، دب اﻟ ﺟزاﺋر، اﻟ ﻛﺗﺎﺑﺔ . Synergies Algérie n° 5 - 2009 pp. 209-215 Vaste est la prison d’Assia Djebar : du genre biologique au genre littéraire Résumé : Partant du questionnement : pourquoi n’arrivons-nous pas à lire Assia Djebar tel que (comme) nous lisons d’autres auteurs de sa génération : Mammeri, Dib, Feraoun… ? Notre intérêt s’est porté sur un des aspects qui fait la singularité de cette écrivaine : la non conformité de l’oeuvre avec l’horizon d’attente générique et sociohistorique. Le contrat de lecture est, dès lors, rompu; la thématique va au delà de l’attente d’une histoire chronologique et causale. L’écriture décloisonne, ainsi, les frontières et opère un mélange des formes. La lecture devient, alors, un jeu de déconstruction/ reconstruction du puzzle textuel. Mots-clés : Genre, Roman, Autobiographie, Assia Djebar, Ecriture, Littérature algérienne. 210 1. Une écriture d’un « nouveau genre » Chez Assia Djebar, l’écriture est d’abord perçue comme l’expression d’une « révolte », celle d’une femme dépourvue de liberté dans une société traditionnelle. On le voit bien, dès ses premières publications. Son œuvre tire son originalité non seulement du fait qu’elle est femme1 et qu’elle s’exprime dans une période où peu de femmes écrivent (le contexte des années cinquante), mais aussi de la thématique subversive qui ne s’inscrit pas dans la même tradition que celle des auteurs algériens de sa génération, dans une forme assez singulière. La genèse de ses premières œuvres2 est expliquée par sa volonté de « présenter la caricature de la jeune fille algérienne occidentalisée », et est considérée par l’écrivaine elle-même comme « un exercice de style »3. Leur réception n’a pas été toujours saluée par la critique. Jean Déjeux parle de « littérature esthétique née d’un besoin individualiste de s’exprimer et de créer ou d’un besoin égotiste de se dire dans ses états d’âmes intimes »4, tandis que Mostepha Lacheraf, qui incarne l’intellectuel engagé de l’époque, stigmatise les premières œuvres d’Assia Djebar: « Il faut démystifier, dit-il : Malek Haddad, Assia Djebar sont des écrivains qui n’ont jamais saisi nos problèmes, même les plus généraux. Ils ont tout ignoré, sinon de leur classe petite bourgeoise, du moins de tout ce qui avait trait à la société algérienne ; de tous les écrivains algériens, ce sont eux qui connaissent le moins bien leurs pays, ce qui les pousse à escamoter les réalités algériennes sous une croûte poétique, elle- même sans originalité du point de vue du roman »5. A cette époque, on reprochait souvent à Assia Djebar le fait de rester en retrait par rapport au contexte politique et social. Ceci est dû, en partie, au caractère « petit-bourgeois » des personnages de ses premiers romans dont les intérêts et les préoccupations ne sont pas ceux que fait voir le contexte « réel », selon la critique de l’époque. Cependant, elle va s’orienter vers d’autres contenus et vers d’autres choix formels. Progressivement ses romans se chargent d’Histoire et elle va montrer une prédilection pour la forme littéraire éclatée, le mélange des genres. Ceci est particulièrement visible dans Vaste est la prison, texte publié au milieu des années 90. Les passages de l’ouverture et la clôture font référence à la violence du contexte de ces années de sang. Ceci non seulement par un désir de mémoire puisque les événements concernent aussi l’époque antique de l’Afrique du Nord en parallèle avec l’histoire récente de l’Algérie, mais pour chercher dans le passé6 de l’Algérie une explication à l’horreur du présent, dans un va-et-vient constant. Tous les textes produits après l’Amour la fantasia ont comme toile de fond l’Histoire de l’Algérie au passé et au présent. Les thèmes historiques qu’elle aborde dans ses fictions ont tous un lien référentiel avec le présent. Sa formation d’historienne a été d’une grande influence sur sa production romanesque. Mais son originalité vient surtout du fait qu’elle reprend des passages de l’histoire de l’Algérie à travers la mémoire féminine, réservoir inépuisable dans la tradition Synergies Algérie n° 5 - 2009 pp. 209-215 Fattah Adrar 211 algérienne à dominante orale. A ce sujet, il serait intéressant de rappeler le jugement d’Assia Djebar sur elle-même à l’occasion de son discours de réception du Prix des éditeurs allemands en 2001 : « Je voudrais me présenter devant vous comme simplement une femme-écrivaine, issue d’un pays, l’Algérie tumultueuse et encore déchirée. J’ai été élevée dans une foi musulmane, celle de mes aïeux depuis des générations, qui m’a façonnée affectivement et spirituellement, mais à laquelle, je l’avoue, je me confronte, à cause de ses interdits dont je ne me délie pas encore tout à fait. J’écris donc, et en français, langue de l’ancien colonisateur, qui est devenue néanmoins et irréversiblement celle de ma pensée », et à propos de son écriture elle ajoute : « je ne me sais qu’une règle (…) : ne pratiquer qu’une écriture de nécessité. Une écriture de creusement, de poussée dans le noir et l’obscur ! Une écriture « contre » : le « contre » de l’opposition, de la révolte, quelquefois muette, qui vous ébranle et traverse tout votre corps »7. Ainsi donc, dans le paysage littéraire algérien, l’écriture chez Assia Djebar apparaît comme une écriture spécifique. Son rapport à la vie quotidienne de son pays, malgré son exil, est toujours resté étroit. Grâce au travail sur les formes génériques, elle crée un nouvel effet de réel pour réaliser cette « écriture de creusement » dont elle parle et qui constitue son style. Un style qui, toutefois, n’est pas dépourvu d’une ambiguïté : le lecteur passe par plusieurs détours avant de trouver le sens de l’histoire. En clair, ce n’est pas à un premier niveau de lecture que l’œuvre « s’ouvre » au lecteur. 2. Ni fiction, ni autobiographie Chez Assia Djebar, cerner l’œuvre du point de vu générique n’est pas une chose aisée. L’horizon d’attente est brouillé. Les ruptures sont constantes tout au long du roman, et il y a un décalage entre le texte de l’œuvre et ce qu’on appelle le paratexte : le sous-titre « roman » et l’épitexte où Assia Djebar classe son quatuor dans le genre autobiographie. Ces deux éléments paratextuels expliquent ainsi, la confrontation entre un horizon d’attente générique et le corps du texte lui-même. Le premier, le sous-titre « roman » est, selon Genette, théoriquement « destinée à faire connaître le statut générique intentionnel de l’œuvre »8. Cet élément paratextuel qui détermine toute attente est primordial dans l’orientation générique de l’œuvre qu’on s’apprête à lire puisque la première impression est déjà là. Comme le signale Goldenstein, «la série des signes inauguraux détermine un véritable contrat de lecture. »9 L’œuvre est à considérer dans une catégorie dont les règles sont connues. Le roman est d’abord une fiction, une histoire régie par une des fonctions que Jakobson confère au langage littéraire, la fonction poétique. Il est clair que depuis sa naissance, le roman a acquis ce qu’on appelle en sémantique des sèmes définitionnels, jusqu’à devenir à l’époque actuelle un genre « fourre- tout ». Pour éviter cette ambiguïté définitionnelle, référons-nous à deux éléments qui ne sont pas négligeables dans toute étude générique du roman : Premièrement, le roman comme genre a acquis ses lettres de noblesse au dix- neuvième siècle. C’est par rapport au roman réaliste du dix-neuvième siècle Vaste est la prison d’Assia Djebar : du genre biologique au genre littéraire 212 qu’on situe le roman moderne dans la transgression ou la conformité comme le constate Yves Reuter : « le XIX siècle est bien l’époque où le roman se constitue en référence. », ceci parce que c’est à cette époque que le roman s’est constitué comme genre codifié. En second lieu, uploads/Litterature/ adrar.pdf
Documents similaires








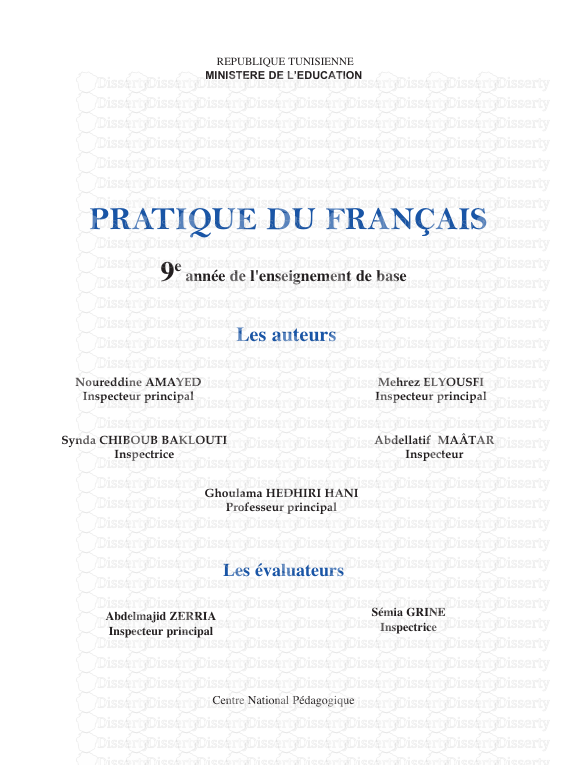

-
36
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 15, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3221MB


