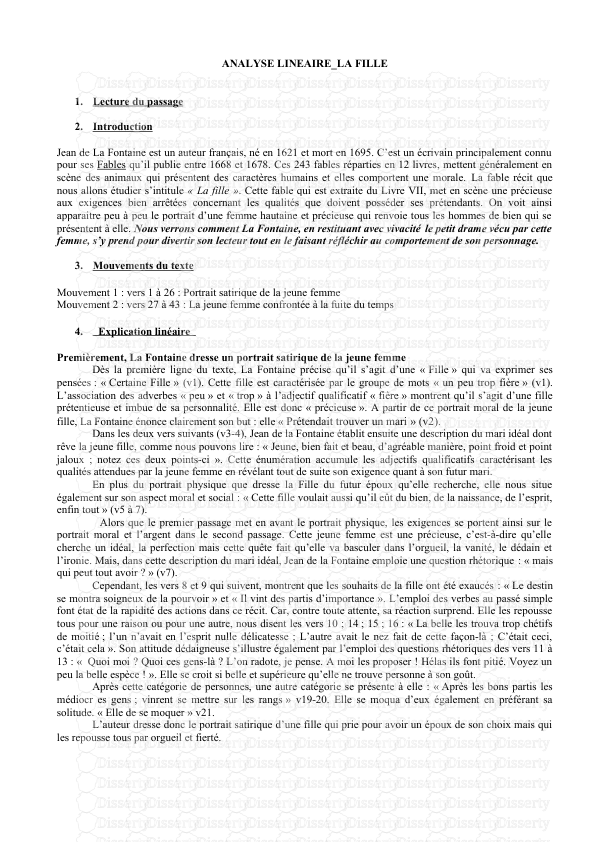ANALYSE LINEAIRE_LA FILLE 1. Lecture du passage 2. Introduction Jean de La Font
ANALYSE LINEAIRE_LA FILLE 1. Lecture du passage 2. Introduction Jean de La Fontaine est un auteur français, né en 1621 et mort en 1695. C’est un écrivain principalement connu pour ses Fables qu’il publie entre 1668 et 1678. Ces 243 fables réparties en 12 livres, mettent généralement en scène des animaux qui présentent des caractères humains et elles comportent une morale. La fable récit que nous allons étudier s’intitule « La fille ». Cette fable qui est extraite du Livre VII, met en scène une précieuse aux exigences bien arrêtées concernant les qualités que doivent posséder ses prétendants. On voit ainsi apparaitre peu à peu le portrait d’une femme hautaine et précieuse qui renvoie tous les hommes de bien qui se présentent à elle. Nous verrons comment La Fontaine, en restituant avec vivacité le petit drame vécu par cette femme, s’y prend pour divertir son lecteur tout en le faisant réfléchir au comportement de son personnage. 3. Mouvements du texte Mouvement 1 : vers 1 à 26 : Portrait satirique de la jeune femme Mouvement 2 : vers 27 à 43 : La jeune femme confrontée à la fuite du temps 4. Explication linéaire Premièrement, La Fontaine dresse un portrait satirique de la jeune femme Dès la première ligne du texte, La Fontaine précise qu’il s’agit d’une « Fille » qui va exprimer ses pensées : « Certaine Fille » (v1). Cette fille est caractérisée par le groupe de mots « un peu trop fière » (v1). L’association des adverbes « peu » et « trop » à l’adjectif qualificatif « fière » montrent qu’il s’agit d’une fille prétentieuse et imbue de sa personnalité. Elle est donc « précieuse ». A partir de ce portrait moral de la jeune fille, La Fontaine énonce clairement son but : elle « Prétendait trouver un mari » (v2). Dans les deux vers suivants (v3-4), Jean de la Fontaine établit ensuite une description du mari idéal dont rêve la jeune fille, comme nous pouvons lire : « Jeune, bien fait et beau, d’agréable manière, point froid et point jaloux ; notez ces deux points-ci ». Cette énumération accumule les adjectifs qualificatifs caractérisant les qualités attendues par la jeune femme en révélant tout de suite son exigence quant à son futur mari. En plus du portrait physique que dresse la Fille du futur époux qu’elle recherche, elle nous situe également sur son aspect moral et social : « Cette fille voulait aussi qu’il eût du bien, de la naissance, de l’esprit, enfin tout » (v5 à 7). Alors que le premier passage met en avant le portrait physique, les exigences se portent ainsi sur le portrait moral et l’argent dans le second passage. Cette jeune femme est une précieuse, c’est-à-dire qu’elle cherche un idéal, la perfection mais cette quête fait qu’elle va basculer dans l’orgueil, la vanité, le dédain et l’ironie. Mais, dans cette description du mari idéal, Jean de la Fontaine emploie une question rhétorique : « mais qui peut tout avoir ? » (v7). Cependant, les vers 8 et 9 qui suivent, montrent que les souhaits de la fille ont été exaucés : « Le destin se montra soigneux de la pourvoir » et « Il vint des partis d’importance ». L’emploi des verbes au passé simple font état de la rapidité des actions dans ce récit. Car, contre toute attente, sa réaction surprend. Elle les repousse tous pour une raison ou pour une autre, nous disent les vers 10 ; 14 ; 15 ; 16 : « La belle les trouva trop chétifs de moitié ; l’un n’avait en l’esprit nulle délicatesse ; L’autre avait le nez fait de cette façon-là ; C’était ceci, c’était cela ». Son attitude dédaigneuse s’illustre également par l’emploi des questions rhétoriques des vers 11 à 13 : « Quoi moi ? Quoi ces gens-là ? L’on radote, je pense. A moi les proposer ! Hélas ils font pitié. Voyez un peu la belle espèce ! ». Elle se croit si belle et supérieure qu’elle ne trouve personne à son goût. Après cette catégorie de personnes, une autre catégorie se présente à elle : « Après les bons partis les médiocr es gens ; vinrent se mettre sur les rangs » v19-20. Elle se moqua d’eux également en préférant sa solitude. « Elle de se moquer » v21. L’auteur dresse donc le portrait satirique d’une fille qui prie pour avoir un époux de son choix mais qui les repousse tous par orgueil et fierté. Deuxièmement, les vers 27 à 43 qui suivent, révèlent le désenchantement de la fille. En effet, après les avoir tous repoussés, la fille se rend compte après bien des années que le temps passe sans qu’elle ait pu choisir un mari : « L’âge la fit déchoir ; adieu tous les amants. Un an se passe et deux avec inquiétude ; Le chagrin vient ensuite : » v27 à 29. Les deux points du vers 29 expriment ici la cause. Les raisons de son « chagrin » sont multiples et vont se développer dans les vers suivants dans une énumération ponctuée par l’adverbe puis qui renforce l’idée d’accumulation. Du coup, la fille voit sa beauté altérée par le temps qui fait apparaître ses rides. Sa beauté disparaît progressivement si bien qu’elle n’est plus attirante. Ainsi, l’allitération en [s] aux vers 31 à 32 traduit l’idée de fuite de sa beauté, de perte contre laquelle elle ne peut rien tout comme les verbes à l’infinitif « choquer et déplaire ». Devant cette déchéance physique, la fille prend conscience qu’elle ne trouvera plus de mari à son goût car « les ruines du visage » v36 sont assimilées aux « ruines d’une maison » v34 de manière métaphorique. Elle s’est donc délabrée en perdant tous ses caractères féminins et humains du fait de son vieillissement. Cette réalité étant devenue angoissante, elle n’a plus de choix que de se résoudre à accepter le premier venu quel qu’il fût. D’où ces propos : « Son miroir lui disait : « Prenez vite un mari » » v38. L’emploi de l’impératif dans ce vers met en relief l’urgence de sa situation. Elle doit impérativement se trouver un mari. Cependant, contre toute attente, « Celle-ci fit un choix qu’on n’aurait jamais cru » v41. La présence de la négation révèle un retournement de situation qui met en relief le passage des ambitions idéales de la fille à un réalisme ironique. Pour preuve, le dernier mot de la fable « malotru » v43 apparaît comme l’antithèse au portrait de l’honnête homme qu’elle espérait dans sa jeunesse. Ce qui nous place face à une contradiction ironique et satirique. Dans ce dernier vers, le mari est présenté de manière dépréciative comme le résultat d’une déception. 5. Conclusion La morale de cette fable tend à dresser une satire efficace et vivante de la préciosité. Sa fable évolue donc comme un retournement de situation entre le début et la fin qui permet de mettre en relief la désillusion de la fille. Tout comme son contemporain Molière, La Fontaine fait ici la caricature d’une mode de son époque où l’orgueil et la vanité entraînent l’Homme dans l’insatisfaction, ne parvenant pas à se satisfaire de ce qu’on lui propose ou de ce qu’il a. L’individu se retrouve alors pris dans un cercle vicieux risquant de tout perdre en voulant toujours avoir plus. uploads/Litterature/ analyse-lineaire-la-fille.pdf
Documents similaires










-
99
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 23, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0899MB