Romantisme Baudelaire poète latin Mme Corinne Saminadayar-Perrin Citer ce docum
Romantisme Baudelaire poète latin Mme Corinne Saminadayar-Perrin Citer ce document / Cite this document : Saminadayar-Perrin Corinne. Baudelaire poète latin. In: Romantisme, 2001, n°113. L'Antiquité. pp. 87-103; doi : https://doi.org/10.3406/roman.2001.1030 https://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_2001_num_31_113_1030 Fichier pdf généré le 02/04/2018 Abstract Like Rimbaud and Sainte-Beuve, Baudelaire excelled in the study of Latin poetry when he was at school. It is nonetheless legitimate to ask how much this allows us to better understand the radically new aesthetics he advocated. Baudelaire articulated original ideas about the role of the Latin language in French poetry and engagea in aesthetic reflection about the relationship between the Latin poetry of the decadent period and literary modernity. Furthermore, the poet believed that there was a mysterious, even mystical affinity between the Latin and French languages. Underlying the intertextuality and rewriting that mark Baudelairian verse, and give it its present/absent Latinity, is a constantly renewed process of reflection about the stylistic influences proper to the «lieu commun». Baudelaire's poetry tends to impose Latin upon the French to such a degree that this internal tension becomes central to the meaning, the oblique inscription of the Latinity revealing both the ontological power of the Word and its limits. It is as if the writing is constantly pointing to an «ailleurs» that emblematizes the diffuse and anamorphic presence of Latin in the text. This deliberate use of poetic practice mirrors a shattered reality, whose reflection is an empty transcendence that the poet at the same time denies. Baudelaire's Latin poetics is the linguistic projection of an ontology that is inseparable front hermeneutics. Résumé Comme (notamment) Rimbaud ou Sainte-Beuve, Baudelaire excella en poésie latine durant ses années de collège; reste qu'on peut légitimement se demander dans quelle mesure cette pratique scolaire permet de mieux comprendre 1'esthétique radicalement nouvelle que revendique le poète. Baudelaire article une réflexion originale sur le rôle de la langue latine en poésie française, et une méditation esthétique sur les rapports entre la poésie latine de la décadence et la modernité littéraire. Bien plus, le poète considère qu'il existe une affinité mystérieuse, voire mystique, entre les langues latine et française; les jeux de d'intertextualité et de réécriture, qui doublent le vers baudelairien d'une latinité présente/absente, sous-tendent une réflexion toujours recommencée sur les pouvoirs stylistiques propres au lieu commun. Si l'écriture poétique de Baudelaire tend à surimposer le latin au français jusqu'à faire de cette tension interne le foyer même de la signification, c'est parce que cette inscription oblique de la latinité révèle à la fois les pouvoirs ontologiques du Verbe et ses limites comme si l'écriture désignait toujours un «ailleurs» du texte qu'emblématise la présence diffuse et anamorphosée du latin. Cette non-coïncidence à soi du langage poétique est à l'image d'un réel éclaté, renvoyant à une transcendance vide qu'en même temps il dénie: la poétique latine de Baudelaire est la projection linguistique d'une ontologie inséparable d'une herméneutique. Corinne SAMINADAYAR-PERRIN Baudelaire poète latin «Je le respectais beaucoup, parce qu'il était fort en vers latins. . . » C'est en ces termes que Louis Ménard évoque Charles Baudelaire, qui fut son condisciple au lycée Louis-le- Grand l ; Emile Deschanel, camarade de classe de Baudelaire au cours de son année de philosophie, écrit de son côté: «Lui-même, dès le lycée, était poète, soit en latin, soit en français. Je me rappelle un de ses chefs-d'œuvre en vers latins [...] Baudelaire avait fait merveille, composé les vers latins les plus brillants, brodé des développements éblouissants.»2 Les palmarès confirment ces souvenirs: en troisième, en seconde et en rhétorique, Baudelaire obtint le premier prix en vers latins; il remporta en outre un accessit, puis un deuxième prix au Concours général, et l'un de ses professeurs notait à son sujet: «Esprit fin [...] Ne réussit qu'en vers latins.»3 Ainsi, comme Rimbaud4 ou Sainte-Beuve, Baudelaire excella en poésie latine durant ses années de collège, et c'est grâce à ces succès que certaines pièces en vers latins (ce fut aussi le cas pour Rimbaud) nous ont été conservées5. L'œuvre ultérieure du poète atteste d'ailleurs de la profonde imprégnation linguistique que nécessitait cette pratique 6 ; la grammaire latine 7, les textes de récitation classique, des formules célèbres 8 se retrouvent fréquemment dans ses vers tout comme dans ses écrits en prose; on a même reconnu dans «les bijoux perdus de l'antique Palmyre» («Bénédiction») l'écho d'un manuel classique9. 1. Louis Ménard, Tombeau de Charles Baudelaire (1896). Cité par Claude Pichois, Œuvres complètes de Baudelaire, Gallimard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», II, 1976, p. 1083. Toutes les références à l'œuvre critique de Baudelaire renverront désormais à cette édition. 2. Emile Deschanel, conférence faite à Paris, rue Scribe, en février 1866; texte cité par C. Pichois et Jean Ziegler, Baudelaire, Biographie Julliard, 1987, p. 108. 3. Annotation de M. Rinn, citée par C. Pichois et J. Ziegler, Baudelaire, p. 100. 4. Sur l'influence de la pratique des vers latins sur l'écriture poétique rimbaldienne dans le sonnet «Voyelles», voir l'article de Anne-Marie Franc, «"Voyelles": un adieu aux vers latins», Poétique, n° 60, nov. 1884, p. 41 1-422. 5. Les poèmes latins de Baudelaire ont été édités pour la première fois par Jules Mouquet, Vers latins avec trois poèmes en fac-similé, suivis des compositions latines de Sainte-Beuve et Alfred de Musset, Mercure de France, 1933; c'est ce texte, avec sa traduction, que C. Pichois a repris dans son édition de la bibliothèque de la Pléiade (Œuvres complètes, I, 1975), édition à laquelle renverront désormais toutes les citations de l'œuvre poétique et littéraire de Baudelaire. 6. Faire des vers latins consistait, pour la plus grande partie, à constituer une savante marqueterie de fragments des grandes œuvres poétiques latines (Virgile en particulier était mis à contribution), dont certains extraits étaient d'ailleurs donnés par le Gradus; il s'agissait de détourner habilement ces citations et de les déguiser, ce qui passait pour l'art suprême. Pour le reste, le Gradus fournissait force épithètes de qualité comportant la quantité voulue. Pour un aperçu d'ensemble sur les pratiques pédagogiques des humanités, voir mon livre Modernités à l'antique: parcours vallésiens, Champion, 1999, p. 37-82 (les p. 59-62 sont plus particulièrement consacrées à la question des vers latins). 7. Les exemples-types, que les collégiens devaient apprendre par cœur, se retrouvent assez souvent dans la prose de Baudelaire; voir par exemple dans «Sur mes contemporains: Marceline Desbordes- Valmore»: «...La savante Italie, qui connaît si bien l'art d'édifier des jardins (aedificat hortos).» (II, p. 148; J. Crépet identifie la formule comme une citation des grammaires latines). 8. On trouve, par exemple, la formule d'Horace Auri sacra fames en tête d'une œuvre de Samuel Cramer (La Fanfarlo, I, p. 580). Au demeurant, ce type de référence fait partie du bagage commun de tout bachelier avant 1870. 9. C. Pichois note: «Claudine Quémar-Hof voit la source de ce vers dans l'extrait d'une épopée, Palmyre conquise, par Claude Dorion (1815), extrait que présente le manuel de François Noël et François Delaplace très répandu dans les collèges de la monarchie de Juillet: Leçons de littérature et de morale» (I, p. 834). ROMANTISME n° 113 (2001-3) 88 Corinne Saminadayar-Perrin Reste qu'on peut légitimement se demander dans quelle mesure cette pratique des vers latins au collège peut être rapprochée de l'œuvre ultérieure du poète. Sans doute s'agit-il là d'un fantasme universitaire qui court tout au long du XIXe siècle, et au- delà 10: les vers latins ne seraient qu'une propédeutique à la création littéraire ultérieure des jeunes gens ; le but des humanités consisterait à faire passer les élèves, sans rupture notoire, de l'institution scolaire à la carrière contemporaine des belles-lettres ou des professions littérales; par conséquent, il ne s'agit nullement de former des poètes néolatins, mais de forger chez les collégiens une langue d'écriture stylistiquement pure. Telle est l'ambition de l'enseignement secondaire, projet que répètent incessamment aussi bien les discours de distributions de prix que la presse spécialisée n et les manuels classiques eux-mêmes 12; la préface du Gradus n'hésite pas à affirmer que ce dictionnaire constitue un véritable «cours de littérature poétique» 13. Encore convient-il de ne pas trop ajouter foi à ce type de propos, qui ne sauraient garantir à eux seuls l'efficacité d'une telle méthode; d'ailleurs, les contemporains n'ont pas manqué de se moquer de ces belles déclarations, qui élevaient un laborieux collage de lambeaux virgiliens et d'épithètes de nature au rang de création poétique authentique, si bien que la France regorgeait de pseudo-écrivains laborieux mais productifs: «II y a quelques années, une réputation de poète se gagnait en France à bon marché. On apprenait en seconde ou en rhétorique à faire des vers, puis [...] on cherchait dans les livres quelque lieu commun de morale philosophique, ou dans la nature quelque sujet banal de description. Cela fait, on se mettait à son bureau, et il n'est pas qu'après s'être cinq ou six heures passé la main sur le front, on n'en tirât à la fin une centaine de vers raisonnables et corrects.» 14 En ce sens, les vers latins pourraient n'avoir qu'une influence désastreuse sur la création ultérieure; aussi Asselineau fait- il l'éloge des Fleurs du Mal uploads/Litterature/ baudelaire-poete-latin-pdf.pdf
Documents similaires




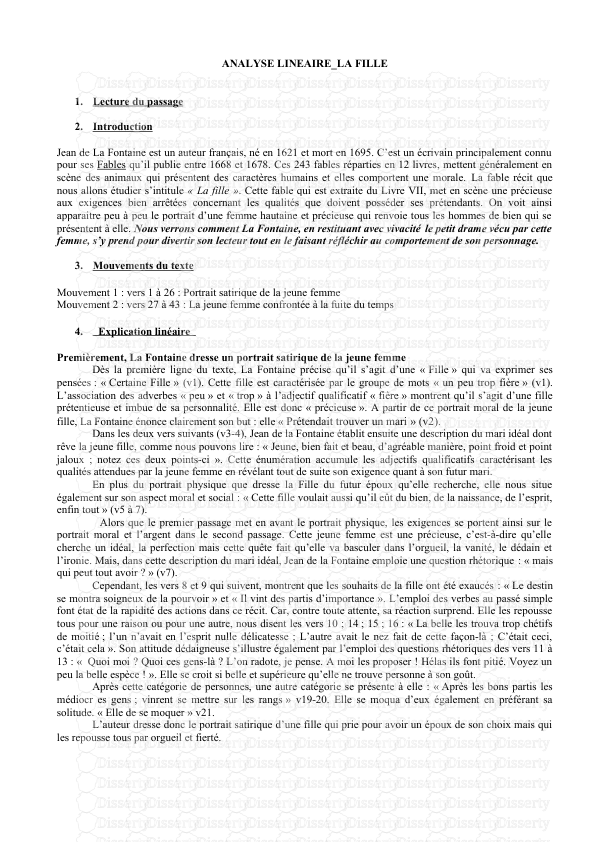





-
104
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 24, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 1.7522MB


