études romantiques et dix-neuviémistes sous la direction de Pierre Glaudes et P
études romantiques et dix-neuviémistes sous la direction de Pierre Glaudes et Paolo Tortonese 39 L’idée française de l’histoire Préface de Philippe Barthelet PARIS CLASSIQUES GARNIER 2013 Carolina Armenteros L’idée française de l’histoire Joseph de Maistre et sa postérité (1794-1854) © 2013. Classiques Garnier, Paris. Reproduction et traduction, même partielles, interdites. Tous droits réservés pour tous les pays. ISBN 978-2-8124-1386-5 (livre broché) ISBN 978-2-8124-1387-2 (livre relié) ISSN 2103-4672 Chercheuse indépendante, Carolina Armenteros a enseigné dans les universités françaises, américaines, britanniques et néerlandaises. Elle a coédité The New enfant du siècle : Joseph de Maistre as a Writer (St Andrews, 2010), Joseph de Maistre and the Legacy of Enlightenment (Oxford, 2011) et Joseph de Maistre and his European Readers : From Friedrich von Gentz to Isaiah Berlin (Leyde, 2011). À la mémoire de mon grand-père, Carlos. PRÉFACE À la différence de la plupart de ses contemporains, nommément ceux qu’une historiographie paresseuse range sous la même étiquette de « contre-révolutionnaires », Joseph de Maistre ne se leurre pas sur la nature de la Révolution : dès sa lettre à la marquise de Costa, au printemps 1794, il y voit non pas un événement mais une époque, soit le commencement d’un nouvel âge du monde1. L’histoire a changé de visage : elle n’est plus un objet de spéculation plus ou moins lointain, comme les Romains pour Montesquieu ou pour Diderot, ou même Louis XIV ou Charles XII pour Voltaire ; elle envahit la vie quotidienne, bouleverse les travaux et les jours, faisant bientôt d’un sénateur érudit de la Savoie un exilé sur les routes de l’Europe et l’ambassadeur à Saint-Pétersbourg d’un royaume de Piémont- Sardaigne qui n’est guère plus qu’une fiction de protocole. La grandeur de Joseph de Maistre ou pour mieux dire sa supériorité est d’abord dans ce refus de tout mensonge de rassurance, puis dans le défi intellectuel que ce refus implique : prendre acte de l’inédit qui arrive, et le penser selon les nouvelles catégories qu’il nécessite. Joseph de Maistre est un chrétien conséquent, qui croit à la divine providence : il se rappelle que Dieu ne nous fait pas les confidents de ses desseins, et que, selon Bossuet, « quand Dieu efface, c’est qu’il s’apprête à écrire ». À partir de 1789 et plus encore, du 21 janvier 1793, Dieu efface. Ceux qui n’ont rien appris ni rien oublié, les aristocruches retour d’émigration dont le marquis de Custine décrit la cour pitoyable à Vesoul, autour de Monsieur, pendant la campagne de France, l’époque révolution- naire les a frappés d’inanité, et la restauration qu’ils espèrent comme une continuation à l’identique, la parenthèse regrettable une fois refermée, est 1 « … Longtemps nous n’avons point compris la Révolution dont nous sommes les témoins ; longtemps nous l’avons prise pour un événement. Nous étions dans l’erreur : c’est une époque : et malheur aux générations qui assistent aux époques du monde ! » (Discours à Mme la marquise de Costa sur la vie et la mort de son fils Alexis Louis Eugène de Costa, 1794, dans Joseph de Maistre, Philippe Barthelet (éd.), Lausanne, L’Âge d’homme, coll. « Les dossiers H », 2005, p. 27-41.) 10 L’IDÉE FRANÇAISE DE L’HISTOIRE vouée d’avance à n’être qu’une impossible parodie. Joseph de Maistre n’a jamais eu de ces naïvetés, comme on le voit dans la correspondance qu’il entretient depuis Lausanne, en 1794, avec le cabinet de Turin : « je crois fermement que la Monarchie est frappée irrémissiblement ( j’entends la monarchie absolue)… Le jugement porté sur la monarchie est visible. Ne voyez-vous pas que tout nous réussit mal ; et que non seulement le malheur, mais le ridicule nous poursuit1 ? » Ce ridicule, Joseph de Maistre en a été exempt dès l’origine ; ce qui lui vaudra l’intérêt et davantage : l’admiration des générations suivantes. « Prophète du passé », le surnom un rien perfide que lui décerne Ballanche n’est vrai qu’à demi : le premier xixe siècle verra en lui un prophète tout court, et ce n’est pas le moindre mérite de Carolina Armenteros que de nous le rappeler. Avec une érudition merveilleusement indemne de ces crampes idéolo- giques qui hélas, paralysent ou déforment encore la recherche historique française s’agissant de l’époque de la Révolution et de sa postérité philo- sophique, l’auteur montre que Joseph de Maistre a été « l’intermédiaire décisif, quoique négligé, entre les philosophes de l’histoire du xviiie siècle français et les historiens et philosophes de l’histoire du xixe ». Son origi- nalité, largement sous-estimée, tient peut-être à une illusion d’optique qui relève de la chronologie : c’est à partir de la Restauration que l’on a célébré Joseph de Maistre comme un oracle de la contre-révolution, en oubliant presque toujours que ce « penseur romantique », si l’on en croit quelques classifications de manuel, était l’aîné de quinze ans de Chateaubriand, et qu’il est en tout un homme du xviiie siècle… Carolina Armenteros montre à quel point il est à sa façon un héritier des Lumières, comment « il adhère au principe helvétien de l’utilité » et surtout, quelle place cardinale la critique de Rousseau tient dans l’élaboration de sa pensée : « il finira par devoir beaucoup plus au philosophe genevois qu’il n’aurait aimé le recon- naître ». Carolina Armenteros n’hésite pas à écrire que « si quelque chose peut relier Maistre aux Lumières radicales, c’est l’affirmation à travers les Soirées de Saint-Pétersbourg d’un pouvoir humain presque illimité ». C’est en effet un « portrait intellectuel de Maistre assez différent » des images convenues que l’on nous propose ici – autant dire des caricatures. Maistre rationaliste, « et non l’ennemi irréductible de la raison si souvent dépeint », Maistre mettant son intuitionnisme à l’épreuve d’un empirisme original, 1 Lettre au baron Vignet des Étoles (6 janvier 1794), dans Joseph de Maistre, Philippe Barthelet (éd.), p. 363. PRÉFACE 11 tels que procéderont les traditionalistes attachés à la recouvrance de la tradition primitive ; Maistre, enfin, de plus en plus critique à l’égard de toute forme d’absolutisme politique : le malentendu avec les ultras, puis avec la droite contre-révolutionnaire (Maurras en particulier) était inévi- table. Carolina Armenteros liquide définitivement la thèse paresseuse – la paresse est aisément calomniatrice – d’un Joseph de Maistre absolutiste pour commencer et précurseur du fascisme pour finir : « Maistre a forgé une manière nouvelle et spécifiquement française de penser l’histoire qui suppose la foi en l’homme » capable de « forger son propre destin ». Joseph de Maistre défenseur de la liberté et des droits de l’individu ? La sensibi- lité américaine de l’auteur lui fait insister sur ce que deux siècles de lieux communs d’histoire intellectuelle nous empêche de saisir : « l’exemplaire et constante modération politique de Maistre ». Carolina Armenteros parle avec assez de bonheur de son « humanisme civique » : « sa vie durant il a soutenu la définition de l’égalité qu’il avait formulée dans sa jeunesse » – égalité royale, il faut le préciser : « Un roi qui protège également tous les ordres de l’Etat, qui leur distribue indifféremment ses faveurs, et qui se garde bien d’en élever un seul au préjudice des autres » (Eloge de Victor-Amédée III). La postérité de Joseph de Maistre est ambiguë : au premier para- doxe – la déception plus ou moins cachée, voire la défiance de la droite contre-révolutionnaire – s’en ajoute un second : l’enthousiasme des dif- férentes écoles socialistes de la première moitié du xixe siècle. L’étude de Carolina Armenteros est ici pionnière : elle montre à quel point ignoré Joseph de Maistre fut un précurseur, et que le fait considéré à la fois comme « autorité morale » et « lieu de production sociale et historique », notion fondatrice aussi bien de la sociologie que de la statistique avait été théorisé pour la première fois par le jeune Maistre dans De l’état de nature. Les pistes ouvertes par cette étude, qu’elles relèvent de la théorie poli- tique (la conception maistrienne de la liberté, « susceptible de degrés et soumise à des conditions »), de l’épistémologie ou de l’histoire intellectuelle européenne, sont innombrables et très prometteuses. Dans la réévaluation de l’œuvre de Joseph de Maistre entreprise depuis bientôt cinquante ans, l’essai de Carolina Armenteros est un jalon de première importance. Philippe Barthelet AVANT-PROPOS Ce livre a été commencé en 2000 à King’s College et à la Faculté d’histoire de l’université de Cambridge. Au cours des années suivantes, j’ai bénéficié de l’aide de plusieurs personnes. Ma plus grande reconnaissance va à Gareth Stedman Jones, dont les commentaires ont aidé le livre à prendre forme. À Paris, Francine Markovits m’a guidée et encouragée, partageant avec moi ses connaissances en philosophie. D’autres chercheurs m’ont aidé à parcourir le chemin de mes recherches, m’offrant des pistes, des références et des aperçus : Sylviane Albertan-Coppola, Keith Baker, Dan Edelstein, Kevin Erwin, Marta Fattori, Pierre Glaudes, Michael Kohlhauer, Jill Kraye, Jacques Le Brun, Malcolm Mansfield, Alexander Martin, Michael Sonenscher, Ryan Song, Benjamin Thurston, Dale Van Kley, et Cynthia Whittaker. Je dois remercier tout spécialement Richard Lebrun, uploads/Litterature/ carolina-armenteros-l-x27-idee-francaise-de-l-x27-histoire-joseph-de-maistre-et-sa-posterite.pdf
Documents similaires


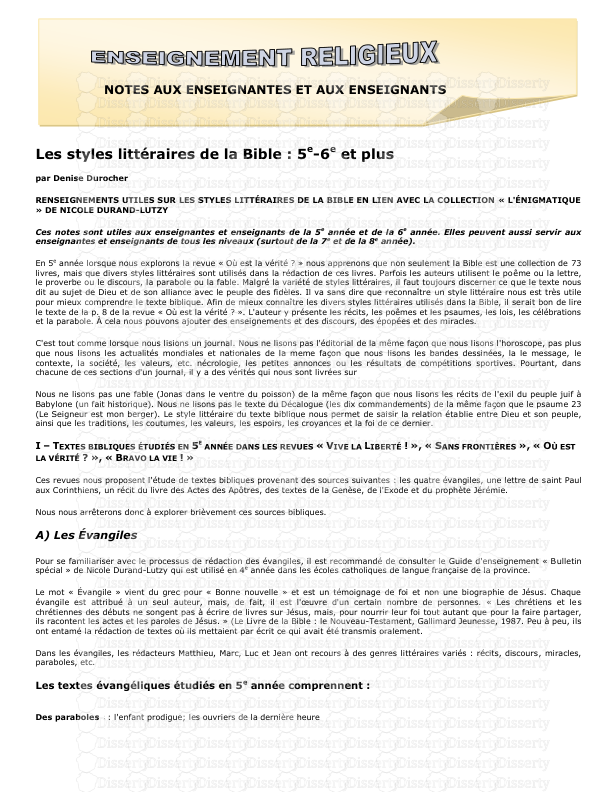







-
20
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 28, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 3.7371MB


